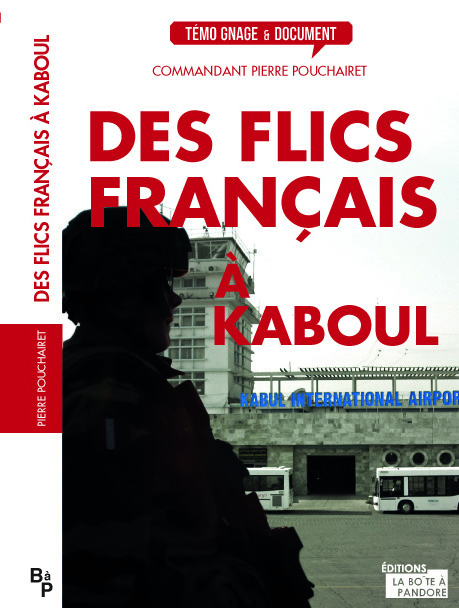 Le 11 septembre 2001 a ouvert une porte vers une nouvelle ère, celle des campagnes de reconquête du Moyen-Orient par l’hyper-puissance états-unienne, au nom de « la guerre contre le terrorisme ». Une ère de conflits parfois illégaux, qui ont déclassé l’Organisation des Nations unies ; en 2003, les États-Unis et une poignée d’alliés, qui se définissaient comme la « Communauté internationale », envahissaient l’Irak, sans accord du Conseil de Sécurité de l’ONU. Deux ans auparavant, Washington survenait dans l’Afghanistan des Talibans, le seul obstacle entre les réserves pétrolières et gazières dont regorgent les républiques ex-soviétiques d’Asie centrales et les ports de l’allié pakistanais, Gwadar et Karachi. Une entreprise hasardeuse, aujourd’hui remise en question…
Le 11 septembre 2001 a ouvert une porte vers une nouvelle ère, celle des campagnes de reconquête du Moyen-Orient par l’hyper-puissance états-unienne, au nom de « la guerre contre le terrorisme ». Une ère de conflits parfois illégaux, qui ont déclassé l’Organisation des Nations unies ; en 2003, les États-Unis et une poignée d’alliés, qui se définissaient comme la « Communauté internationale », envahissaient l’Irak, sans accord du Conseil de Sécurité de l’ONU. Deux ans auparavant, Washington survenait dans l’Afghanistan des Talibans, le seul obstacle entre les réserves pétrolières et gazières dont regorgent les républiques ex-soviétiques d’Asie centrales et les ports de l’allié pakistanais, Gwadar et Karachi. Une entreprise hasardeuse, aujourd’hui remise en question…
2014, année d’élection en Afghanistan, mais aussi année du retrait définitif des forces internationales, dont beaucoup n’ont pas attendu cette date pour quitter ce qui était devenu aux yeux de leur population le « bourbier afghan ».
Sans vouloir me poser en analyste de la guerre en l’Afghanistan et des causes profondes de l’échec international, c’est en tant que témoin et acteur de la coopération française dans ce pays, pendant près de cinq années, de mars 2006 à septembre 2010, que j’ai tenté de préciser mon sentiment sur notre action et ses « résultats ».
La bascule
Michael Alexander Barry, dans Le royaume de l’insolence, a écrit : « la nouvelle guerre d’Afghanistan fut sans doute perdue le 29 mai 2006, car cette date de défaite politique réelle de l’intervention occidentale en vaut bien une autre : jour fatidique où un camion militaire américain, roulant comme d’accoutumée beaucoup trop vite dans son angoisse des attentats, écrasa cinq passants dans les rues bondées de Kaboul et provoqua des émeutes antioccidentales et antigouvernementales dans toute la capitale. » Je souscris totalement à cette analyse : arrivé quelques mois auparavant, j’ai été témoin des événements en question, de la dégradation continue de la situation sécuritaire et du rejet croissant de la population à notre égard qui l’ont suivi.
J’avais, d’ailleurs, envisagé d’intituler mon livre La Bascule, tant je pensais que cette date marquait le début de notre chute.
En 2006, la situation sécuritaire n’apparaissait pourtant pas comme un problème insurmontable. La vie était plutôt douce pour les expatriés, et particulièrement pour nous, Français, qui n’avions pas de consignes à respecter et pouvions nous promener où bon nous semblait dans Kaboul et ses environs.
Les Kaboulis ne regrettaient pas la chute du régime des Talibans. Mais leurs attentes se faisaient de plus en plus pressantes : si la capitale profitait financièrement de la présence étrangère, créatrice d’emplois, les Afghans attendaient et espéraient plus, et surtout plus vite. Après cinq ans, leur vie avait peu changé et les besoins les plus élémentaires n’étaient toujours pas assurés. Il n’y avait pas plus d’électricité que par le passé ; les gens manquaient d’eau ; le niveau d’éducation ne s’améliorait pas… La confiance envers les dirigeants s’était évaporée en raison d’une situation économique catastrophique qui ne semblait d’ailleurs pas avoir les mêmes effets pour tout le monde ; les hommes politiques, les ex-seigneurs de la guerre et les trafiquants de drogue se faisaient construire des palais dans le centre-ville. Le découragement de la population n’était pas loin ; et certains, lassés du spectacle donné par une classe dirigeante corrompue et considérée comme étant à la solde de l’étranger, finissaient par idéaliser la droiture des Talibans.
Dans ce contexte, le coup de tonnerre du lundi 29 mai 2006 peut tout à fait être considéré comme le moment où tout a basculé et où fut consommée la rupture entre Afghans et étrangers, chacun se repliant sur lui-même par peur ou rejet de l’autre. L’idée que les États-Unis et leurs alliés étaient une force d’occupation que la nation afghane allait repousser, comme elle l’avait déjà fait de l’Empire britannique et de l’Union soviétique, s’installa progressivement dans les esprits comme un espoir porteur de fierté.
Le départ de la coalition sera, sans nul doute, vécu par beaucoup d’Afghans comme une victoire nationale remportée sur l’impérialisme américain et, ce jour-là, la population, dans son ensemble, se sentira la fibre talibane ! Même si elle devra déchanter par la suite et si une partie des Afghans a profité pleinement de la présence étrangère.
Je me souviens d’une réflexion de mon secrétaire afghan, alors que nous passions devant un cimetière de chars russes, où rouillaient plusieurs dizaines de tanks et de véhicules blindés de l’armée ex-soviétique… Il lâcha : « Voilà ce que les Afghans ont fait des Russes, et j’espère qu’il y aura bientôt les véhicules des Américains et des autres coalisés à cet endroit. » Lui-même et l’ensemble de sa famille profitaient pourtant pleinement de la coopération internationale, après plusieurs années passées dans un camp de réfugiés au Pakistan durant l’ère des Talibans.
Les Occidentaux sont aujourd’hui considérés comme des envahisseurs et leur départ ressemblera à un aveu d’échec.
Après 2006, il n’y eut bien que l’OTAN et quelques chancelleries pour trouver que la situation sécuritaire s’améliorait. J’aimais ce langage optimiste qui perdure encore aujourd’hui et consiste à présenter un nouvel attentat comme « le dernier soubresaut d’une rébellion agonisante ».
Une vue qui est à chaque fois moins convaincante…
Quel revers pour tous les États qui ont versé le sang de leurs soldats, en pensant libérer les Afghans de la tyrannie talibane !
Les raisons de notre échec sont multiples
- Un mauvais choix de nos interlocuteurs…
Les Américains ont dès le départ cherché à imposer des élites afghanes qui seraient leurs interlocuteurs privilégiés.
Les moudjahidines, ces résistants qui avaient combattu pour l’indépendance du pays contre les Russes puis contre le pouvoir des Talibans, ont été délibérément écartés au prétexte qu’ils n’étaient pas suffisamment éduqués et, sans qu’on le dise clairement, ne parlaient pas anglais. « Handicap fondamental », pour gérer le futur de l’Afghanistan, censé devenir en quelques années, grâce au soutien de la communauté internationale, un État démocratique.
Un tel état d’esprit n’a fait que créer des tensions envers les nouveaux tenants du pouvoir installés à Kaboul, les libérateurs internationaux qui les soutenaient et les anciens chefs de guerre, refoulés dans leurs provinces au sein de leur tribut (dont ils bénéficiaient de l’indéfectible appui, produit d’une confiance clanique acquise au fil des siècles).
Résultat : les cadres actuels -qu’il s’agisse des hommes politiques, des généraux ou des hauts fonctionnaires- sont majoritairement d’anciens expatriés qui ne bénéficient d’aucun soutien populaire et seront peu enclins à défendre l’État si celui-ci est menacé.
Ils préféreront sans nul doute s’en retourner au plus vite dans leur ancienne patrie d’accueil en Europe, aux États-Unis, dans les Émirats arabes unis, ou encore au Pakistan….
- L’État afghan n’a jamais véritablement existé.
S’il existe une véritable fibre nationale, il n’existe pas pour autant un attachement à une autorité centrale.
Chaque région a toujours eu à sa tête des chefs de clans, de tribus, ou d’anciens chefs de guerre. Bon nombre d’entre eux sont, d’ailleurs, représentés au Parlement.
La fierté de la population, son ancrage religieux et le poids des traditions rendent le pays imperméable à toute implication étrangère.
- L’importance des revenus engendrés par les trafics…
Les enlèvements, la corruption et toutes les activités criminelles laissent peu de place à la recherche d’activités lucratives légales.
La production d’opium reste largement supérieure à la demande mondiale, même si elle stagne depuis plusieurs années, aux environs de… 6.000 tonnes annuelles !
- La présence militaire étrangère en Afghanistan a souffert du parallèle qui l’assimile, dans l’esprit de beaucoup en Europe et aux États-Unis, à la campagne irakienne.
Les gouvernements occidentaux, victimes du déficit de pédagogie mise en œuvre auprès de leur population, se sont trouvés contraints pour des raisons de politique intérieure de rapatrier peu à peu leurs militaires. Et ce retrait a des allures de défaites…
Il n’y a pourtant rien de comparable entre les deux « aventures ».
En Irak, de « fausses bonnes raisons » ont provoqué le renversement d’un État solide et son remplacement par une autorité contestée incapable de faire cesser les troubles… Tout peut laisser supposer que le régime de Saddam Hussein n’aurait pas survécu à un printemps arabe et que l’implication américaine n’avait aucune raison d’être pour un aussi piètre résultat.
L’investissement afghan aurait peut-être pu se limiter à des frappes chirurgicales (comme savent en faire les Israéliens lorsqu’ils visent leurs ennemis), pour éliminer Ben Laden ou le Mollah Omar. Mais, aujourd’hui, le retrait des forces de la coalition laissera le champ libre aux talibans ; et il y a de bonnes raisons de penser que le pays redeviendra rapidement un foyer d’accueil pour le terrorisme international.
- Notre empressement à vouloir réussir et imposer nos vues.
Pétris de bonnes intentions, mais pressés par des raisons financières et économiques, nous avons sombré dans un nouveau colonialisme, qui a consisté, plutôt qu’à laisser évoluer les populations à leur rythme, à imposer nos vues, à savoir un État centralisé, la démocratie, un système juridique calqué sur celui que nous connaissons en occident, la promotion du rôle de la femme dans la société…
En dehors de Kaboul, toutes ces tentatives de réformes se sont heurtées à l’incompréhension de la population rurale, empreinte de traditions féodales peu perméables aux changements.
Aujourd’hui, dans une ambiance troublée, alors que les Talibans sont à l’affût, les élections présidentielles se révèlent une péripétie de plus.
Les Afghans considéraient le premier président de l’ère post-Talibans, Hamid Karzaï, comme un fantoche à la solde des Américains ; et les hommes politiques, comme des gens corrompus qui passent leur temps à se remplir les poches au détriment de la population.
Dans ce contexte, l’intérêt porté à l’élection est encourageant. Mais seul l’avenir nous dira si le candidat élu sera à même d’apporter à la population les réponses qu’elle attend et de maintenir l’unité du pays.






1 Comment
Il y a d’autres raisons à l’échec, certaines imputables aux étrangers, pas toutes, mais sur l’essentiel, j’adhère plutôt : un mélange de naïveté, de méconnaissance des réalités, d’impréparation et de croyance que “les moyens justifiaient la fin” ont conduit à une situation où les libérateurs ont fait partie du problème.