Un voyage à travers la guerre contre l’État islamique (EI), à Bagdad, à Erbil, Kirkouk et Souleymanieh, dans le Kurdistan irakien, dans l’enfer de Kobanê, dans les cantons du Kurdistan syrien, et à Alep, ville martyre du nord-ouest de la Syrie, où la révolution se meurt.
Une exceptionnelle enquête de terrain, sur toute la longueur du front qui oppose la coalition internationale et les acteurs locaux aux « Fous de Dieu » du Califat.
Bagdad
 Une ville assiégée… Où la guerre attend le passant à chaque coin de rue.
Une ville assiégée… Où la guerre attend le passant à chaque coin de rue.
Il n’est pas facile d’accéder à la capitale irakienne. Les autorités consulaires ont ordre de ne pas délivrer de visa. Il faut tenir éloignés les étrangers, les Occidentaux en particulier, les reporters aussi ; les reporters, surtout…
Non pas parce qu’il vaut mieux qu’ils ne sachent pas, qu’ils ne voient pas l’état de guerre et de panique qui hante Bagdad. Pas seulement… Mais parce que la responsabilité serait trop grande, s’il arrivait quelque-chose. Parce qu’il faudrait rendre des comptes.
Alors, quand on n’a pas de visa, il faut prendre le double risque de rejoindre Bagdad par la route. Il faut entrer en Irak par le Kurdistan, par les aéroports d’Erbil ou de Souleymaniêh. Les Européens obtiennent sans difficulté un permis de séjour à leur arrivée sur le sol kurde. Du Kurdistan, ensuite, on peut gagner Bagdad en voiture, à travers le désert : depuis un peu plus de deux semaines, la route qui relie Souleymaniêh à la capitale est rouverte ; les efforts conjugués des Peshmergas, les combattants kurdes, et de l’armée irakienne, soutenus par les frappes aériennes de la coalition internationale, ont fait reculer les hordes de l’État islamique (EI).
« Les gens commencent à changer leur perception de Daesh [acronyme arabe pour « État islamique en Irak et en Syrie », aujourd’hui renommé « l’État islamique » (EI)]. Hier, ils pensaient que rien n’était impossible aux djihadistes », m’explique Zeyad, un jeune professeur de littérature anglaise originaire de Kirkouk. Je l’ai rencontré par hasard, dans un taxi collectif, entre Souleymaniêh et Erbil : il enseignait aux États-Unis, mais, à cause des événements, il a décidé de revenir en Irak, pour s’occuper de ses parents, de sa mère, kurde, et de son vieux père, sunnite.
Zeyad a ainsi postulé dans une université, à Erbil, où il donne désormais ses cours. « Avant, on croyait que, ce que Daesh voulait, il l’obtenait ; qu’il lui suffisait de le vouloir… Daesh voulait Mossoul, il prenait Mossoul… Même face à l’armée de soixante mille hommes qui défendait la ville. Mais, depuis l’intervention des Américains, on sait que Daesh ne peut pas faire tout ce qu’il veut. Ils font moins peur. Les gens se réveillent du cauchemar. Ils ne tremblent plus devant Daesh : on sait qu’ils peuvent être battus. »
À l’université, où je l’ai accompagné, Zeyad m’a présenté ses collègues du département de langue anglaise ; ils m’ont tenu le même discours : « Nous trois, nous sommes tous de Mossoul ; tous les trois sunnites. Nous avons des amis et de la famille à Mossoul ; ils vivent encore là-bas… Ils ne soutiennent pas les islamistes. Et ils ont de plus en plus l’espoir de les voir s’en aller un jour, peut-être bientôt. Depuis que les Occidentaux ont commencé à attaquer avec l’aviation, Daesh a perdu du terrain ; après que l’armée a réussi à encercler Tikrit [ville située à 150 km au nord de Bagdad], où des centaines d’islamistes sont maintenant pris au piège, c’est la panique, à Mossoul : les combattants de Daesh sont fiévreux, ils se disputent entre eux… Certains commencent à s’enfuir avec l’argent qu’ils ont volé dans la ville ; ils partent se réfugier en Syrie… » Quel crédit accorder à ces propos euphoriques ? Mais il est vrai que l’EI a reculé.
L’EI a reculé. Mais la route de Bagdad est encore incertaine… De longs tronçons ne sont pas surveillés en permanence par l’armée et on parcourt des centaines de kilomètres sans rencontrer âme qui vive. Le risque, c’est de tomber sur une incursion djihadiste ; et de se faire enlever.
Mais c’est aussi d’être contrôler de manière un peu trop zélée à un check-point, par un planton qui réclamerait le visa irakien ; car celui du Kurdistan n’a aucune valeur pour les autorités de Bagdad : le Kurdistan, même s’il rêve d’indépendance et si, dans les faits, il l’a déjà conquise, avec sa propre armée qui n’obéit plus au gouvernement central, c’est encore et toujours l’Irak ! Dans la ville aussi, il faut éviter de croiser même un policier qui règle la circulation : s’il se montrait trop tatillon, on pourrait bien sûr s’arranger en lui glissant quelques dollars américains dans le creux de la main –ici, ce sont des choses qui se font…- ; mais rien n’est jamais certain, et on pourrait tout aussi bien finir en prison, et pour longtemps…
Bagdad : sacs de sable, murs de dalles de béton, juxtaposées, devant les bâtiments, remparts parfois complétés par des miradors, des petites tours édifiées en béton, elle aussi, et munies de meurtrières et de fenêtres de verre blindé… Sur les trottoirs, dans les rues, devant les portes des immeubles, partout, des hommes en armes…
Et, ici et là, dans les quartiers où se concentrent les Chiites surtout [considérés comme hérétiques par les Sunnites et cibles privilégiées de l’EI], des carcasses de voitures calcinées, qu’on ne prend même plus la peine d’évacuer, les éclats de verre des devantures brisées, les fragments de béton des façades criblées, grêlées, qu’on ne déblaie plus et qui jonchent le pavement et obligent le passant à descendre de la bordure : les blessures visibles des attentats à répétition. Pas un jour ou presque, sans qu’une bombe explose quelque part dans la ville : devant une mosquée chiite ou un centre commercial, sur un marché, au passage de la voiture d’un membre du parlement… Le plus terrible, c’est que, sur certains lieux d’attentats, on n’a pas nettoyé le sang, celui des victimes, des blessés, mutilés, celui des morts, qui sèche sur le tarmac en une croûte devenue dur et noirâtre… Les rues se sont vidées. On ne sort que si, vraiment, c’est nécessaire.
« J’ai donné pour instructions à mes employés de ne plus venir au bureau. », me raconte Mawahib, responsable d’une organisation internationale de défense des Droits de l’Homme. « C’est devenu trop dangereux, presque suicidaire… Dans ce quartier [le quartier de Khadimiya, dans la banlieue nord de Bagdad], c’est l’enfer ! Le mois dernier, il y a eu six attentats, là, dans la rue, devant notre immeuble… Six bombes ont explosé dans notre rue, en moins d’une semaine ! C’est comme ça dans toute la ville. Même le quartier de Jadriya n’est plus sûr –c’est le quartier des beaux hôtels, le quartier riche. Il y a des agents de sécurité partout, mais ça ne change presque rien : quand les islamistes veulent frapper, ils parviennent à frapper ; et c’est l’horreur ! Tous les jours… »
La capitale irakienne est aussi en proie aux exactions des milices chiites, qui contrôlent des régions entières de Bagdad et n’obéissent pas toujours aux autorités.
Après un attentat, les vengeances sont monnaie courante ; elles font partie du quotidien, et le gouvernement ferme les yeux sur ces pratiques sauvages, car il sait qu’il a besoin de ces miliciens fougueux et virulents, prêts au martyr, pour défendre la capitale d’une éventuelle attaque de l’EI : surexcités par l’ambiance de terreur et les explosions qui s’enchaînent, les miliciens chiites s’en prennent régulièrement aux familles sunnites ; les lynchages publics ne sont pas rares… qui creusent encore le fossé entre les deux communautés, renforcent la haine… et plongent chaque jour un peu plus le pays dans cette guerre civile larvée et retorse, au-delà du point de non-retour qui a très probablement déjà été dépassé.
« Suivez mon conseil : il ne faut pas s’éterniser à Bagdad. », poursuit Mawahib.« Vous en avez vu assez ! Alors, sauvez-vous ! En plus, c’est de l’inconscience de circuler seul dans Khadimiya ! Un homme blanc ! Ici, il y a beaucoup de Sunnites ; on peut vous enlever n’importe quand : vous disparaissez en quelques secondes et on ne vous retrouve plus. La police ne peut rien y faire. D’ailleurs, tout le monde sait bien que beaucoup de policiers sont complices, par conviction ou pour de l’argent. Il est impossible de savoir à qui on peut faire confiance ; même entre eux, ils ne savent pas à qui se fier. Vous pouvez vous faire ‘arrêter’ par un policier et, en réalité, vous êtes enlevé. »
À Bagdad, on n’ose plus se promener dans la rue, au parc, sortir faire son marché… Mais on ne craint pas une invasion des forces de l’État islamique.
On sait que l’attaque aura lieu. Elle viendra du sud, où l’EI est bien implanté et bénéficie du soutien des populations sunnites. Ou bien de Falloudjah, un des fiefs des islamistes, qui narguent l’armée irakienne depuis les rives de l’Euphrate, à moins de soixante kilomètres de la capitale. Mais les Chiites sont nombreux à vivre dans la capitale, et ils se battront sans merci. Ils n’ont pas le choix.
Alors, c’est sûr : la « Bataille de Bagdad » ne peut pas tourner en faveur de l’EI. Ici, on le sait, on s’en convainc, on l’espère… On essaie d’y croire…
Au Kurdistan irakien : Erbil, Kirkouk, Souleymanieh et Qandil…
 S’il n’y avait ici et là quelques réfugiés, campant ici dans un parc, là dans un immeuble inachevé, on ne se douterait pas que, à quelques dizaines de kilomètres d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, c’est la guerre.
S’il n’y avait ici et là quelques réfugiés, campant ici dans un parc, là dans un immeuble inachevé, on ne se douterait pas que, à quelques dizaines de kilomètres d’Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, c’est la guerre.
C’est moins vrai à Kirkouk, où la communauté sunnite est davantage présente. Près d’une heure de palabre avec l’officier du poste de police qui contrôle les véhicules à l’entrée de la ville : « Tu peux aller à Kirkouk, voir le centre-ville, si tu veux ; tu peux te promener, prendre des photos ; mais rentre à Erbil avant ce soir ! » Ce n’est pas tant la peur des attentats, qui se multiplient ici aussi, depuis quelques semaines ; c’est la crainte d’un enlèvement qui, très visiblement, met l’officier sur les nerfs, à l’idée que je passe la nuit à Kirkouk : « Tous les hôtels sont dans les quartiers arabes ! N’importe qui peut te kidnapper ! Même nous, on ne s’y risque pas, quand ce n’est pas absolument nécessaire ! »
Et, de fait, la ville est sous tension : comme à Bagdad, un peu partout, des gardes armés surveillent les principaux bâtiments ; et le comité des fêtes du quartier chiite, dont les colleurs d’affiche suivent le triporteur qui longe le trottoir, de réverbère en réverbère, pour y accrocher des bannières colorées à l’effigie de l’imam Hussein et de ses fils, sont eux aussi sous haute surveillance, encadrés par des hommes tout habillés de noir, kalachnikov au poing, qui se sont déployés sur le grand boulevard de Bagdad. C’est que, en ce début novembre, la communauté chiite prépare l’Achoura, la commémoration du massacre de Hussein, petit-fils du Prophète Mohamed, que les Chiites considèrent comme son successeur légitime, éliminé avec sa famille par le calife omeyyade, en 680, à la bataille de Kerbala, dans le sud de l’Irak. C’est l’événement fondateur du Chiisme et le début de la querelle qui l’oppose à ses adversaires sunnites. On redoute donc une vague de violence, dans les prochains jours…
Alors que je m’apprêtais à quitter Kirkouk pour Erbil, une explosion a retenti : tout le monde sursaute autour de moi, les visages se crispent, les uns courbent le dos, d’autres s’accroupissent… Les mains sur le crâne… « Non ! Ce n’est rien ! », crie un homme, en agitant la main. « C’est un pneu qui a éclaté… » Les gens se redressent. Tous reprennent leurs activités… L’incident n’est pas oublié pour autant…
Les réfugiés qu’on rencontre à Erbil ne sont cependant pas très nombreux : le gouvernement autonome du Kurdistan irakien se méfie des réfugiés, des familles sunnites principalement ; des éléments hostiles pourraient se cacher parmi eux… Aussi, les Sunnites sont orientés et cantonnés dans les quelques camps de tentes édifiés dans les banlieues lointaines, en dehors de la ville, gérés tant bien que mal par le Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU, toujours en manque de fonds, et quelques ONG internationales qui pallient comme elles le peuvent aux carences onusiennes –c’est qu’il ne faut pas oublier que les déplacés s’ajoutent aux réfugiés syriens déjà présents ; et aussi à quelques centaines de Palestiniens, qui, eux, attendent depuis beaucoup plus longtemps… Pourtant, les Sunnites qui ont fui Mossoul et les régions conquises par l’EI sont plus à plaindre qu’à craindre : il s’agit pour beaucoup d’entre eux de fonctionnaires, d’agents de police, d’employés communaux, considérés par l’EI comme des ennemis à éliminer, des vassaux de Bagdad, des traitres vendus aux Chiites. Ils ont donc été contraints de s’enfuir, avec femmes et enfants.
Plus visibles dans Erbil, les Chrétiens se réunissent autours des églises du quartier d’Aïnkawa, là où se concentre la communauté chrétienne. Les Chrétiens disposent de ressources suffisantes pour donner meilleur asile à « leurs » réfugiés. C’est que, être chrétien, au Moyen-Orient, c’est faire partie d’une « ethnie » à part : quand on est chrétien, on n’est plus vraiment arabe. Les Chrétiens vivent donc repliés sur eux-mêmes. Ils ne sont en outre pas très appréciés, ni par les Kurdes, ni par les Chiites, en Irak, car ils ont toujours recherché la protection du dictateur, Saddam Hussein ; en Syrie, ce sont les Sunnites qui les exècrent, car ils ont finalement choisi le camp de Bashar al-Assad. On reproche ainsi aux églises d’Orient de s’être réveillées un peu tard : « Où étaient-ils, tous ces prélats qui crient aujourd’hui au secours parce que leurs brebis sont égorgées ?! », fulmine un passant avec lequel je m’entretiens. « On ne les entendait pas, lorsqu’al-Assad massacrait son peuple ! » Mais, pour la plupart commerçants, les Chrétiens ne manquent pas de ressources et leur communauté compte aussi nombre d’expatriés qui ont conservé des liens étroits avec leur pays d’origine ; les fonds arrivent donc de partout. En outre, ils peuvent compter sur les ONG « spécialisées » dans l’aide aux Chrétiens, toutes présentes dans le Kurdistan (Ordre de Malte, Œuvre d’Orient, SOS Chrétiens d’Orient, etc.). Cela dit, beaucoup émigrent. Tous ceux qui ont un diplôme s’en vont, aux États-Unis et au Canada, destinations de prédilection ; et le Christianisme disparaît un peu plus encore du Moyen-Orient.
Les plus à plaindre sont sans aucun doute les Yézidis, une population socialement et ethniquement très en marge, depuis des siècles, héritière d’une forme de monothéisme antique, antérieur même au judaïsme, aux origines mal débrouillées encore…
Étrange société que celle des Yézidis, qui ne mangent pas de laitue, ni de chou, par respect pour ces légumes qui, autrefois, rapportent leurs récits traditionnels, auraient permis à un de leurs saints-hommes de se cacher d’un péril dans un champ où poussaient ces végétaux : elle est structurée en castes et, si deux jeunes-gens de castes différentes sont surpris à s’aimer, ils sont discrètement mis à mort ; on y marie aussi les filles à douze ou treize ans et, à l’âge de quinze ans, toutes sont déjà mères de trois ou quatre enfants…
Isolés du reste de la population, les réfugiés de la communauté yézidie s’entassent dans des camps de fortune, misérables, aux portes d’Erbil, sans recevoir vraiment aucune aide.
Du côté du Kurdistan irakien, la ligne de front s’est stabilisée. Les frappes de la coalition internationale ont éloigné d’Erbil la crainte d’une invasion, qui, en septembre 2014, s’était changée en affolement généralisé, lorsque, en quelques jours, les combattants de l’EI avaient progressé jusqu’à n’être plus qu’à une vingtaine de kilomètres de la ville ; beaucoup d’habitants, terrorisés, avaient alors fuit la capitale kurde en direction des montagnes, au nord, ou de Souleymaniêh, au sud-ouest, vers la frontière iranienne.
Le péril est aujourd’hui écarté et le front est mieux organisé, comme je l’ai constaté à Rabia, près de la frontière syrienne, agglomération qui a été reprise à l’EI par les Peshmergas, à l’issue de combat d’une sauvagerie telle que la ville est aujourd’hui presque toute en ruines et vidée de ses habitants : les postes de garde disséminés dans la campagne, front poreux que j’avais parcouru en juillet et que l’EI allait inévitablement enfoncer, ont été remplacés par des lignes de fortifications, qui utilisent les talus des chemins de fer et les canaux, ponctués de fortins, de niches de mitrailleuses, de canons anti-aériens reconvertis pour la guerre terrestre et des quelques chars d’assaut que les Peshmergas ont récupérés lors de la débandade de l’armée irakienne à Mossoul et Kirkouk.
De l’autre côté du rempart de sacs de sable édifié tout le long du canal, on voit distinctement flotter le drapeau noir de l’EI, sur le village de Mesherfa. Mossoul est un peu plus à l’est…
Manifestement, les instructeurs de l’OTAN ont bien travaillé ; et les valeureux combattants kurdes, très à l’aise lorsqu’ils pratiquaient la guérilla dans leurs montagnes, ont su s’adapter à combattre également en plaine rase.
Un doute quant à l’avenir, toutefois : ces positions sont défensives… et les officiers de l’état-major du Kurdistan ont été clair lorsque je les ai interrogés : il n’est pas question, à l’heure actuelle en tout cas, d’attaquer l’EI sur « son » territoire… « Que Bagdad se débrouille ! »
Et puis, le doute, c’est aussi la division qui tiraille le Kurdistan entre les différentes factions politiques qui s’y déchirent et se défient ; et l’imbroglio kurde pourrait réserver bien des surprises…
Le Kurdistan irakien, ce sont tout d’abord deux partis, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’Union patriotique du Kurdistan (UPK).
Le PDK, c’est la formation de l’actuel président du gouvernement autonome du Kurdistan, Massoud Barzani, majoritaire à Erbil. L’UPK, c’est celle de Jalal Talabani, son vieux rival aujourd’hui grabataire, qui a obtenu la présidence de l’Irak, en compensation (avec l’accord des Chiites, qui s’étaient ménagés le poste de premier ministre, qui est le véritable détenteur du pouvoir) ; le fief de l’UPK, c’est Souleymaniêh. Le PDK, c’est le meilleur allié de la Turquie. L’UPK, celui de l’Iran.
La rivalité entre les deux formations est ancienne et avait tourné à la guerre civile, dans les années 1990 : l’UPK avait réussi à s’emparer d’Erbil et progressait ensuite en direction du fief de la famille Barzani, à Salahedine. Massoud Barzani n’avait pas hésité, alors, à appeler à son secours le dictateur irakien, Saddam Hussein, celui-là même qui, moins de dix ans auparavant, avait ordonné à l’armée irakienne de bombarder et gazer plusieurs centaines de villages kurdes en rébellion, un massacre systématique qui s’était soldé par 182.000 victimes civiles. On n’a pas oublié, dans les rangs de l’UPK, que c’est assis sur les chars de Saddam que les combattants du PDK sont entrés dans Erbil reconquise, obligeant leurs adversaires à s’enfuir en Iran.
Aujourd’hui, l’UPK reproche en outre à Barzani et au PDK, pour soigner leurs intérêts familiaux et claniques, de supporter inconditionnellement la politique de leur protecteur, Ankara, au détriment du grand Kurdistan, qui rattacherait les Kurdes de Turquie et de Syrie au Kurdistan irakien, ce à quoi le gouvernement turc est farouchement opposé. Mais on n’évoque pas, en revanche, à l’UPK, la perspective d’un rattachement du Kurdistan iranien…
Puis, le Kurdistan irakien, c’est aussi le Goran (le parti du « changement »), troisième grande formation, dont les leaders se sont séparés de l’UPK, pour en dénoncer la corruption « disaient-ils ». Mais Serdar, qui m’explique tout cela, s’est senti trahi quand les chefs du Goran ont fait alliance avec le PDK : « Tout ce qu’ils voulaient, c’était le pouvoir ! Ils sont aussi corrompus que les autres ! J’avais voté pour eux, mais ils ont trahi deux fois : ils se sont vendus et ils se sont alliés avec des traîtres, avec ce mafieux de Barzani, qui est prêt à vendre le peuple kurde pour les intérêts de sa famille ! Ce sont des mafieux ! Pas comme à l’UPK ! Eux, ceux du PDK, ils n’ont aucun sentiment patriotique ! »
Enfin, il y a les Peshmergas du PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan, d’obédience marxiste).
Je suis allé à leur rencontre, dans leurs repères des montagnes de Qandil, dans le nord, à proximité de la frontière Kurde. C’est une région inaccessible, dont les chemins crevassés d’ornières profondes se perdent en lacets sur les flancs de sommets escarpés. Pas étonnant que ni l’armée irakienne, ni les incursions et les bombardements aériens de l’armée turque n’ont jamais réussi à en expugner la guérilla kurde.
Le PKK se bat pour l’indépendance des régions kurdes de Turquie. Il a le soutien de l’UPK ; ce sont presque des partis frères, idéologiquement aussi. Et, comme à l’UPK, les combattants du PKK ont a de la haine pour ceux du PDK, qui, pour servir Ankara, seraient prêts à se satisfaire d’un Kurdistan au rabais, et à abandonner les Kurdes de Turquie.
Zoran, qui me guide dans le massif montagneux, me conduit d’abord au cimetière de Mohamed Karasungur. C’est comme un lieu de pèlerinage, où sont enterrés les miliciens du PKK morts au combat. Sous les chênes centenaires que l’automne a déjà rougis, disposées en terrasses à flanc de montagne, les tombes blanches s’alignent. Les dates qui sont gravées sur les pierres qui indiquent les sépultures rappellent que l’on n’est pas, ici, dans un endroit où se commémore une histoire passée : 2006, 2009, 2012, 2013…
C’est le lieu de rendez-vous que j’ai pris, avec un groupe de ces paysans-guerriers qui défendent leurs villages depuis des siècles.
En leur compagnie, nous gagnons les villages, hameaux paisibles, grappes de chaumières simples et modestes, couvertes de branchages colmatés de terre et lestés de lourdes pierres, qui s’accrochent sur les pentes de ce paysage grandiose et rude. Il y a des arbres, ici, de grands arbres, qui tranchent avec les buissons malingres et le désert de la plaine irakienne. Les combattants y vivent, chez eux, en famille, le fusil à portée de la main. Ils gardent les moutons, la kalachnikov à l’épaule. Quelques uns, à tour de rôle, se tiennent sur le qui-vive, cachés par la montagne, dans le creux d’une grotte, invisibles mais prêts à bondir sur l’ennemi.
Je rejoins un de ces groupes, là-haut, dans la brume épaisse qui se change en bruine à longueur de journée ; c’est humide et c’est froid. Un guetteur nous attend : en kaki foncé, comme tous les autres, le fusil en bandoulière et un bâton de chêne à la main, la tête couverte du traditionnel djamana, grand carré de laine épaisse et feutrée qui le protège de la pluie, il nous invite à nous asseoir avec ses compagnons d’armes. Les gars entassent le bois, pour cuire le casse-croûte de la mi-journée. Quelques branches arrachées à un vieil arbre déraciné, qui s’embrasent à la flamme des feuilles mortes et de la bouse de vache séchée ramassées pour allumer le feu. C’est le quotidien, éternel, de ces veilleurs des Monts de Qandil.
Dans un des villages, je suis tombé sur une étrange bonne femme : Monica.
Monica est allemande. « Plus maintenant : depuis longtemps, je suis kurde ! », proteste-t-elle en riant. « Ici, tout le monde m’appelle Midya ; c’est mon nom kurde. » Elle a rejoint le PKK au début des années 1990. Elle avait vingt-huit ans et venait d’achever ses études de médecine, à Hambourg. « Je suis venue pour la première fois au Kurdistan avec des amis Kurdes, qui habitaient en Allemagne. Ils m’avaient parlé de ce pour quoi ils luttaient et j’ai eu l’envie de venir voir. J’ai été très émue par ce qui se passait ici et, deux ans après, j’ai décidé de revenir ; mais pour rester, cette fois. »
– Pourquoi ?
– Pourquoi pas ?
– Parce que vous auriez pu avoir une vie confortable, en Allemagne, avec votre famille, avec vos amis. Parce que vous auriez pu faire une belle carrière comme médecin… Parce que votre culture est allemande.
– J’ai vu des enfants blessés par les attaques des Turcs. J’ai aussi été très choquée de voir les armes qu’utilisaient les Turcs : elles étaient fabriquées en Allemagne ! Je n’étais pas communiste. Pas au début en tout cas… Ensuite, j’ai compris que la cause était juste ; et ça rempli une vie de se battre pour une cause juste. Moi, ici, je soigne les enfants et les soldats, j’accouche les femmes, je me bats contre la maladie et les blessures… Mais j’ai connu des femmes plus courageuses que moi !
– Et vos parents, comment ont-ils réagi ?
– Au début, ils étaient effrayés. Après, ils ont compris ; et ils sont devenus très fiers. Ils sont tous les deux morts, maintenant.
Monica me fait entrer dans une petite maison, que les villageois ont bâtie pour elle, m’explique-t-elle. « C’est chez moi, ici, maintenant. Eux, ils sont ma famille. »
Je remarque quelques photographies d’enfants, parmi lesquelles se trouve celle d’une jeune femme, de type européen, en uniforme du PKK : « C’est vous, quand vous êtes arrivée au Kurdistan ? »
– Non… C’est Andrea… Andrea Wolf. Elle a été tuée en 1998. Elle était allemande, elle aussi. Les Turcs l’ont capturée dans la montagne, avec son unité. Ils ont tous été exécutés. Elle, ils lui ont coupé les seins. On l’a retrouvée comme ça. On ne sait pas s’ils lui ont fait ça avant de la tuer, ou après… Elle était socialiste. C’est pour ça qu’elle était venue ici. Ici, c’est le vrai socialisme ; on partage tout et on décide tous ensemble… Les enfants, ils sont morts aussi. Celui-là, je l’avais mis au monde. Mais leur maison a été bombardée, très tôt, un matin, quand ils dormaient encore…
Monica ne me dit pas tout. Pas tout à fait… Elle a rencontré quelqu’un, dans la guérilla… Mais il a disparu, dans la montagne. On n’a jamais retrouvé son corps. Aujourd’hui, proche de la soixantaine, Monica s’émeut encore vivement, lorsqu’elle évoque cet homme, devenu souvenir. Elle ne me dira pas son nom…
Rojava, le Kurdistan syrien
 Iohanna m’attend de l’autre côté du Tigre, que je traverse sur une barque de pêcheur. Il est un peu en avance et me fait de grands signes depuis la berge, pour me souhaiter la bienvenue en Syrie.
Iohanna m’attend de l’autre côté du Tigre, que je traverse sur une barque de pêcheur. Il est un peu en avance et me fait de grands signes depuis la berge, pour me souhaiter la bienvenue en Syrie.
Le destin de ce garçon de vingt neuf ans est à proprement parler « fantastique », et il mérite d’être raconté, tant il résume à lui seul les tourments de cette région du Moyen-Orient.
Alors qu’il n’avait pas encore deux ans, il a été séparé de sa famille lors d’un bombardement, sur un quartier de Beyrouth. C’était durant la guerre civile libanaise. Recueilli par un soldat syrien qui faisait partie de la force déployée par Damas au Liban, il a été emmené en Syrie et déposé dans un orphelinat. Plus tard, une riche famille de commerçants kurdes sunnites l’a adopté. Ses nouveaux parents, qui ne pouvaient pas avoir d’enfant, lui ont donné une bonne éducation, en l’inscrivant dans une école chrétienne orthodoxe.
– Pourquoi ? Ils voulaient te donner une éducation chrétienne, pour respecter ta religion d’origine ?
– Non ! Ce n’est pas ça… C’était une école privée, réputée plus performante que l’enseignement de l’État.
Quand il a eu dix-neuf ans, alors que son père était déjà décédé, sa mère lui a révélé ses origines.
À l’orphelinat, Iohanna retrouve l’identité du soldat qui l’y avait emmené. De fil en aiguille, avec l’aide du pope de la paroisse de Beyrouth où il avait été trouvé, il identifie ses parents biologiques : sa mère est médecin et son père est employé de banque ; il découvre qu’il a deux frères… Mais Iohanna n’a pas voulu rencontrer sa famille libanaise ; ils ne savent pas qu’il est vivant.
– C’est important, mais pas nécessaire, m’a-t-il déclaré.
Aujourd’hui, Iohanna est kurde…
À Rojava comme en Irak, c’est le pétrole, encore une fois aussi simplement, qui constitue le nœud principal de la question kurde.
« Rojava » ; c’est par ce nom que l’on désigne les trois cantons kurdes du Kurdistan syrien, tous adossés à la frontière turque : la Jazeera, région située dans l’extrême nord-est de la Syrie et frontalière avec la Turquie et l’Irak ; le canton de Kobanê, plus à l’ouest ; et celui d’Afreen, au nord-ouest d’Alep.
Quand les troubles se sont intensifiés en Syrie, une force armée s’est imposée dans le Rojava : l’Unité de Protection du Peuple (YPG), plusieurs milliers d’hommes, vingt mille probablement, voire plus, qui ont jusqu’à présent réussi à sécuriser et défendre le Rojava et tiennent le coup face aux attaques de l’EI désormais concentrées sur Kobanê. C’est également l’YPG qui, par une alliance de circonstance avec les Peshmergas du PDK, est entré en Irak et a poussé son offensive contre l’EI jusque dans les Monts Sinjar, pour protéger les populations yézidies qui s’y étaient réfugiées.
Souvent considérée comme la branche armée du Parti de l’Union démocratique (PYG – le mouvement des Kurdes de Syrie, très lié au PKK et allié de l’UPK), il s’agit plus exactement d’une milice, véritable petite armée, qui, bien que ses combattants soient majoritairement kurdes, rassemble aussi des Chrétiens syriaques et des Arabes sunnites de la région.
Le commandement du YPG ne dépend donc pas du PYG, qui, avec le PKK et l’UPK, souhaiterait le rattachement du Kurdistan syrien au grand Kurdistan, mais bien d’un Conseil législatif du Rojava, pluriethnique et confessionnel, qui rassemble dix-huit partis et organisations civiles et s’est érigé en gouvernement autonome du Kurdistan syrien depuis novembre 2013. Ce Conseil législatif promeut l’idée d’une Syrie confédérale dans laquelle le Rojava aurait sa place en tant qu’entité fédérée, avec l’intention de partager la manne pétrolière avec le reste du pays ; l’UPK, qui en fait partie, a accepté cette perspective, jusqu’à présent…
Car la majeure partie des puits de pétrole syriens sont en effet situés dans la Jazeera ; et la question de leur exploitation illustre probablement mieux que tout autre exemple pourrait le faire les tensions qui existent entre le PDK et les autres mouvements kurdes.
Le pétrole du Rojava ne pouvant plus être commercialisé via la Syrie, deux solutions existent pour le Conseil législatif : la Turquie ou, via le Kurdistan irakien, l’Iran.
La solution turque est d’emblée exclue. Ankara, en effet, craint la création du grand Kurdistan, qui lui enlèverait les régions kurdes de Turquie où s’active le PKK, mais, surtout, qui lui ferait perdre le contrôle partiel qu’elle exerce sur le pétrole du Kurdistan irakien. Le projet de l’UPK et de ses alliés du PKK et du PYK, dans le cadre du grand Kurdistan, c’est la construction d’un oléoduc qui, à travers le Rojava, aboutirait aux régions de Syrie majoritairement alaouites, c’est-à-dire à la côte et aux ports de Latakieh et Tartous, en Méditerranée. Autrement dit, ces mouvements sont prêts à une alliance avec le régime syrien, fût-ce dans le cadre d’une Syrie alaouite restreinte, projet parfois évoqué à Damas. L’oléoduc contournerait dès lors la Turquie et l’exclurait du jeu pétrolier du Kurdistan.
C’est pourquoi la Turquie tente à tout prix d’étouffer le Kurdistan syrien et, comme à Kobanê, le laisse se défendre seul face à l’EI.
L’autre solution, c’est l’Iran. Le pétrole du Kurdistan irakien, principalement localisé dans la région de Kirkouk, est ainsi partagé entre les hommes d’influence liés au PDK et ceux de l’UPK et acheminé par leur entremise, respectivement, jusqu’à la frontière turque ou celle de l’Iran. Le pétrole de l’UPK qui passe en Iran est ensuite écoulé via le Golfe persique. Tout cela, bien sûr, au grand dam de Bagdad, qui a perdu toute forme de contrôle sur cette ressource nationale.
Le Pétrole de la Jazeera pourrait donc suivre le même chemin que celui de l’UPK, vers l’Iran.
Mais ce serait sans compter sur l’alliance qui unit Ankara et le PDK, dont les forces dominent le nord-ouest du Kurdistan irakien et contrôlent la frontière avec le Kurdistan syrien, interdisant toute importation de pétrole de la Jazeera.
Ce qui n’empêche pas, d’un autre côté, des potentats liés au PDK de s’enrichir en important au Kurdistan du pétrole en provenance des zones tenues par l’EI, qui est ensuite expédié en Turquie…
Ankara ferme effectivement les yeux sur le trafic d’hydrocarbures incessant organisé par des hommes d’affaire turcs, qui achètent le pétrole détourné par l’EI dans la région de Mossoul. Le Califat vend l’or noir au rabais à ces trafiquants, à un prix défiant de loin toute concurrence, et ces derniers le déversent ensuite sur le marché international, alimentant le marché noir par ce blanchiment d’un or sale et accumulant pour eux-mêmes de surprenants bénéfices…
L’opération n’a rien de virtuel ; elle demande une logistique très concrète, et ce sont des centaines de camions-citernes qui, chaque jour, effectuent plusieurs allers-retours en un ballet continu, entre l’État islamique et la République de Turquie, et via le Kurdistan irakien… Les cheik-points tenus par les Peshmergas du PDK, face à l’EI, reçoivent d’Erbil l’ordre de « laisser passer » tel ou tel… Quant aux douanes et à l’armée turques, déployées aux frontières, elles enregistrent l’entrée de pétrole « kurde »…
Au bas mot, l’EI engrange journellement des revenus qui approchent un minimum de un million de dollars américains –oui, chaque jour ! Les experts du Département du Trésor, à Washington, estiment même des pointes quotidiennes à 3 millions de dollars !
Sans ambiguïté aucune, donc, l’État turc, aux mains de l’AKP (le parti islamiste « modéré » du président Recep Tayyip Erdogan et de son premier ministre Ahmet Davutoglu), tout en palliant au déficit énergétique récurrent que connaît son pays, finance très directement les djihadistes du Califat et, de fait, supporte de facto l’effort de guerre de ses ramifications internationales, qui, dans les capitales arabes et occidentales, se sont déjà adonnées à plusieurs faits de terrorisme.
Ankara et le PDK n’hésitent donc pas à enrichir l’EI, qui se fournit en armement avec l’argent du pétrole, et ce tandis que les Peshmergas meurent sur la ligne de front et que le président Barzani appelle la Communauté internationale à se porter au secours du Kurdistan.
Il y a donc deux guerres en cours au Kurdistan irakien : celle que l’on mène dans la chaleur moite du désert, à coups de canon, et celle que l’on se fait dans les salons feutrés des grands hôtels d’Erbil. Les intérêts en sont divergents.
« Business is business ; money is money ! »
Kobanê
 C’est à présent que commence « l’aventure »…
C’est à présent que commence « l’aventure »…
– Les Arabes sunnites, d’ici à Kobanê, supportent l’EI, me dit Iohanna. On ne peut faire confiance à personne. C’est très compliqué…
La route la plus sûre, pour gagner Kobanê depuis le Kurdistan, c’est de passer en Turquie et d’en longer la frontière, à l’abri d’une éventuelle attaque des combattants de l’État islamique.
Certes, nous avons tenté de procéder de cette façon ; entre la Syrie et la Turquie, la frontière est longue et, auparavant, elle était relativement poreuse… Mais, depuis l’avancée de l’État islamique, Ankara a pris des mesures drastiques pour assurer le contrôle de son territoire ; et les anciens points de passages clandestins sont dorénavant fermés, pour le malheur des passeurs et contrebandiers (souvent les mêmes personnes) qui se retrouvent maintenant « au chômage ».
– Mais… Pourquoi n’entres-tu pas en Turquie « légalement », par un poste frontière ?!, me demande Iohanna, intrigué et suspicieux. Toi, s’exclame-t-il, avec ton passeport belge, tu peux entrer et sortir de Turquie comme tu veux ! En Turquie, nous avons des amis, qui t’aideront à rejoindre Kobanê.
« Suspicieux », il a raison de l’être… Et, en effet, je luis dois une petite explication…
Je lui raconte donc comment, en avril 2013, alors que j’effectuais un huitième séjour en Syrie depuis le début des troubles, j’avais été enlevé par une faction islamiste, comment j’avais été détenu cinq mois en otage avec un collègue et ami, journaliste au quotidien italien La Stampa, et comment, en Belgique, lorsque ma famille avait déclaré ma disparition, après plusieurs jours sans aucune nouvelle de ma part, les autorités s’étaient mis en tête que j’étais parti faire le djihad, comme tant de jeunes Belges d’origine arabo-musulmane ou convertis à l’Islam…
Tandis que Iohanna s’amusait de cette absurdité, je lui ai décrit le désarroi et l’émoi de mes vieux parents, qui avaient cru trouver appui et assistance auprès de la magistrature de leur pays et des forces de police, mais, tout au contraire, se heurtaient à la bêtise crasse d’un système d’une incroyable stupidité : sur ordre du parquet, mon appartement, à Bruxelles, avait été perquisitionné ; puis, ce fut le tour de ma propriété à la campagne. Lorsque ma mère, scandalisée par le caractère odieux de la procédure, avait protesté, un policier l’avait menacée d’une arrestation administrative.
J’avais découvert et appris tout cela à mon retour.
Mais ce n’était pas tout : en juillet dernier, comme je revenais d’Irak en Belgique, transitant par Istanbul, j’avais décidé de faire escale en Turquie, le temps d’une soirée, pour y rencontrer le correspondant de notre rédaction.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je présentai mes documents d’identité au guichet de contrôle des passeports !
Le préposé, après m’avoir dévisagé d’un air presque terrorisé, s’est rué sur un téléphone ; quelques instants plus tard, deux gendarmes m’emmenaient dans un bureau fermé où je subissais une fouille sans ménagement. J’y restai en garde à vue, sans qu’on m’en signifiât le motif, sinon la « raison d’État », et ce jusqu’à ce qu’un agent de la sécurité de l’aéroport Atatürk me conduisit au premier avion qui s’envolait pour Bruxelles.
Le type me surveilla durant toute la durée du vol et, arrivé à destination, c’est accompagné de cette escorte que je fus conduit au commissariat de police de l’aéroport de Bruxelles-National, où, allant d’étonnement en stupéfaction, on me confisqua tous mes papiers, mes notes, et mon ordinateur, que je ne réussis à récupérer qu’après avoir appelé un ami, membre du barreau, avec le téléphone portable que j’avais pris soin de dissimuler lorsque les policiers m’avaient ordonné de vider mes poches : lorsque, m’avançant vers la porte de la pièce où on m’avait assigné, je brandit l’appareil, exigeant que l’un d’entre eux répondît à « mon avocat », les gars, soudainement devenus blêmes, me restituèrent mes effets et me congédièrent sans autre forme de procès…
En dépit de plusieurs courriers adressés tant à l’Ambassadeur de Turquie à Bruxelles qu’au ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders (celui-là même qui avait systématiquement freiné toutes les initiatives de ses collègues et subordonnés ayant visé à favoriser ma libération lorsque j’étais otage en Syrie), courriers tous restés lettres mortes, j’ignore toujours le fin mot de cette histoire démentielle.
Peut-être, selon l’hypothèse d’un ami employé au ministère de l’Intérieur, mon nom aurait-il été transmis à l’État turc par le gouvernement belge, inscrit sur une liste de « djihadistes potentiels » à ne pas laisser entrer sur le territoire de la Turquie, destination de transit généralement choisie pour gagner la Syrie. Grosse boulette, résultat d’une incompétence crétine, que, manifestement, personne ne tiendrait vraiment à assumer…
Quoi qu’il en soit ce pataquès me complique la tâche et m’oblige à prendre des risques importants pour réaliser mes reportages ; surtout, l’attitude inconséquente du ministre concerné me met réellement en danger.
Ainsi, rejoindre Kobanê, s’en approcher et essayer d’y pénétrer ne sera pas facile… et particulièrement périlleux ; traverser les zones aux mains de l’État islamique depuis la frontière irakienne pour gagner Kobanê et Alep est en effet plus aléatoire que de prendre un bus à Antakia et, même si la compréhension du terrain en valait l’expérience, peut-être le risque était-il trop grand à courir…
Les territoires désertiques qui séparent le canton du Kurdistan situé le plus à l’est et la ville assiégée de Kobanê ne sont pas hermétiques : ce sont de vastes plaines, de la poussière et du sable à perte de vue, parcourues de pistes en tous sens que les forces de l’État islamique, qui se sont emparées de la région qu’elles occupent jusqu’à la frontière turque, ne peuvent pas contrôler en permanence, d’autant moins qu’elles ne disposent d’aucun moyen aérien.
Il est donc possible, par petits groupes, de rejoindre Kobanê et, sinon d’entrer dans l’enclave encerclée par les islamistes, de l’approcher, au moins, et de gagner une des poches encore tenues par l’YPG, un des hameaux où les combattants de Rojava continuent de résister.
Le voyage doit s’effectuer de nuit et le plus rapidement possible. Le groupe va ainsi parcourir plus de trois cents kilomètres de pistes rocailleuses en quelques heures, à vive allure, pour tenter de rejoindre une bourgade dont on me demande de ne pas révéler le nom.
Deux jeunes filles nous accompagnent, Helin et Ranyê. « Est-ce vrai que vous faites peur aux djihadistes ? Qu’ils s’enfuient en vous voyant, parce que pour eux, être tué par une femme, ça signifie qu’ils n’iront pas au Paradis ? » Helin sourit timidement : « Bien sûr que non… C’est une légende… » Il y a aussi Sinan ; il est turc, d’Istanbul : ses études de sociologie terminées, il a décidé de rejoindre l’YPG, par idéal. « Je suis venu les aider. J’ai honte de ce que mon pays fait subir à ces gens… Il y a beaucoup d’autres étrangers venus combattre ici. Des Turcs comme moi, mais aussi quatre Américains, dans notre secteur ; et des Français, des Espagnols, surtout des communistes… » Sinan a belle allure ; ça ferait une bonne photo, mais il refuse : « C’est très dangereux, pour moi ; si la police turque… Tu comprends ? »
Et Nowres, un garçon de dix-neuf ans, qui rit toujours. Il était vendeur dans un magasin de chaussures, et il a décidé de s’engager : il s’est présenté au bureau de l’YPG de son bled ; on lui a donné une formation, un bon entraînement, m’assure-t-il. Puis, il a connu sa première bataille. C’était à Tell Amedan : « J’étais effrayé, parce que ça explosait partout autour de moi. En plus, Daesh a mis le feu à la ville, pour nous en faire partir. Mais on a tenu le coup et, heureusement, il n’y a eu aucun tué dans mon groupe. »
Peu après le crépuscule, j’embarque à l’arrière d’un véhicule dont toutes les sources de lumière intérieures ont été recouvertes d’une épaisse bande adhésive noire. Auparavant, dans l’après-midi, Idriss et Lowand ont badigeonné à la brosse le pick-up Toyota blanc, de terre beige mélangée à de l’eau ; il se confond désormais avec la couleur du désert.
Idriss me prête un foulard et me montre comment m’en envelopper le visage, pour m’éviter de manger la poussière que le pick-up, dans sa course, soulève en épaisses volutes qui auraient été visibles de très loin si, très heureusement, la lune ayant déjà presque complètement décru, notre équipée n’avançait protégée par une nuit noire, à peine transpercée de quelques rayons blafards qui nous laissent distinguer dans la pénombre les méandres du chemin. Parfois, la piste disparaît : il ne s’agit souvent que d’une évocation, vestiges presqu’effacés des traces d’un précédent véhicule, que le vent peut recouvrir sans qu’il n’en reste rien de visible. Alors, Lowand se guide au moyen d’une boussole et, après quelques instants, la piste réapparaît, à droite ou à gauche de notre trajectoire, et nous en reprenons le cours.
Le pick-up fonce dans l’obscurité, mais le terrain est accidenté, les ornières sont nombreuses et l’on rencontre régulièrement des ravines asséchées, qui nous obligent à ralentir notre course. Parfois, il faut s’arrêter et attendre : à la moindre suspicion de la présence de l’ennemi, à la moindre lueur devinée dans le lointain, qui trahirait une menace, il faut couper le moteur et patienter, scruter cet horizon si largement ouvert, à peine respirer et écouter, se taire, car le silence du désert porte loin même un chuchotement.
Ce n’est qu’à l’aube que nous atteignons notre destination, dans le fracas des tirs de mortiers et le grondement de l’artillerie, beaucoup plus meurtrière, dont disposent les combattants de l’EI. Le village, dont il ne reste déjà plus que des ruines dans lesquelles se terrent les combattants, est sur le point de tomber aux mains des djihadistes…
Les bancs de brume du petit matin se sont déjà dissipés, remplacés par la fumée des explosions et la poussière des maisons de terre pulvérisées par les obus de l’artillerie. Le pick-up est abandonné et nous nous faufilons, sac au dos, jusqu’à la courte ligne de front défendue par les gars du YPG, mal abrités derrières des moignons de murs, tout ce qu’il restera de ce bled perdu.
Ce que nous découvrons-là est abominable : une quinzaine de combattants, au plus, tentent de repousser les assauts des islamistes, qui ne sont plus qu’à quelques ruelles de notre position. Seule la route du sud, par laquelle nous sommes arrivés, est encore ouverte… pour évacuer la place.
Mais le commandant est désemparé : allongés sur le sol, alignés dans la poussière, parfois adossés à la parois de terre, l’un ou l’autre comme enchevêtrés, douze blessés gisent, couverts de sang ; huit d’entre eux sont blessés aux jambes, très gravement, désespérément… Un des gars a les genoux broyés… On ne pourra pas les évacuer, ceux-là ; il faudra les abandonner à « Daesh ». Le commandant ne veut pas s’y résoudre. Il veut tenir la place. Parce qu’on lui a annoncé une escouade, en renfort, dix hommes, peut-être plus, qui doivent bientôt arriver d’une autre position, toute proche…
Du coup, Rebin décide de rester là, lui aussi, avec ses gars.
Qu’est-ce que je suis venu faire dans ce piège, qui est entrain de se refermer sur eux… et sur moi ?
Pendant près de trois heures, ces types vont s’accrocher à ce paquet de ruines, sous le bombardement intense et suivi de l’artillerie ennemie ; Rebin estime le nombre de batteries qui nourrissent ce roulement de feu à huit ou neuf pièces ; eux, ils n’ont rien pour répondre. Comme toujours, l’EI est mieux équipée que les résistants du YPG… Rebin, c’est celui qui commande notre groupe. Hier, il m’a raconté son dernier exploit : comment il a attaqué en embuscade un pick-up de l’EI, près de Rabia. Avec une quinzaine de ses hommes, ils se sont étendus dans les fossés, de part et d’autre de la route. À l’approche du véhicule, ils ont ouvert le feu à la mitrailleuse. Résultat : douze djihadistes tués. Puis, deux autres pick-up sont arrivés en renfort. Ils les ont fait sauter tous les deux, au RPG (lance-roquette).
Les mortiers continuent de tomber. Jusque là, on a eu de la chance : l’ennemi tir trop long…
Mais c’est devenu un non-sens ; c’est sans espoir et c’est toute l’unité qu’un entêtement forcené met désormais en péril : les islamistes se rapprochent beaucoup trop… et trop vite. Les renforts ne viennent pas. Le commandant va prendre la décision qu’il redoutait : quitter le bled.
C’est à ce moment-ci que je suis témoin d’un des épisodes les plus apitoyants que j’aurai vécus depuis trois ans et davantage, que je parcours en tous sens la Syrie en guerre…
Rebin et le commandant échangent quelques mots ; Rebin lance un regard comme gêné à l’intention de Iohanna, qui, à son tour, tourne vers moi son visage, confus, et détourne aussitôt ses grands yeux de cristal, couleur d’ambre sombre et translucide, à présent tout embués. Les deux hommes s’approchent des blessés et s’entretiennent un bref instant avec chacun d’entre eux. Ils opinent de la tête ; certains se prennent les mains et s’embrassent… C’est entendu : il ne faut pas tomber aux mains de « Daesh » ; quand des combattants de l’YPG sont pris, il y a parfois des échanges de prisonniers. Mais c’est rare ; en vérité, c’est exceptionnel. Les islamistes prennent leur revanche sur les farouches défenseurs de Rojava ; et ils les exécutent après leur avoir fait subir les pires tortures. Les gars ont tous des grenades, accrochées à leur ceinture… Ils étaient onze garçons et une fille.
Nous emportons les deux mitrailleuses et les quelques boîtes de munitions qui restent encore ; malgré mon paquetage beaucoup trop lourd dont les sangles me lacèrent les épaules, j’empoigne deux magasins, et nous nous éloignons, en direction de l’endroit où Rebin a laissé le pick-up.
Trois ou quatre minutes plus tard, j’entends, si proche, les explosions qui se succèdent en quelques secondes.
Le plus atroce, ce fut quand, quelques instants après, trois ou quatre minutes –quelques instants seulement, à peine-, nous sommes tombés nez-à-nez avec la dizaine d’hommes –et de femmes- que le commandant attendait. Les renforts…
Rebin a crié ; il a pleuré. Les larmes coulaient sur son visage couvert de poussière et la salive tombait de sa bouche. Cet homme dur, qui savait la guerre… C’est à cet instant, piteux, avec mes deux magasins à munitions qui balancent au bout de mes bras, que je me rends compte que je ne suis que le témoin impuissant de cette histoire ; pas un acteur…
Inutile d’insister ; nous n’entrerons pas dans Kobanê.
Je tourne la tête ; dernier coup d’œil avant de poursuivre ma route… Les panaches de fumées s’élèvent en tous lieux. Les civils aussi versent leur tribu à la guerre, et pas seulement à cause des bombardements de l’EI…
On n’en parle jamais guère dans les médias européens ou états-uniens… Mais, depuis le début des frappes de la coalition internationale sur les positions de l’EI en Syrie, les « dégâts collatéraux » se multiplient, et il ne s’agit pas seulement d’une ou deux victimes ici ou là : depuis le 23 septembre dernier, ce sont plusieurs dizaines de civils qui ont été tués par l’intervention internationale, un nombre encore mal défini ; principalement à ar-Raqqa et à Deir ez-Zor et, à présent, à Kobanê également, et ce pour un gain stratégique, sur le plan militaire, qui se rapproche de zéro.
En effet, si les frappes ont pour le moment arrêté la progression des combattants de l’EI qui avançaient en plaine vers Erbil, à découvert, elles se sont en revanche révélées complètement inefficaces en milieu urbain, où les djihadistes, déployés en petits groupes très dispersés à travers les quartiers d’habitation, ne peuvent être ciblés ni précisément, ni utilement. Est-il judicieux de tirer un missile sur une zone résidentielle depuis le ciel pour essayer d’éliminer trois islamistes repérés au sol ?
Alep
 Alep. Bientôt… Cela fait tout juste deux ans que je n’ai pas revu la ville…
Alep. Bientôt… Cela fait tout juste deux ans que je n’ai pas revu la ville…
Si. J’en avais traversé la banlieue, en août 2013 ; mais j’étais alors prisonnier des Brigades al-Farouk, qui me détenaient comme otage. C’était quelques jours avant d’être libéré…
À l’approche de la ville, je suis inquiet. Le danger est très grand : les islamistes sont partout ; j’espère qu’Adnan et ses hommes ont bien reçu mon message. J’ai confirmé mon arrivée hier soir, mais il n’a pas répondu.
Le pick-up quitte la route, s’engage dans la cour d’une ferme délabrée et s’immobilise. Les exploitants sont partis ; une katiba de l’Armée syrienne libre (ASL) y a établi ses quartiers. « C’est ici ! », me crie Lowand ; et je saute en bas de la benne.
Adnan est au rendez-vous… Je suis soulagé.
Je l’avais rencontré en 2012, à l’état-major de l’ASL. Il a vieilli ; il a les traits tirés, le teint gris. Il porte la barbe, désormais ; et j’ai peine à reconnaître le jeune homme de vingt-cinq ans, tout fringant, qui ne tarissait pas d’optimisme sur la grande aventure révolutionnaire qui allait transfigurer son pays.
Le régime gagne du terrain. Depuis plusieurs mois, depuis que l’État islamique occupe tous les esprits, en Europe et aux États-Unis, plus aucun média ne parle de la Syrie, sinon pour commenter les frappes de la coalition internationale. Mais la guerre se poursuit, à huis clos, et l’armée de Bashar al-Assad redouble ses efforts pour reprendre aux rebelles les zones « libérées ».
Adnan me conduit d’abord à Douer al-Zeitoun, un village que je connais bien, dans le rif d’Alep, à une petite dizaine de kilomètres de la ville : c’est là que, en 2012, je m’étais entretenu à plusieurs reprises avec le colonel Ahmed Jabbal al-Okaidi, le commandant en chef de l’Armée syrienne libre à Alep. Mais, cette fois, l’endroit est désert. Le quartier général du colonel a été déplacé depuis longtemps ; et il ne cesse de se replier, de villages en hameaux…
Douer al-Zeitoun ne sera donc qu’une étape, pour y attendre la confirmation que la route est sécurisée, vers une autre destination : Handarat, une grosse bourgade où ont lieu d’intenses combats.
C’est une position stratégique, réellement, car le village contrôle le couloir qui relie Alep à la frontière turque et l’armée syrienne n’est plus très loin d’en chasser les rebelles –j’apprendrai quelques jours plus tard la chute d’Handarat… et des villages voisins de Sifat et Moudafah.
L’armée gouvernementale se garde bien d’affronter les katiba de l’EI qui se sont emparées d’une partie du terrain tenu jusqu’alors par l’ASL ; et l’EI, comme si un accord tacite avait été passé avec Damas, ne s’en prend pas non plus aux positions de l’armée régulière, à Alep en tout cas.
– Daesh et Assad ne sont pour nous qu’un seul et même ennemi, m’explique un des combattants, que je ne connais pas. Ce n’est plus un secret, que le régime a libéré ces types des prisons, ces fanatiques, et les a laissé créer leur milice radicale pour donner au monde une image négative de notre révolution, qui était pacifique au début, et qui demandait seulement la liberté… Le régime a parrainé ces extrémistes ; c’est pour ça qu’il ne les bombarde pas. Au contraire, quand nous lançons une offensive contre Daesh, le régime nous frappe pour ralentir notre progression. À l’état-major, nous sommes persuadés qu’il existe des contacts entre l’armée et Daesh et qu’ils coordonnent leurs opérations. Bien sûr, quand le régime en aura fini avec nous, il règlera son sort à Daesh… Assad va rester ; nous… nous avons perdu…
Aussi, l’ASL est-elle seule face à l’EI qui progresse dans le sud et l’est d’Alep, tandis que les forces gouvernementales l’attaquent par le nord ; un étau qui se resserre peu à peu… Les troupes du régime ont ainsi presque entièrement reconquis le nord du gouvernorat et essaient à présent d’achever l’encerclement de la ville d’Alep en avançant vers l’ouest, pour couper la route vers la Turquie et empêcher toute retraite des combattants de l’ASL et l’approvisionnement des quartiers qu’ils contrôlent. C’était tout l’enjeu de la bataille d’Handarat…
La route est longue jusqu’à Handarat ; car il faut suivre à travers le rif les méandres des pistes et des sentiers, pour éviter les barrages de l’armée régulière. Nous y rejoignons les derniers défenseurs encore vivants.
Adnan, Iohanna, quelques hommes épuisés, courbés… Sur fond du roulement de l’artillerie gouvernementale et des sifflements des obus de mortier qui s’abattent sur les ruines du village, nous nous accroupissons autour d’un feu sur lequel ronronne une théière. Il fait froid. Le soir tombe ; et avec lui, la rosée, l’humidité. « C’est trop pour nous, trop dur, trop de forces contre nous », me lance soudainement Adnan, qui était resté muet depuis mon arrivée. Adossé à un mur de pierres dont le mortier, lépreux, s’effrite et recouvre son blouson, il soupire. « Les soldats d’al-Assad ne sont pas seuls. Dans le sud, ils sont aidés par le Hezbollah. Ici, il y a des brigades iraniennes avec eux, et aussi des brigades chiites, qui sont récemment arrivées d’Irak. Et puis aussi quelques soldats russes. On en a tué plusieurs… »
Comme à chacun de mes séjours en Syrie, en compagnie des combattants de la rébellion, je constate le même manque de moyens, l’absence d’armes lourdes, qui leur font cruellement défaut, les kalachnikovs usées par trois ans de guerre, réparées parfois, rafistolées plus exactement, avec ce qu’on peut encore trouver. Plus même une simple grenade à main ; désormais, ils ne disposent plus guère que de bombes artisanales, des bouteilles et canettes à soda, emplies de poudre noire, de boulons, de clous, de déchets de métaux, dont il faut allumer la mèche avec un briquet avant de lancer.
– C’est la raison pour laquelle l’ASL d’Alep n’a pas envoyé d’aide à Kobanê ?, demandé-je.
– Pas du tout !, intervient un officier de l’état major qui nous accompagne. Une cinquantaine d’hommes sont déjà partis pour Ayn al-Arab [dénomination arabe de Kobanê, nom kurde de la ville].
– Oui, je sais… Cinquante hommes… Excuse-moi, mais… C’est très peu ; c’est symbolique, mais c’est inutile…
– Le colonel al-Okaidi était d’accord d’envoyer plusieurs centaines d’hommes. On a même parlé de rassembler 1.300 combattants pour secourir Ayn al-Arab. Mais ce sont les Kurdes qui n’ont pas voulu. On avait l’accord des Turcs pour traverser la frontière et entrer dans Ayn al-Arab. Mais c’est le porte-parole des Kurdes qui a dit non : ils ne veulent pas de l’aide de l’ASL ; ce qu’ils veulent, c’est que les Turcs leur fournissent des armes. Ils ne veulent pas non plus l’aide des Peshmergas d’Irak…
– Tu sais bien pourquoi, intervient à son tour Iohanna. La Turquie est trop liée à l’ASL et elle contrôle les Peshmergas du PDK. Ce ne sont pas les Kurdes qui ont dit non, mais l’YPG, parce qu’on sait bien ce qui va se passer si l’ASL et le PDK prennent le contrôle de Kobanê : ils vont imposer les conditions de la Turquie, et ce n’est pas ce que nous voulons.
Adnan et l’officier ne semblent pas très d’accord avec cette assertion : « Le PDK, c’est vrai », proteste Adnan. « Mais pas l’ASL ! »
– Inutile de se disputer… De toute façon, ajoute-t-il, à l’intention de l’officier, tu sais bien que Djeich al-Hor [dénomination arabe de l’ASL] n’aurait pas pu détourner mille hommes pour sauver Ayn al-Arab…
La discussion en restera là.
Nous ressassons nos souvenirs, Adnan et moi, comme deux vétérans, et nous rions ensemble… Mais le moral est au plus bas.
Adnan, qui trouvait toujours une bonne raison d’espérer, jadis, qui me baratinait à chaque fois que je le retrouvais sur le front ou au quartier général et m’assurait que tout allait bien, que la victoire était certaine, même lui, aujourd’hui, il m’avoue que la situation est probablement sans issue et que, dans quelques mois, quelques semaines peut-être, pas davantage, le régime aura balayé la révolution de ce dernier bastion, Alep, où elle avait réussi à survivre.
« Nous sommes de moins en moins nombreux », m’explique-t-il. « Chaque jours, plusieurs de nos hommes s’en vont. On voit bien que c’est perdu… On ne peut rien leur reprocher : ils ont été trahis par les Occidentaux ; mais ils se sont bien battus. Maintenant, ils doivent penser à leur famille. La vengeance du régime va être terrible, sans pitié ; ils ne vont pas s’en priver, parce que plus personne ne s’occupe de ce qui se passe ici. Vos gouvernements ont longtemps hésité, mais ils ont finalement choisi leur camp : al-Assad… contre Daesh. Nous, on compte pour rien. On nous a utilisés pour fatiguer le régime ; vous avez réussi à lui enlever ses armes chimiques, tout ce qui restait à la Syrie pour se défendre des Sionistes… Les gars s’en vont ; ils fuient en Turquie parce que, ici, ils ne peuvent plus vivre. Tu sais, Abdulrahmane et Youssef… Ils sont déjà partis. Abou Krahim aussi : il m’a dit qu’il ne pouvait plus continuer comme ça, que ‘son subconscient lui disait de partir’, pour aller vivre en Turquie ou en Europe, pour trouver la paix, un travail, se marier, avoir une vie normale, tranquille, loin des massacres et des destructions qui se répètent depuis trop d’années en Syrie. Il veut étudier, apprendre les sciences et les arts et tout ce qu’il pourra. Il veut vivre heureux, au moins jusqu’à l’âge de quatre-vingts ans. »
Qu’ils étaient partis, je le savais déjà…
« J’ai vraiment très peur pour l’avenir. », poursuit Adnan. « Si le régime réussit à prendre ce village (Handarat), il pourra couper Alep de toutes les agglomérations que nous tenons encore dans le nord du gouvernorat. Nous avons assez de forces dans la ville ; mais ça voudrait dire qu’Alep connaîtrait une catastrophe humanitaire, le même désastre qu’auparavant à Homs, quand elle était assiégée par l’armée. Et puis, ça se passera comme à Homs : la ville tombera. »
Nous resterons la nuit ainsi, l’un à côté de l’autre, à attendre l’aube, au milieu des flashs des explosions et des craquements des impacts.
J’ai demandé à revoir mon ami, le docteur Yasser, qui m’avait maintes fois hébergé dans son hôpital, au cœur d’Alep, l’hôpital Dar al-Shifaâ, plus tard bombardé par les Migs du régime et aujourd’hui complètement ruiné. Adnan m’emmène en voiture jusqu’à son dispensaire, à l’intérieur de la ville. Il ne faut guère plus d’une vingtaine de minutes pour rejoindre Alep ; la route est encore sûre.
Je n’ai pas reconnu Alep. La plupart des quartiers de la rébellion n’existent presque plus. Ce sont partout des ruines, des immeubles effondrés, des tas de gravats au milieu desquels des familles survivent, sous des bâches, autour d’un feu où brulent encore quelques planches, quelques bouts de bois glanés dans les décombres… Je n’ai rien reconnu de cette ville que j’avais découverte en juillet 2011, quand la « révolution » n’avait pas encore commencé, et de ses avenues que j’avais si souvent parcourues en 2012 avec les katiba de l’Armée syrienne libre, de Liwa al-Tohweed, de Jabhet al-Nosra… Pour dire la vérité, je ne sais même pas quelle partie de la ville j’ai traversé en cet automne 2014.
Yasser attendait ma visite ; il m’attendait dans ce petit local sommairement aménagé, dans un sous-sol, une sorte de cave mal éclairée, où un néon blafard jetait sa lumière crue sur un matelas souillé, taché de sang mille fois séché.
Il est devenu le chef du Conseil des médecins d’Alep, une structure mise sur pied par une petite trentaine de praticiens, ceux qui avaient décidé, dès le début des troubles, de soutenir la révolution et de rester dans la ville. Nous n’avons qu’une petite heure, le temps de nous embrasser et d’échanger quelques mots.
Yasser se souviens : « Comme tu le sais, mon ami, Dar al-Shifaâ a été complètement détruit… J’y avais commencé à opérer les civils blessés par les bombardements et les combattants de l’Armée libre le troisième jour du Ramadan, en 2012 ; vingt jours plus tard, les salles d’opération avaient été mises hors d’état par une attaque de l’aviation d’al-Assad… Tu te rappelles : on avait tout transféré dans le petit centre médical d’al-Daqqaq, quelques rues plus loin… Et je t’avais demandé de ne pas révéler l’endroit dans tes reportages. Mais, maintenant, il est détruit aussi. À l’époque, on avait encore trois autres hôpitaux en état de marche : al-Saqhor, al-Miassar et al-Bohoth al-Elmiah… Tout ça a été bombardé… Aujourd’hui, on se débrouille avec presque rien. On n’a reçu aucune aide, d’aucune ONG. Seulement quelques dons privés, ici, dans le gouvernorat d’Alep; puis aussi un peu d’argent de particuliers, des Syriens qui vivent en Arabie Saoudite, au Qatar et aux États-Unis… Mais c’est très peu, par rapport à tout ce qu’il y a à faire ici… Ce qui m’inquiète, c’est le siège… Si la route vers la Turquie est coupée, je ne sais pas comment on va tenir ; les stocks sont presque vides, l’hiver arrive… et si le régime intensifie ses frappes sur la ville… »
– Tu n’as pas trop de problèmes avec Daesh ?
– Ça va plus ou moins… On ne les a pas vus venir, ceux-là. On ne sait d’ailleurs toujours pas d’où ils sont sortis… La dernière fois que tu es venu à Alep… en novembre 2012… C’est bien ça ? Ils n’étaient pas encore là. Ils ont commencé à s’implanter ici en octobre 2013. Tout de suite, ils se sont mis à tourner autour de moi et de l’hôpital, et j’ai dû quitter la ville. On m’a averti que c’était devenu dangereux pour moi. J’ai déplacé mon dispensaire en dehors d’Alep, dans un village, al-Atareb, dans l’ouest du gouvernorat… J’ai bien fait : deux jours plus tard, ils ont enlevé deux de mes anciens collaborateurs, dont mon ami Kalled Sabha… On ne les a jamais revus.
– Et maintenant ?
– Depuis janvier dernier, l’Armée libre fait la guerre contre Daesh… On a nettoyé le quartier et je me suis réinstaller dans la ville. C’était nécessaire : en janvier, j’ai organisé une campagne de vaccination contre la polio… Il fallait qu’on puisse intervenir à Alep.
Depuis lors, je n’ai plus eu de menace ; mais je ne me déplace jamais sans mon arme. Même ici, comme tu vois, je suis armé, me déclare-t-il en me montrant le révolver qu’il porte sous sa vareuse.
Ces types ont blessé notre révolution, à mort… Au début, les gens, ici, haïssaient ces extrémistes. C’est la politique des États-Unis et de leurs alliés européens qui ont poussé les gens à rejoindre Daesh. Tu le sais bien : nos amis d’al-Towheed et d’al-Nosra, Abou Bakri, ce n’étaient pas des radicaux. Ils le sont devenus et ont rejoint Daesh à cause des États-Unis et de vos gouvernements, qui ont envoyé des avions pour frapper Daesh, mais qui ferment les yeux sur la terreur exercée par al-Assad. Tu dois le dire, ça, dans ton journal !
Les gens, ici, ils ont commencé à avoir de la rancœur envers les États-Unis et l’Europe quand ils ont compris que vous ne vouliez pas aider notre révolution. Et cette rancœur s’est changée en haine quand on a vu que, contre Daesh, l’Occident est intervenu ; pas contre al-Assad. Tu dois le dire, ça aussi ! Chaque jour, nos enfants meurent à cause des bombes, des barils d’explosif que les hélicoptères d’al-Assad balancent sur la ville. Mais les États-Unis ne nous permettent pas d’avoir des missiles anti-aériens.
– Quel espoir reste-t-il encore à la révolution ?
– Il n’y en a plus, Pierre… Nous avons vu disparaître nos derniers espoirs avec l’arrivée de Daesh. Nous avons vu sombrer notre révolution, ballotée entre le régime d’al-Assad, les États-Unis et Daesh… C’est ça, la réalité !
La politique internationale n’a eu aucune pitié pour notre révolution. Chacun a comme d’habitude défendu ses intérêts.
– Plus aucun espoir de reprendre le dessus ? L’Armée syrienne libre…
– Regarde autour de toi ! Où est-elle, aujourd’hui, l’Armée syrienne libre ?! Il n’y a plus, aujourd’hui, d’Armée syrienne libre ! Maintenant, il y a al-Assad, Daesh, d’autres groupes islamistes, et les États-Unis… Pour nous, c’est terminé. Nous avons perdu, mon ami. Et, pour la Syrie, ce n’est que le début d’une guerre sans fin…
– Qu’est ce que tu comptes faire, alors ? Repartir en Turquie ? Reprendre tes anciennes fonctions comme esthéticien ?
– Moi ? Non… J’en ai parlé avec ma femme… Tu la connais… Je te l’avais présentée à ta dernière visite… Elle me comprend ; je suis trop impliqué, ici. Je me suis trop investi pour partir comme ça. Je vais rester ici, jusqu’à la fin.
Je ferai comme tous les jours. Je commence très tôt ma journée. On opère des heures durant, dans les conditions que tu voies là. Parfois, je suis tellement épuisé que je me couche parterre et je dors comme ça, jusqu’à ce que d’autres blessés nous soient amenés et qu’on me réveille. Il n’y a plus que quelques médecins, désormais… pas seulement pour la ville, mais pour toutes les zones libérées du gouvernorat.
Et puis, on verra bien… Incha’Allah.
Adnan réapparaît ; il porte plusieurs kalachnikovs aux deux épaules, et des chargeurs à bout de bras. Il est pressé de repartir, et me rappelle que le groupe avec lequel je dois moi-même rebrousser chemin pour rejoindre ceux du YPG ne m’attendra pas.
Yasser sanglote ; il m’embrasse et me retient un instant dans ses bras : « Pierre… Nous avons fait notre révolution parce que nous voulions notre liberté… Pour nous débarrasser de la corruption, pour en finir avec le régime héréditaire de la famille al-Assad… Pas pour voir mourir nos enfants… Pas pour détruire notre pays… Pas pour en venir à devoir combattre les intérêts du monde entier, ici, sur notre terre… Mais personne, dans le monde, ne veut nous aider à arrêter cette guerre. La Syrie, aujourd’hui, c’est le pays des voleurs, des tueurs et des extrémistes. Je te l’ai déjà dis –souviens-toi !- : je ne comprends toujours pas pourquoi le monde entier s’est défié de notre révolution. »
Ce fut une courte rencontre, avec les anciens de la « Bataille d’Alep ». Tout avait commencé le 20 juillet 2012 ; je m’en souviens : j’étais à Tunis et je m’étais précipité dans un avion pour Istanbul, dès l’annonce du soulèvement. J’y aurai participé, à ma façon, le stylographe à la main. J’aurai suivi l’aventure révolutionnaire de ce peuple, pas à pas, de mois en mois, tout au long de mes onze voyages dans la Syrie en guerre. J’en aurai accompagné l’histoire, depuis l’essor de la révolution, jusqu’à son involution ; du début, jusqu’à la fin.
Une trop brève rencontre. Elle a confirmé tout ce que j’avais envisagé, depuis plus d’un an, depuis le début… Et la séparation est déchirante.
Dans le sud, l’ASL est en train de perdre la bataille de la capitale, Damas ; les forces gouvernementales l’ont rejetée dans les lointaines banlieues du rif. Au centre, après avoir dû se retirer de Homs, c’est maintenant dans la région de Hama que l’ASL connaît de cuisants revers…
Et c’est peut-être la dernière fois que je vois Alep, avant longtemps.
Un reportage de Pierre Piccinin da Prata
Envoyé spécial du Courrier du Maghreb et de l’Orient en Irak et en Syrie



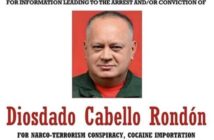

1 Comment
Pingback: annie bannie's Weblog