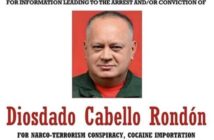Le 15 juillet 2016, une partie des forces armées turques tentait de s’emparer du pouvoir.
La question toujours en suspend : que voulaient les militaires ? Quelles étaient leurs intentions ? Quelles motivations ont-elles animé les putschistes, au point que des ordres avaient été donnés d’ouvrir le feu sur les civils si ces derniers opposaient une résistance au déploiement des troupes dans les rues ?
Jusqu’à présent, aucun procès public des militaires impliqués dans le putsch manqué n’a encore eu lieu, qui aurait pu leur servir de tribune et à exprimer les raisons de leur intervention à l’encontre du gouvernement de Recep Tayyip Erdogan.
Cela dit, l’hypothèse d’une réaction kémaliste semble tenir la route.
Retour sur un demi-siècle d’histoire de la république turque et autopsie des coups d’État qui ont marqué le destin de la Turquie moderne…
Un siècle de laïcité remis en question
Lorsque le général Mustafa Kemal, qui avait pris la tête des nationalistes turcs dans le contexte de la défaite de l’Empire ottoman durant la première guerre mondiale, crée la république de Turquie, en 1923, abolissant la monarchie et le Califat (le calife est le successeur du prophète Mohamed, à la tête de l’Oumma, la « communauté des Musulmans » ; les souverains ottomans, avaient hérité du titre de calife après s’être emparés de l’Égypte au XVIème siècle – Abdul-Medjid, cousin de Mehmet VI, fut le 101ème et dernier calife, avant l’auto-proclamation, en 2014, d’Abu Bakr al-Baghdadi, leader de l’État islamique instauré en Syrie et en Irak) et expulsant le dernier sultan, Mehmet VI, il érigea en principes fondamentaux six « flèches » qui devaient tracer à tout jamais le destin de la « nation turque ».
Mustafa Kemal (dit Atatürk, le « père des Turcs ») développe ainsi une vision ultranationaliste : la « nation turque » (qui n’existe pas en réalité, le pays étant parsemé de minorités – à commencer par l’importante population kurde – dès lors contrainte de renoncer à leur langue, à leur culture, et d’adopter la culture turque) devient le leitmotiv de la jeune république, une nation « une et indivisible », la deuxième de ces « directions à suivre » étant que, dans ce cadre, l’État, qui représente la nation, doit jouer le premier rôle dans le développement du pays (en tant qu’acteur économique prépondérant notamment), qui ne doit pas être laissé à l’initiative privée.
Viennent ensuite l’idée de la révolution permanente et le réformisme : ces deux principes impliquent que l’État doit « réformer », c’est-à-dire s’attaquer aux traditions qui handicapent le développement et les abolir de force si nécessaire, dans l’objectif de « moderniser » le pays. Les Kémalistes vont dès lors se tourner vers l’Occident, vers l’Europe qui domine le monde à l’époque, et forcer la réorientation de la Turquie, jusque dans les habitudes du quotidien et les mœurs : adoption des législations occidentales en maints domaines, interdiction de la langue arabe, de l’alphabet arabe (remplacé par l’alphabet latin), des costumes traditionnels qui rappelaient le sultanat, au profit de tenues « à l’occidentale », fermeture des monastères, des sanctuaires, des écoles religieuses…
Dans ce cadre, la laïcité est imposée, cinquième principe essentiel, qui écarte la religion des institutions et le l’espace public, à la fois dans un esprit de modernisation de la société, mais aussi de souveraineté absolue de l’État : la religion est extirpée de la justice, de l’enseignement bien sûr, qui est réformé de fond en combles, de toutes les administrations (aucun signe religieux n’est autorisé dans la fonction publique ; ils sont strictement interdit, à commencer par le voile pour les femmes –et, par ailleurs, l’égalité entre homme et femme est proclamée, à l’encontre des principes coraniques ; les femmes reçoivent le droit de vote dès 1933)…
Cette révolution kémaliste a lieu dans un cadre politique qui se veut républicain, cinquième principe, c’est-à-dire que l’État, « démocratique », doit servir et défendre les intérêts du peuple qu’il représente et ne peut exister qu’en fonction de la poursuite de cet objectif ; une direction qui se double du sixième et dernier principe kémaliste, le « populisme », au sens propre du terme, à savoir que l’État doit promouvoir l’égalité entre les citoyens et abolir les distinctions de classes et les privilèges, d’où la dimension socialiste éminente du kémalisme.
Dans l’ensemble de mesures qui fondent l’État laïc turc moderne, le rôle de « protecteur » des idéaux kémalistes est attribué à l’armée, dont les représentants dominent le Conseil de Sécurité nationale, un organe qui peut intervenir à l’encontre du gouvernement, si celui-ci en venait à ne plus respecter la constitution et les principes kémalistes qui y sont inscrits.
L’armée est en effet la meilleure garante des droits de la nation, puisque tous les citoyens mâles y participent, chaque Turc étant un électeur et un soldat.
On comprend donc bien pourquoi la victoire de Recep Tayyip Erdogan sur l’armée, parachevée le 15 juillet 2016, ouvre au parti islamiste au pouvoir en Turquie toutes les perspectives à l’abolition de ces principes…
Cinq coups d’État en un demi-siècle
1960 – Au terme de la deuxième guerre mondiale, la bourgeoisie turque, qui s’est considérablement développée, et les grands propriétaires terriens s’engagent dans une contestation de plus en plus audible de la mainmise du Cumhuriyet Halk Firkasi (le Parti républicain du Peuple), parti de tendance très fortement socialiste fondé en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, et exigent le passage au multipartisme et la démocratisation définitive du régime.
C’est chose faite en 1946, et émerge très rapidement un parti représentant les intérêts bourgeois, le Demokrat Parti, qui s’impose aux élections de 1950.
Officiellement « kémaliste » et laïc, le Parti démocrate connaît toutefois des dérives islamistes qui suscitent la méfiance des militaires. Cette tendance s’affirme soudainement lorsque, en perte de popularité du fait de la crise économique qui mine le pays, le Parti démocrate développe de plus en plus, à partir de 1955, une rhétorique islamiste destinée à se fidéliser les masses rurales : le premier ministre Adnan Menderes accorde un budget colossal pour la construction de mosquées et la création de nouveaux postes d’imams ; l’État engage des prédicateurs et finance de ses propres deniers des campagnes de prêche à travers tout le pays ; et l’arabe est à nouveau autorisé pour l’appel à la prière, tandis que des cours de religion sont imposés dans les écoles.
Cette politique démagogique atteint un sommet lorsque, en 1956, Menderes laisse envisager l’idée d’un référendum sur le rétablissement du Califat… Lorsque le gouvernement annonce l’abolition de plusieurs lois kémalistes garantissant la laïcité des institutions et face à la montée en puissance de plusieurs organisations et mouvements religieux, dont les Frères musulmans, l’armée s’empare du pouvoir, le 27 mai 1960.
Le premier ministre Menderes est arrêté, condamné à mort sur le motif de violation grave de la constitution et exécuté par pendaison.
Les militaires, institués en un Comité d’Union nationale, assument la transition vers la restauration de la démocratie qui a lieu en février 1961, après l’adoption par référendum d’une nouvelle constitution qui insiste sur les principes kémalistes et élargit le multipartisme et la démocratisation de la vie politique en consacrant la liberté de la presse, la liberté d’expression, le droit de grève et la liberté d’association.
1971 – Dissout par le Comité d’Union nationale, le Parti démocrate se refonde immédiatement sous le nom de l’Adalet Partisi (le Parti de la Justice). Et les islamistes repartent à la conquête des institutions. Leur leader, Süleyman Demirel, devenu premier ministre en 1965, renoue avec la politique islamiste du Parti démocrate, tandis qu’émerge un autre parti islamiste qui lui fait concurrence, le Parti de l’Ordre national.
La crise, qui ne cesse de s’aggraver depuis le milieu des années 1950’, et la guerre de position que se livrent les deux partis islamistes au parlement dont les blocages successifs empêchent le gouvernement de mettre en œuvre les mesures nécessaires au redressement de la situation économique provoquent en Turquie une contestation sociale de grande ampleur qui menace la stabilité de l’État.
Deux camps s’affrontent dans un contexte devenu révolutionnaire : les factions d’extrême-gauche et les mouvements islamistes qui estiment arrivée l’heure de rétablir le Califat.
Face aux risque de révolution et au développement croissant de la violence et de l’insécurité, l’armée s’empare une deuxième fois du pouvoir, instaure la loi martiale et dissout le Parti de l’Ordre national, tandis que le Parti de la Justice implose de lui-même. De nombreuses organisations islamistes et les groupuscules d’extrême-gauche sont traqués et interdits.
L’armée rétablit la démocratie l’année suivante, promulguant une nouvelle constitution qui instaure un système électoral proportionnel permettant aux petites formations politiques d’être représentées au parlement. Les militaires espèrent ainsi contrer l’influence des grandes formations islamistes.
1980 – Le contexte de crise économique qui s’accentue suite au choc pétrolier de 1973/5 – et que les onze gouvernements qui se succèdent à la tête du pays entre 1971 et 1980 ne parviennent pas à enrayer -, continue de se traduire socialement par un climat insurrectionnel et d’insécurité permanente : les factions d’extrême-gauche dissoutes en 1971 se sont reformées, ainsi que les sectes et mouvements islamistes. Le coup d’État de 1971, dans les faits, n’a servi à rien.
Au contraire, la contestation sociale se révèle de plus en plus violente et aussi bien l’extrême-gauche que les islamistes recourent dorénavant au terrorisme. Marxistes et islamistes infiltrent même l’armée, qui doit limoger des dizaines d’officier subalternes sympathisants de l’une ou l’autre tendance.
En décembre 1978, à Kahramanmaraş, près d’un millier de personnes sont massacrées par la population sunnite et des factions d’extrême-droite : il s’agit de familles alévies (chiites) et de représentant de la gauche. Les maisons des Alévis avaient été préalablement marquées d’une croix ; les actes sont atroces : des femmes enceintes sont éventrées et des élèves sont assassinés dans leurs écoles. Les forces de l’ordre locales ont reçu l’ordre de ne pas intervenir… Et c’est l’armée, qui dépêchera en catastrophe des régiments des villes voisines de Kayseri et Gaziantep, qui mettra fin à l’horreur.
Pour les officiers kémalistes, le massacre de Kahramanmaraş est un choc puissant ; au sein de l’état-major, la décision se fait jour de prendre le pouvoir une fois encore et de rétablir l’ordre républicain par la force. En janvier 1980, l’état-major prévient officiellement le premier ministre que, si la paix sociale et religieuse n’est pas rétablie dans les mois qui suivent, l’armée destituera le gouvernement. En septembre, c’est chose faite.
L’armée dissout le parlement, le gouvernement et tous les partis politiques et interdit les organisations à caractère religieux.
En 1982, les militaires proposent une nouvelle constitution, qui renforce les pouvoirs de l’État et donne à l’armée le droit d’intervenir si besoin était de faire respecter par la force la laïcité et les principes républicains, notamment de s’opposer à d’éventuelles dérives islamistes, laquelle est approuvée par référendum. Paradoxalement, toutefois, les militaires ont rendu les cours de religion obligatoires dans l’enseignement public ; l’objectif était de refédérer les Turcs autour de leur identité islamique…
En 1983, les militaires organisent de nouvelles élections législatives et se retirent du pouvoir.
1997 – L’arrivée au pouvoir du Refah Partisi (le Parti de la Prospérité) inquiète de nouveau les militaires. Parti islamiste dont le leader, Necmettin Erbakan, occupe la fonction de premier ministre (un de ses lieutenants est alors élu maire d’Istanbul ; il s’agit d’un certain… Recep Tayyip Erdogan), le Refah Partisi commence à remettre en question les principes kémalistes et annonce l’abolition du caractère laïc de l’État.
Le gouvernement commence par autoriser le port du voile dans les administrations, mettant ainsi fin au principe de neutralité religieuse ; il débloque des budgets public colossaux pour la construction de mosquées et le financement d’associations islamistes nombreuses, notamment dans le domaine des médias, chaînes de télévision, radios et journaux islamistes.
La ligne, en politique étrangère, s’inverse : rejet de l’Occident, de l’Union européenne notamment, et rapprochement avec les pays musulmans sunnites. Le gouvernement encourage en outre les actes de violence à l’égard des minorités religieuses, des Chrétiens en particulier. Necmettin Erbakan avait plusieurs années auparavant déjà appelé à l’islamisation de toute l’Europe et à « conquérir Rome » (sic).
La mise en œuvre de sa politique finit par effrayer une partie de la société civile qui en appelle à l’armée, qui, en février 1997, oblige le gouvernement à signer un mémorandum garantissant le respect des fondements kémalistes de la république et la neutralité religieuse de l’État. En juin, le Conseil de Sécurité national, considérant le non-respect du mémorandum et la poursuite de l’islamisation des institutions, adresse au premier ministre une série de « recommandations », menaces à peine voilées, et le contraint à la démission.
Erbakan est arrêté et sera condamné en 2000 à un an de prison pour incitation à la haine raciale et religieuse (ainsi que le maire d’Istanbul, Erdogan, condamné à dix mois de prison) ; et la Cour constitutionnelle ordonne la dissolution du Refah Partisi (qui, après quelques vicissitudes, sera refondé en 2001 par Recep Tayyip Erdogan, sous le nom de Adalet ve Kalkinma Partisi, l’AKP, le Parti de la Justice et du Développement).
2016 – Un groupe d’officiers, qui se sont constitués en un « Conseil de la paix pour le pays », déploie des troupes à Istanbul et Ankara ; son but déclaré est de mettre fin aux manœuvres du président Erdogan, dont les dérives autoritaires se multiplient, et à rétablir l’ordre constitutionnel pour préserver ainsi la démocratie, les libertés individuelles et les Droits de l’Homme.
Une partie de la population envahit alors les rues et se dresse devant les militaires. Plusieurs civils sont abattus, mais le putsch est enrayé. Parmi les manifestants qui s’opposent au coup d’État, la majorité sont des partisans de l’AKP, appelés par le président à faire barrage aux soldats putschistes (appel relayé par les haut-parleurs des minarets des mosquées).
Par ailleurs, il apparaît très vite que seules quelques unités de l’armée participent au coup d’État ; et le gouvernement peut compter sur le gros des forces armées et de la police, qui interviennent et arraisonnent les insurgés…
En effet, l’armée turque avait été purgée de ses principaux éléments kémalistes : dans les années 1980’, le mouvement islamiste Hizmet (dirigé par Fethullah Gülen, qui s’alliera un temps à l’AKP et est aujourd’hui exilé aux États-Unis et accusé par le président Erdogan d’avoir fomenté le coup d’État du 15 juillet) avait commencé d’infiltrer l’armée, dont l’état-major prendra la mesure de la manœuvre et commencera à expulser les islamistes qui avaient pénétré les rangs ; toutefois, cette contre-offensive kémaliste avait été stoppée net, à partir de 2002, avec l’arrivée au pouvoir de l’AKP qui, à l’inverse, facilita la promotion d’officiers islamistes et, à son tour, commença d’épurer l’armée, des kémalistes cette fois.
Une épuration qui attint son paroxysme lors de l’affaire d’Ergenekon, une organisation secrète alliant l’extrême droite, divers acteurs politiques et de hauts responsables de l’armée, tous accusés de conspiration contre l’État : entre 2007 et 2009, plusieurs centaines de personnes furent arrêtées, et ce fut l’occasion pour l’AKP au pouvoir de se débarrasser des derniers officiers kémalistes connus.
Enfin, une réforme du Conseil militaire suprême avait donné au chef de l’État le pouvoir de nommer le haut commandement de l’armée ; Erdogan a ainsi placé des amis et des fidèles aux postes clefs, à la tête de l’état-major et de la force aérienne notamment.
Cela faisait donc un certain temps que l’armée turque ne disposait plus des cadres républicains et laïcs suffisants au maintien de son idéal kémaliste ; et l’échec du coup d’État était prévisible. En outre, mal préparé, le coup d’État a surpris une partie des derniers officiers kémalistes encore présents dans l’armée – ainsi que l’opposition kémalistes à l’AKP au parlement – ; et ni ces derniers ni aucun relais politique n’ayant été informés et impliqués dans l’opération, ils ont alors fait le choix de rester fidèles au gouvernement, un choix que certains semblent aujourd’hui regretter…
Il apparaît, cela dit, que les putschistes avaient compté sur un sursaut patriotique de la population et un soutien populaire massif. Ce ne fut pas le cas…
Tout au contraire, avant même l’intervention des régiments loyalistes, c’est la population elle-même qui a empêché la poursuite du coup d’État.
Mustafa Kemal, une pièce de musée ?
Si le portrait de Mustaka Kemal Atatürk trône encore dans toutes les administrations turques et jusque dans le bureau du président Erdogan lui-même, il apparaît désormais comme la relique d’un passé révolu et non plus comme le symbole d’une pratique politique et sociale vivante et structurante de l’État turc.
Certes, le nationalisme exacerbé demeure, non plus, cependant, en tant que garant de l’unicité de la nation, mais comme élément d’une restauration ottomane dont les souvenirs sont ravivés comme autant de symboles manipulés par le pouvoir.
Par ailleurs, l’État et le programme kémalistes sont progressivement vidés de toute substance. Un programme qui vole aujourd’hui en éclat à coups d’oukases présidentiels et d’une réislamisation forcée de la société et des institutions de l’État.
Symbole s’il en est : l’enseignement. Dorénavant, la création d’une école privée reconnue et subventionnée par l’État est conditionnée à ce que des cours de religion islamique soient inclus dans les cursus. La religion, que la république kémaliste avait strictement reléguée à la sphère privée, s’impose à présent sans restriction dans l’espace public.
Le coup d’État manqué de juillet 2016 n’a donc rien d’anecdotique. Il n’est pas le « coup d’État de plus » qui s’ajoute à la liste des précédents. Cette fois, en effet, et pour la première fois, l’armée, confrontée à un mouvement islamiste plus vaste et puissant que jamais auparavant, a échoué dans sa tentative de préserver l’État laïc et républicain.
S’en suit désormais une « dékémalisation » de tous les organes étatiques, de l’armée tout particulièrement qui, ainsi définitivement castrée, ne constituera jamais plus un obstacle aux velléités idéologiques d’organisations à caractère islamiste, tel que l’AKP et le mouvement des Frères musulmans dont le « plan politique » est connu : prendre le pouvoir par les urnes et instaurer ensuite l’État islamique.
Décidément, la Turquie n’est pas l’Égypte… La première aurait pu revenir au meilleur ; la seconde connaît le pire.
*
* *
Probablement, le 15 juillet 2016, la Turquie, sans que ceux qui sont descendus dans la rue en croyant défendre ce qui n’existait déjà plus tout à fait s’en soient bien rendu compte, a-t-elle basculé dans une autre ère de son histoire.
Le 15 juillet 2016, une date que les historiens du futur retiendront au même tire qu’un certain 29 octobre 1923 et qu’on enseignera dans les écoles du pays comme le jour où le peuple turc a été rattrapé par son passé.
Mais la question est peut-être tout autre…
Il est un fait que l’AKP et son leader progressent dans les urnes à chaque élection. Le soutien populaire au président Erdogan est incontestable. Et l’islamisation du pays ne semble in fine poser problème qu’à une minorité de plus en plus isolée au sein d’une population qui remplit les mosquées tous les vendredis.
Le « péril islamiste » qui « menace » la Turquie ne serait-il pas dès lors une simple vision de l’esprit d’analystes occidentaux trop imbus de leurs propres modèles sociaux et de valeurs que la majorité du peuple turc ne partage plus ? Mais cette majorité les a-telle jamais partagés ?
Le rejet par l’Union européenne, qui a fait miroiter à ce peuple une candidature des décennies durant sans jamais concrétiser d’accord viable et en reportant sans cesse l’adhésion aux calendes grecques, et son isolement progressif sur le plan international a généré en Turquie un repli identitaire tangible, que le nationalisme turc éminemment prégnant dans la culture politique du pays a synthétisé de manière exacerbée ; un repli identitaire qui a trouvé dans l’Islam sunnite à la fois un support et un biais d’expression en réaction radicale avec les orientations occidentalisantes du kémalisme.
Il est un fait que, régulièrement, depuis 1960, l’armée s’oppose aux urnes et dissout des gouvernements issus de formations islamistes élues par la majorité des Turcs et qui n’ont de cesse de se refonder et de revenir au pouvoir par les élections…
Faut-il en déduire que, depuis longtemps déjà, le kémalisme n’est plus la voie préférée que d’une minorité de la société civile turque ? Peut-être même en a-t-il toujours été ainsi…
En fin de compte, la question, c’est aux citoyens turcs eux-mêmes qu’il faudrait la poser : « Voulez-vous de l’instauration d’un État islamique dans votre pays ? »