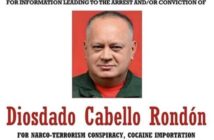Au Caire, le nouvel « homme fort » du pays, le général Abdel Fatah Al-Sissi, semble se complaire à présenter son coup d’État du 3 juillet 2013 et le renversement du président Morsi comme un prolongement de la lutte féroce qui opposa, dès 1954, le régime de Gamal Abdel Nasser aux Frères musulmans. Et on se souvient de ces manifestants « anti-Morsi » brandissant côte à côte des portraits géants de ces deux personnalités.
Une comparaison répercutée avec succès à l’étranger, comme sur les réseaux sociaux où a circulé une vidéo montrant Nasser se moquer des Frères musulmans, appréciée de certains cercles de la gauche laïque européenne. Succès dû, sans doute, à l’appréhension que suscitaient, suite aux « printemps arabes », l’arrivée au pouvoir d’Ennahda en Tunisie, des Frères musulmans en Égypte, voire le poids de leurs pendants syriens dans la rébellion contre le régime de Bachar Al-Assad.
Une comparaison qui ferait bien rire si l’heure n’était tragique…
Socialistes laïcs contre islamistes?
Notre intention, ici, n’est certes pas de ternir les mérites du colonel Nasser. Mérites incontestables, que ce soit dans la restitution de sa souveraineté à l’Égypte et dans sa modernisation ainsi que dans la régénération de l’identité arabe. Il s’agit plutôt d’apporter un éclairage différent sur son action. Et de souligner certaines ambiguïtés et erreurs de perception. La question ici est donc de savoir quelles images certains « choisissent » de retenir du Bikbashi (équivalent de « colonel » en arabe ; Mouammar Kadhafi, qui se voulait une émule de Nasser, reprendra ce surnom que l’on avait donné au président égyptien). Et pourquoi.
À lire Olivier Carré (L’Orient arabe aujourd’hui), il est quelque peu hasardeux d’opposer radicalement l’idéologie du régime issu de la « révolution » du 23 juillet 1952, du moins dans sa première décennie, et celle des Frères musulmans. En effet, des années 1940 à 1953, il y a eu collaboration, parfois étroite, entre « Officiers libres » et les Frères.
Bien plus qu’un désaccord idéologique, c’est surtout une lutte pour le pouvoir qui, selon Carré, a opposé les Officiers libres à la confrérie. Plus encore : ce conflit déclenché, le nouveau régime s’efforcera de procéder – dans un premier temps avec la collaboration de… l’Arabie saoudite ! – à une certaine étatisation de l’islam susceptible de lui rallier les partisans de la confrérie. Samir Amin (La Nation arabe) lui-même le dit : « Loin de poursuivre les tendances radicales du nationalisme bourgeois qui se manifestaient dans l’aile gauche du Wafd [ndlr : Le grand parti nationaliste égyptien, pluriconfessionnel, né aux lendemains de la première guerre mondiale], le nassérisme s’apparentera davantage aux courants réactionnaires de la petite bourgeoisie, celui des Frères musulmans, entre autres. »
Pour l’économiste marxiste égyptien (qui aujourd’hui se félicite du renversement de Mohamed Morsi) comme pour Olivier Carré, ce que le nassérisme a édifié, c’est une nouvelle « bourgeoisie d’État », appuyée sur un « capitalisme d’État » qui bénéficiera e. a. de la nationalisation des entreprises européennes suite à la crise de Suez (1956). Et que les communistes égyptiens finiront par appuyer nolens volens et d’autant plus facilement que ce soutien répondait aux intérêts de politique étrangère de l’URSS.
Il n’est pas inutile de rappeler que, sur le plan social, peu après une réforme agraire somme toute modeste (la réforme agraire de septembre 1952 ne concerna que les très grands propriétaires ; elle ne porta que sur 7% de la surface cultivable totale et ne toucha que 750.000 paysans sur 14,6 millions), l’un des gestes marquants du nouveau régime fut, en août 1952, de faire… pendre deux leaders ouvriers après les émeutes populaires de Kafr Dawwar, dans le Delta. Avant de réprimer durement les groupes communistes.
En effet, l’opposition de Nasser au communisme – « une religion alors que nous avons déjà la nôtre », devait-il dire – doit être rappelée pour lever certains malentendus.
La plupart des quelque 250 Officiers libres, issus de la petite bourgeoisie, étaient, écrit Hassan Riad (L’Égypte nassérienne), des musulmans traditionnalistes (parmi les Officiers libres, l’on ne comptait qu’un seul copte) qui refusaient le communisme par attachement à la religion. D’autres aussi, une bonne vingtaine, étaient proches des groupes communistes égyptiens. Toutefois, John Calvert nous apprend aussi que quelques jours avant le coup d’État du 23 juillet 1952, Nasser lui-même a discrètement rencontré plusieurs dirigeants des Frères pour s’assurer de leur soutien. Et cela au domicile même de Saïd Qutb (qui, il est vrai, n’adhérera à l’association qu’en février suivant) qui, non seulement sera invité comme conférencier au club des officiers en présence de Nasser, mais se verra aussi proposer la présidence d’un nouveau parti que le Raïs songeait alors à créer.
Remettons-nous aussi en mémoire que le coup d’État du 23 juillet 1952 fut d’abord perçu à Moscou comme organisé par la CIA et que la plupart des organisations communistes égyptiennes condamneront le putsch. À l’exception du Mouvement égyptien de libération nationale, l’un des groupes communistes qu’avait fondé Henri Curiel, et qui sera d’ailleurs condamné comme « suppôt de la dictature fasciste » (sic) par ses pairs (né dans une famille juive égyptienne, exilé en 1950, H. Curiel resta un militant anti-impérialiste actif, e. a. lors de la guerre d’Algérie et en favorisant des contacts israélo-palestiniens, et fut assassiné par des tueurs de l’extrême-droite française le 4 mai 1978 ; Gilles Perrault en a fait un portrait impressionnant dans Un homme à part). Rappelons-nous aussi que c’est avec l’aide des États-Unis que le nouveau régime obtiendra l’évacuation des troupes britanniques du canal de Suez en 1954. En outre, comme les Frères, les communistes dénonceront les concessions consenties par les Officiers libres lors du traité anglo-égyptien sur la voie d’eau, devenue le symbole d’une souveraineté égyptienne retrouvée.
Par ailleurs, le «socialisme» nassérien semble surtout s’être affirmé après l’éclatement de l’union syro-égyptienne (la République arabe unie, RAU, de 1958-1961). Il se serait d’ailleurs inspiré des thèses du baathisme. À partir de 1961, l’étatisation de l’économie égyptienne progresse fortement et le grand capital privé est fort affecté. La seconde réforme agraire, plus ambitieuse, ne concerna toutefois à la fin 1966 que 11,5% de la superficie cultivée et 1,5 millions de ruraux (sur quelque 30 millions d’Égyptiens) et déboucha sur un accroissement des moyennes propriétés (entre 20 et 50 « feddan », c. à d. entre 8 et 21 ha), la masse des fellahs non propriétaires restant, démographie aidant, aussi nombreuse (80%) qu’en 1952.
Dans la Charte d’action nationale du printemps 1962, « la bible du socialisme arabe », note Carré, la lutte des classes était secondaire, subordonnée à l’objectif panarabiste et vouée à disparaître par des mesures étatiques. Le « socialisme arabe » (ou nassérien), conclut Carré, « a une base islamique essentielle », par ailleurs indispensable aux Officiers libres pour se gagner une base sociale.
Les premières années, les discours de Nasser sont ainsi « émaillés d’appels à la sensibilité musulmane ». En 1956, Nasser appellera du haut de la chaire d’Al-Azhar au jihad contre l’agression tripartite anglo-franco-israélienne. Et le socialisme nassérien semble bien proche du « socialisme islamique » des Frères : soutien à la propriété privée (sans ses abus), résolution pacifique des contradictions de classe, participation conjointe des patrons et des ouvriers à la direction de la production…
Il s’agit donc de prendre distance de certaines perceptions essentiellement dues à la Guerre froide : la lutte entre Nasser et les Frères doit être davantage perçue comme une rivalité ayant pour enjeu les mêmes couches sociales. Elle sera accentuée par les ressentiments dus à la répression et aussi par le nationalisme panarabe du Raïs que la confrérie – et particulièrement Saïd Qutb, pendu en 1965 – avait critiqué comme une régression par rapport à un « internationalisme islamique ».
Il reste qu’aujourd’hui, l’État égyptien hérité du nassérisme s’est attribué l’essentiel des prérogatives religieuses dans le pays.
Le nouveau cours imposé par Sadate qui succède à Nasser en 1970 constituera moins une rupture avec celui du Raïs, note Carré, que sa continuation orientée vers la droite, une sorte de retour aux années 1952-1955. C’est que, désormais, la « bourgeoisie d’État » se sent à l’étroit dans un corset étatique dont elle n’avait eu qu’à se féliciter auparavant. Et elle aspire à devenir « bourgeoisie » à part entière. Accompagnant ce mouvement, Sadate, le « président-croyant », renforce la dimension islamique du nassérisme. C’est Sadate, aussi, qui introduira la Charia dans la législation égyptienne.
Nasser, le « nouvel Hitler »…
Comme Saddam Hussein après lui, le colonel Nasser a eu droit, notamment lors de la crise de Suez (1956), à l’infamante comparaison : « Nasser = Hitler ! »
Pourtant, le « nouvel historien » israélien Avi Shlaïm (Le mur de fer. Israël et le monde arabe) a montré que, contrairement à certaines légendes construites a posteriori, Nasser était, de tous les Officiers libres, le plus enclin à rechercher un accord avec le jeune État d’Israël et que c’est principalement l’intransigeance de Ben Gourion et de ses proches qui l’a contraint à renoncer, outre « l’Affaire Lavon » (ce scandale survenu en Israël dans les années 1950 après qu’il a été établi que des poseurs de bombes égyptiens dans des lieux culturel occidentaux étaient en fait des… agents israéliens ; l’objectif du ministre israélien de la Défense, Pinhas Lavon, proche de Ben Gourion, était en fait de saper un éventuel rapprochement du nouveau régime des Officiers libres avec l’Occident). Et à devenir le héros/héraut du nationalisme arabe… Et le « nouvel Hitler » des Israéliens, mais aussi, en 1956 comme en 1967, d’une certaine gauche européenne.
Il est courant, aujourd’hui encore, de voir Nasser érigé en héros de la lutte anti-impérialiste arabe. Ce qu’il fut certainement à bien des égards. Incontestablement, Nasser fut un des grands champions de ce que l’on allait appeler le « tiers-mondisme ». Mais, quoique s’étant fortement rapprochée de l’URSS, l’Égypte nassérienne est restée attachée au « neutralisme positif » inspiré par Bandung. C’est ce neutralisme qui lui valut les bonnes grâces et l’aide de l’URSS. Et, écrit Hassan Riad, la nouvelle bourgeoisie d’État née du système ne rompra jamais définitivement avec l’impérialisme, ce que confirmera la période Sadate.
Ériger Nasser en parangon de la lutte anti-impérialiste arabe relève cependant aussi, primo, d’une vision tronquée et « mécaniste », imprégnée de surcroît d’orientalisme.
En effet, Nasser n’incarnait-il pas un anti-impérialisme tel que l’Occident le souhaite, à savoir sinon laïc, « laïcisant » et opposé (toutes mesures gardées) à « l’islam politique » ? Et, secundo, n’est-ce pas aussi – par contrecoup – faire des Frères musulmans, opposés au Raïs, des « valets de l’impérialisme » ?
L’islamisme, cheval de Troie de l’impérialisme ?
Les alliances « régionales », politiques, idéologiques et financières des Frères musulmans suffisent-elles à les cloîtrer parmi les « agents » de l’impérialisme ?
Un retour à l’histoire contemporaine du Proche-Orient montre que le « choc des civilisations » – réel celui-là – que la région a connu du fait de l’expansionnisme européen au XIXe siècle, a suscité diverses formes de résistances. Ainsi, ce que nous appelons aujourd’hui l’islamisme (ou « l’intégrisme ») n’est pas moins contemporain ni anticolonialiste que les nationalismes arabes dits « laïques ». Le premier se focalisant sur l’identité islamique ainsi que sur la défense du patrimoine religieux et culturel pour prôner une « modernisation » endogène en phase avec les « pesanteurs sociales »; les seconds sur une identité « ethnico-nationale », nourrissant des projets plus immédiatement politiques et économiques et plus volontaristes.
Ce sont ces différences quant au champ d’action premier qui expliquent qu’en Égypte, la première préoccupation des Frères musulmans fut le prosélytisme des missions chrétiennes occidentales. Et Xavier Ternisien (Les Frères musulmans) nous rappelle comment ces missions chrétiennes fondaient leur influence sur l’aide sociale et sanitaire aux populations (ne reproche-t-on pas aujourd’hui systématiquement aux islamistes d’étendre leur audience politique via le caritatif ?) et offrirent ainsi un modus operandi aux Frères. Et, deuxièmement, que la confrérie fondée par Hassan Al-Banna (le principal fondateur de Frères musulmans en 1928) faisait, alors du moins, clairement la distinction entre Chrétiens occidentaux et Chrétiens coptes d’Égypte.
Un champ d’action, donc, avant tout social et culturel, mais qui n’empêcha pas les Frères musulmans de mettre sur pied, à l’instar d’autres formations politiques (on oublie trop souvent que dans l’entre-deux-guerres, nombre de partis ou d’organisations politiques se dotaient d’une milice ou de « scouts » ; il en allait de même en Europe avec, bien sûr, les organisations fascistes, mais aussi socialistes et communistes), une « organisation spéciale » (laquelle fera abattre en 1948 le 1er ministre Nokrachi Pacha qui avait pour la première fois fait interdire la confrérie) qui, dès 1936, combattra en Palestine, avant d’y envoyer à nouveau des volontaires en 1948. D’autre part, l’historien états-unien John Calvert (Sayyid Qutb and the Origins of Radical Islamism) rappelle que, lorsqu’un Saïd Qutb, par exemple, « compare l’islam à d’autres systèmes, il ne le mesure pas au christianisme, au judaïsme ou à l’hindouisme, mais aux idéologies rivales du communisme, du capitalisme et de la démocratie libérale ». Une « weltanschauung » donc plus politique et sociale que strictement religieuse.
Les Frères feront aussi le coup de feu contre les Anglais dans la zone du Canal. Tiernisen, pour sa part, va jusqu’à considérer que ce sont les Frères qui fournirent au coup d’État des Officiers libres du 23 juillet 1952 « la base populaire nécessaire à son succès »… Ce qui expliquerait que, si les partis politiques furent interdits par le nouveau régime dès janvier 1953, ce ne fut qu’en octobre 1954 que cette sanction frappa la confrérie. En outre, ce sont ces mêmes Frères musulmans (parmi lesquels existait une tendance favorable au régime, dirigée par le propre frère de Hassan Al-Banna) qui refusèrent une offre des Officiers libres d’entrer dans le nouveau gouvernement.
Les relations entre les Frères et l’Arabie saoudite sont souvent évoquées lorsqu’il s’agit d’en faire des alliés, réels ou « objectifs » des États-Unis au nom de la formule « les amis de mes amis sont… ». C’est là à la fois perdre de vue que ces relations ont toujours été fluctuantes – le « printemps égyptien » le démontre – et dénier à l’Arabie saoudite tout « agenda » propre.
Par ailleurs, le pragmatisme résolu – l’on dira, pourquoi pas, « l’opportunisme » – qui caractérise l’attitude de la confrérie sur le plan de la politique intérieure n’est un secret pour personne. Un « pragmatisme » que favorise d’ailleurs le principe d’une « (ré-)islamisation par le bas », programme – ô combien ! – à long terme et qui permet bien des « arrangements » d’ici là. Or, ce pragmatisme semble aussi avoir joué en politique extérieure : « les ennemis de mes ennemis… ». Cela vaut sans doute tant pour l’Arabie saoudite que pour les États-Unis.
Pour sa part, Olivier Roy voit les choses de façon plus tranchées: « La famille Al-Saoud n’est pas ‘réservée’ face aux Frères : elle les hait ! Entre eux, c’est la guerre (…) parce qu’ils ne défendent pas les mêmes valeurs. L’islamisme [des Frères]n’a pas grand-chose à voir avec le wahhabisme qui ne met pas en cause les régimes existants et qui ne s’intéresse qu’à la norme juridique formelle. »
La remontée en force à partir des années 1970 des Frères musulmans (comme celle de « l’islam politique » en général) s’explique, à un niveau plus immédiat, par la volonté de Sadate de lancer, notamment sur les campus, des adversaires de la gauche, e. a. nassérienne. Cette remontée, toutefois, s’inscrit dans une évolution plus vaste (et discernable bien au-delà de l’Égypte) qui voit l’islamisme s’affirmer face aux désillusions qu’ont suscitées tant le « socialisme arabe » que les conséquences catastrophiques du courant néo-libéral qu’a voulu insuffler le successeur de Nasser avec son « Infitah ». « L’ouverture » économique de Sadate voit aussi les retombées d’une émigration enrichie dans les pays du Golfe où elle a subi l’influence d’une religiosité militante et conservatrice. Et débouche aussi sur une corruption, cette-fois ostentatoire, alors même que la misère s’accroît. Moubarak accentuera ce tournant néo-libéral.
Une série de rappels qui montre que les choses furent moins catégoriques que l’affirment certaines visions tranchées d’aujourd’hui.
Armée d’hier et armée d’aujourd’hui
D’aucuns ne se privent pas non plus de renvoyer dos à dos militaires et islamistes égyptiens.
Au nom d’une focalisation sur les « entorses » à la démocratie qu’ont successivement étalées les règnes de Nasser, de Sadate et de Moubarak. Et qui, désormais exacerbées, sont au fondement même du nouveau régime d’Abdel Fatah al-Sissi, au demeurant formé dans les écoles de guerre états-uniennes et britanniques. Infractions à la démocratie que, pour avoir été d’un autre genre, l’on a néanmoins épinglées aussi de la part du gouvernement Morsi. Encore que, pour une oreille occidentale, toute déclaration d’une organisation ou personnalité islamiste favorable aux principes démocratiques relève immédiatement du « double langage ».
Cette comparaison est, me semble-t-il, anhistorique et inapte à saisir les réalités dans leur complexité.
L’armée égyptienne qui a pris le pouvoir en 1952 n’avait d’officiers égyptiens que depuis 1936 ! En 1948, elle s’était fait étriller en Palestine, découvrant que certains de ses armements étaient défectueux suite à quelques combines mafieuses que nombre d’officiers allaient imputer au Palais. Armée de pays pauvre, frustrée, mal-aimée des élites comme toutes les armées du Proche-Orient arabe de l’époque. Et persuadée d’incarner la fierté nationale…
Or, cette armée que commandaient en 1953 les Officiers libres va devenir méconnaissable.
Certes, c’est sous Nasser que les militaires s’installent solidement au pouvoir : tous les premiers ministres du Raïs sortiront de leurs rangs.
Il s’agit cependant de rappeler que, sous Nasser, cette armée a livré deux guerres – malheureuses – contre Israël: la première en 1956 face à une agression « tripartite » occidentale (Royaume Uni-France-Israël, visant à un « changement de régime » et à « punir » Nasser pour la nationalisation du canal de Suez), la seconde en 1967. Puis, de 1962 à 1967 et par Yéménites interposés, contre l’Arabie saoudite du roi Fayçal, l’artisan de l’alliance du royaume avec les États-Unis qui se voulait champion du « Monde libre » dans la région.
En 1973 toutefois, Nasser étant décédé trois ans plus tôt, la donne change.
La guerre d’octobre enclenchée par Sadate ne vise à rien de plus qu’à forcer la paix avec Israël. Et a été précédée d’un geste de rupture avec Moscou (le renvoi des conseillers militaires soviétiques) dans le souci de se gagner les bonnes dispositions américaines. Et, en 1990, c’est aux côtés des États-Unis et de l’Arabie saoudite que l’armée de Moubarak participe à l’opération « Tempête du désert » contre l’Irak de Saddam Hussein. Enfin, au cours des Intifada palestiniennes et par la suite, l’on sait l’ambiguïté du rôle qu’a joué Hosni Moubarak – et dont, d’ailleurs, Mohamed Morsi ne s’est guère démarqué – comme soi-disant « médiateur » entre Palestiniens et Israéliens. Israéliens qui se félicitent aujourd’hui de l’éviction de Morsi par une armée avec laquelle la collaboration en matière de renseignements et « d’anti-terrorisme » semble jamais n’avoir été meilleure…
Rappelons enfin que, devenue selon certains la dix-huitième du monde, avec des effectifs qui approchent du demi-million d’hommes, l’armée égyptienne absorbe les deux tiers de l’aide américaine ainsi que 15% du budget de l’État.
*
* *
Gardons aussi à l’esprit qu’en plus de la paix avec Israël, c’est l’Infitah de Sadate qui donnera à l’armée égyptienne l’occasion de se muer en un acteur essentiel de l’économie égyptienne (sans doute aussi parce que Sadate se méfiait de l’armée ; c’est pour l’apaiser qu’il choisira le général Hosni Moubarak comme vice-président) : les militaires – du moins les officiers supérieurs – sont aujourd’hui les plus gros propriétaires fonciers du pays, gestionnaires de zones franches (à Port-Saïd et à Suez), entrepreneurs (matériel agricole, armement, produits pharmaceutiques, BTP…) non soumis au droit du travail du secteur public et exonérés de taxes à l’importation des biens d’équipement, de surcroît bénéficiaires d’une série d’avantages en nature… Les secteurs économiques tenus par l’armée représentent aujourd’hui 30% de l’économie égyptienne et 70% du domaine foncier lui appartiennent.
Voilà qui, suffit, semble-t-il, à souligner combien les deux putschs, celui de 1952 et celui de 2013, sont différents.
Marx l’a écrit : lorsque les grands événements historiques se répètent, c’est, « la première fois, comme tragédie, la seconde, comme farce ».
En l’occurrence, la farce réside dans les discours des nouveaux maîtres du Caire. Et dans les comparaisons indues.
Pour le reste et dans les faits du quotidien égyptien, cette « seconde fois » s’apparente sans aucun doute à une tragédie.