Des dieux-rois de l’Antiquité aux rois de droit divin de France, en passant par les sultans-califes ottomans, « ombres de Dieu sur terre », la religion a historiquement servi à légitimer le pouvoir des souverains jusqu’à l’époque moderne.
Pendant des siècles, l’Europe chrétienne a connu une alliance indissoluble entre le trône et l’autel. En affirmant la souveraineté du peuple, la révolution française de 1789 ouvrit la voie à la séparation de l’Église et de l’État, qui finit par s’imposer un siècle plus tard en Occident.
Tout autre est la situation du monde musulman où le problème s’est posé historiquement de manière différente, d’une part, car il n’y avait pas d’institution ressemblant, même de loin, à une « Église » à séparer de l’État et, d’autre part, car l’islam, tel que conçu par Mahomet, était à la fois religion et État, croyance et code de vie socio-économique.
Rien n’échappe à la religion
Alors que le Christ vécu dans un milieu régit par la loi hébraïque et le droit romain (« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu »), le vide juridique caractérisant les tribus arabes où naquit le Prophète l’amena à légiférer dans tous les domaines à partir de son installation à Médine.
Il n’y avait en principe en islam qu’une seule loi, la loi révélée par Dieu : la charia, fondée sur le Coran et les Hadiths. « L’idée, écrit Bernard Lewis, qu’il puisse exister quelque chose qui échapperait à l’autorité de la religion, ce que les langues de la chrétienté désignent sous le nom de profane, temporel ou séculier, est totalement étrangère à la pensée musulmane. » Les califes, successeurs du Prophète, furent, comme lui, à la fois des chefs religieux, politiques et militaires.
Cependant, à partir du déclin du califat abbasside, les califes, réduits à un rôle honorifique, ne conservèrent que le pouvoir spirituel, et les sultans devinrent les véritables détenteurs du pouvoir temporel. Puis, à partir du XIXème siècle la plupart des pays musulmans furent amenés à restreindre le domaine d’application de la charia au droit de la famille et à adopter pour le reste des lois d’inspiration occidentale. Ce fut le cas notamment des « tanzimat » (réformes) ottomanes. Depuis lors, il existe dans les pays musulmans, à l’exception de la théocratie iranienne, une séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel et tous ont adopté nominalement un régime parlementaire.
Mais, même dans les pays qui ont une forte tradition séculière, comme la Tunisie ou la Syrie, l’islam est la religion officielle ou celle du chef de l’État. Et il constitue l’une des sources de la législation, malgré l’adoption de lois modernes. Tandis que d’autres pays, comme le Soudan et l’Arabie Saoudite wahhabite, appliquent la charia. Au Pakistan, il existe même une Cour suprême islamique qui a pour mandat de s’assurer que les lois du pays se conforment au Coran, ainsi qu’aux dires et aux actes du Prophète Mahomet. Lorsqu’une loi enfreint les principes de l’islam, selon ses juges, la cour doit demander aux élus d’amender la législation.
Islam et démocratie
La manifestation la plus marquante du poids de la religion dans les pays musulmans est l’émergence de l’islamisme politique.
L’islamisme sunnite comme le chiisme révolutionnaire ne sont pas, comme ils le prétendent, l’incarnation d’une authenticité islamique face aux idées et aux formes politiques importées du monde occidental. Du fait de leur idéologie totalitaire et autoritaire, tous les deux sont en rupture avec la tradition de l’islam classique.
L’islamisme politique sunnite s’est donné pour objectif d’abolir les lois laïques instaurées au cours des cent ans passés et les mœurs qui en découlent. Utilisant le langage du rejet et de la violence, il ne saurait en aucun cas apporter une réponse aux défis de notre temps, contrairement à ce que prétend le slogan « l’islam est la solution ». Son parcours a d’ailleurs été jalonné d’échecs, les partis s’en réclamant ayant pris le pouvoir par les urnes s’en faisant éjecter, comme en Égypte. Et ceux qui ont tenté de le faire par la force ont été écrasés, comme en Algérie et en Syrie.
Les principaux courants islamistes sunnites, les Frères Musulmans et les salafistes, ont en théorie la même démarche fondamentaliste. L’idéologie des Frères Musulmans est toutefois moins littéraliste au plan religieux et davantage orientée vers la politique. Alliant conservatisme moral, volonté de modernisation et action sociale, elle est parvenue à séduire de nombreux musulmans. Pour Hassan al-Tourabi, chef et théoricien des Frères Musulmans soudanais, le pouvoir émanant de Dieu ne connaît pas la notion de peuple souverain. Il se déclare à la fois contre la séparation de la religion et de la politique, contre la démocratie, « un concept fondamentalement occidental, étranger à l’islam », et contre le nationalisme qui contredit l’idéal de la communauté des croyants (oumma).
S’inscrivant contre cette conception, la Tunisie apparaît comme une exception dans le monde de l’islamisme politique arabe et apporte la preuve qu’on peut être intégriste religieux et accepter la démocratie. Ennahdha est désormais un parti de gouvernement, qui accepte une coalition avec d’autres partis.
L’AKP turc se présentait aussi comme un parti « démocrate-musulman » à l’instar des démocrates chrétiens ; mais la dérive autoritaire du président Erdogan dément cette prétention.
L’État islamique
Les salafistes (du mot « salaf », ancêtre, qui désigne les premiers musulmans) ont pour objectif la régénération de la foi et la réislamisation de la société. Le salafisme prône le retour à l’islam des origines par l’imitation de la vie du Prophète et de ses compagnons, et le respect aveugle de la Sunna. Il condamne toute interprétation théologique, en particulier par l’usage de la raison humaine, accusée d’éloigner le fidèle du message divin, ainsi que la démocratie et la laïcité.
Le salafisme a pour origine l’école hanbalite, la plus rigoureuse des quatre écoles juridiques islamiques, qui inspira le wahhabisme. Il se divise en deux courants principaux : les salafistes quiétistes, apolitiques et uniquement préoccupés de vivre en symbiose avec les prescriptions coraniques, et les salafistes jihadistes qui ont une vision révolutionnaire de l’islam qui légitime l’usage de la violence pour une cause « juste » : l’instauration d’un État islamique.
Inspiré par Sayyed Qotb, idéologue égyptien condamné à mort et exécuté en 1966, le jihadisme contemporain est une synthèse entre le salafisme et la stratégie de prise de pouvoir des Frères Musulmans. Il est représenté par trois tendances : celles qui privilégient le combat dans un cadre national ; celle d’Al-Qaeda qui entend porter la lutte contre les infidèles à l’échelle mondiale ; et celle de « l’État islamique » (EI), dont le chef s’est autoproclamé calife après avoir conquis un territoire à cheval sur la Syrie et l’Irak avec la volonté de relever le Califat.
La portée symbolique de cette proclamation du Califat revêt une dimension messianique et millénariste qu’est loin d’avoir la notion « d’État islamique ». Reflétant une ambition dépassant celle de tous les groupes jihadistes avant elle, cette organisation terroriste (l’EI) se pose comme rival de l’Iran chiite et rassembleur des sunnites. Elle a supplanté Al-Qaeda à l’avant-garde du mouvement jihadiste international.
Alors que l’islamisme sunnite n’a connu que des échecs, ce n’est pas le cas de la révolution iranienne qui concerne le monde chiite, au sein duquel l’influence politique des clercs est beaucoup plus importante qu’au sein du sunnisme.
Au-delà de la répartition formelle des pouvoirs conférés par la constitution, le régime islamique en Iran repose sur une multiplicité d’acteurs. Le pays a deux gouvernements : un gouvernement séculier, dirigé par un président de la République démocratiquement élu, et une hiérarchie de religieux conservateurs, dirigée par un guide suprême. Nommé à vie et chef des armées, le Guide a également sous son autorité des organes lui permettant d’assurer son emprise sur la société comme les Bassijis, une milice de choc particulièrement brutale, les Gardiens de la Révolution (Pasdaran) et une police urbaine chargée de faire respecter les mœurs islamiques. En fait, c’est lui et non le président qui est détenteur du pouvoir, à travers la jurisprudence et en tant que docteur de la loi islamique, « velâyat e faquih ». Cela dit le statut de juriste suprême revendiqué par l’ayatollah Khomeiny et son successeur, Ali Khameney, est un produit de la révolution iranienne plus que de l’islam même, et est contesté par certaines écoles (« hawza ») chiites quiétistes traditionnelles.
*
* *
La question de l’islam des origines n’est pas compliquée : l’islam, contrairement, par exemple, au christianisme des origines, est politique.
La question est donc autre : l’islam du XXIème siècle est-il politique et les pays musulmans peuvent-ils accéder à un régime démocratique ?
Le coup d’arrêt donné au mouvement de sécularisation et qui caractérise la situation politique actuelle de plusieurs pays musulmans, de la Turquie à l’Iran en passant par les pays arabes, semble donner raison à ceux qui soutiennent qu’islam et démocratie sont définitivement incompatibles.



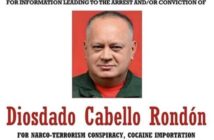

1 Comment
La déliquescence des régimes politiques arabes, aidés en cela par l occident, n est- elle pas un formidable moteur de la forte résurgence de l islam politique? Proportionnellement parlant, le poids politique de cette tendance ne dépasse guère celui de l extreme droite , en occident.