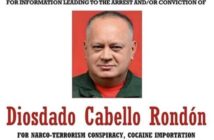Quelques 6.500 morts et plus de 10.000 blessés depuis mars 2015, plus de 2 millions de personnes déplacées, un pays au bord de la crise humanitaire, des combats et affrontements continus, comme le démontrent les récentes attaques contre le port de Hodeïda, voici la réalité de la guerre au Yémen.
Le Yémen, bien qu’il n’ait bénéficié que d’une maigre couverture médiatique, est en proie au conflit qui a donné lieu à la plus grave crise humanitaire au monde, selon le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
* * *
Qualifiée de « guerre oubliée » par Amnesty International, la guerre au Yémen opposant les forces du président Hadi (soutenu par une coalition internationale menée par l’Arabie saoudite) aux rebelles Houthis serait le théâtre d’une série de violations des règles du droit des conflits armés, qualifiables éventuellement de crimes de guerre.
Cette contribution se focalisera justement, dans un premiers temps, sur ces violations et crimes de guerre potentiels commis par les parties belligérantes.
Dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la responsabilité éventuelle des États tiers en lien avec les violations identifiées, en insistant plus particulièrement sur la question de la vente d’armes par certains États à l’Arabie saoudite, dont les États-Unis d’Amérique, la Belgique et la France.
Mais, pour que les règles du droit des conflits armés puissent s’appliquer, il faut d’abord démontrer que la situation peut être qualifiée de conflit armé. C’est donc par la qualification de la situation au Yémen que nous devons commencer notre analyse.
La qualification des conflits au Yémen : des conflits armés non-internationaux malgré les interventions étrangères
La situation au Yémen est très complexe et implique plusieurs acteurs, tant étatiques que non-étatiques.
En effet, à part les forces fidèles au président Hadi et celles des rebelles Houthis, sont – ou ont été – également impliqués dans les hostilités Al-Qaeda dans la Péninsule arabique, l’État islamique, ainsi que le réseau de l’ex-président du Yémen, Ali Abdullah Saleh. À côté de ces acteurs, il faut également mentionner les forces armées de la coalition menée par l’Arabie saoudite, ainsi que l’Iran, accusé d’aider tant les forces houthistes que celles qui soutenaient l’ex-président Saleh.
Comment cette situation complexe doit-elle être qualifiée juridiquement ?
Selon la définition universellement acceptée, un conflit armé non-international n’existe que si les deux conditions suivantes sont remplies.
La première : on doit être en présence de parties identifiables ; en d’autres termes, les parties ou groupes armés qui s’opposent doivent disposer d’un minimum d’organisation.
La seconde : les hostilités entre les parties doivent atteindre un certain degré d’intensité.
Le CICR affirme qu’il existe plusieurs conflits armés au Yémen, sans toutefois préciser quelles sont les parties belligérantes dans chacun de ces conflits. Ce manque de précision est sans doute dû au nombre des forces armées présentes dans le pays ainsi qu’à l’évolution continue de la réalité sur le terrain, la composition de ces différentes forces et les alliances entre-elles étant en constante évolution.
Sans faire un inventaire complet de ces conflits –chose impossible sans connaissance approfondie des faits-, nous pouvons affirmer qu’il existe en tout cas un conflit armé non-international qui oppose les forces du président Hadi aux rebelles Houthis.
Malgré les doutes qui ont pu être exprimés à ce sujet, le Conseil de Sécurité (ONU), dans la résolution 2216, adoptée en 14 avril 2015, a réitéré son soutien à la légitimité du président Hadi. Ainsi, l’intervention des forces de la coalition menée par l’Arabie saoudite au Yémen à la demande de Hadi s’est réalisée avec le consentement du gouvernement légitime du pays.
Si l’on se tient à la position du CICR, une telle intervention n’internationalise pas le conflit armé au Yémen.
De même, le soutien fourni par l’Iran aux rebelles Houthis n’arrive pas au seuil nécessaire pour que l’Iran devienne une véritable partie au conflit et que le conflit puisse être considéré comme international.
Dès lors, le conflit opposant les Houthis aux forces du président Hadi demeure un conflit armé non-international.
Cette qualification implique que les parties belligérantes au conflit (d’une part, les forces fidèles au président Hadi aidées par celles de la coalition menée par l’Arabie saoudite et, d’autre part, les rebelles Houthis) sont liées par les grands principes du droit des conflits armés.
Or, il s’avère que ces principes sont violés par toutes les parties aux conflits yéménites.
Yémen : le théâtre de nombreuses violations du droit des conflits armés
Les experts nommés par le Conseil de Sécurité des Nations Unies ont à plusieurs reprises fait état des violations des règles du droit humanitaire par toutes les parties belligérantes au Yémen.
Déjà dans leur rapport rendu en 2016, les experts affirmaient que « toutes les parties au conflit qui déchire le Yémen ont violé les principes de discrimination, proportionnalité et précaution, notamment en utilisant […] des armes explosives de forte puissance contre des zones résidentielles et des biens de caractère civil, ou à proximité de telles zones ou de tels biens. Les attaques ayant été généralisées ou systématiques, elles remplissent potentiellement les critères juridiques constitutifs de crime contre l’humanité ».
En effet, plusieurs des frappes aériennes réalisées par la coalition menée par l’Arabie saoudite ont été pointées du doigt comme étant constitutives de violation du droit international humanitaire, soit parce que les experts n’ont trouvé « aucune preuve attestant que les frappes aériennes visaient des objectifs militaires légitimes », ce qui implique une violation du principe de distinction selon lequel les attaques ne doivent pas être dirigées contre des personnes ou des biens civils, soit parce que « les attaques de la coalition dérogeaient aux exigences de proportionnalité et de précaution imposées par le droit international humanitaire ».
Les experts concluent que « certaines de ces attaques pourraient constituer des crimes de guerre ». Quant aux forces du gouvernement Hadi, celles-ci sont responsables d’actes constitutifs de déplacement forcé de civils et d’entrave à la fourniture de services médicaux.
Les forces houthistes et celles proches de l’ex-président Saleh ont également commis des violations des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution « en se livrant à des bombardements ciblés et à des tirs de roquette sans discrimination ». Ils sont aussi responsables, selon les experts du Conseil de Sécurité, du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans ce conflit armé.
Concernant la protection des personnes hors de combat et plus précisément des personnes privées de liberté, selon les experts, tant les forces du président Hadi que les forces des rebelles Houthis se sont livrées, entre autres, aux actes de détention arbitraire, de disparition forcée, de torture et de mauvais traitements.
La question de la responsabilité pour les violations du droit humanitaire : les États « auteurs » et les États « complices »
Face à l’ampleur des violations des règles du droit humanitaire, quels États peuvent-ils être considérés comme responsables ?
De prime abord, il s’agit évidemment des États dont les forces armées ont commis les violations du droit humanitaire en question.
À cet égard, le rapport rendu en 2017 par les experts du Conseil de Sécurité précise, à juste titre, que tout État dont les forces participent de quelque manière que ce soit aux opérations militaires de la coalition est « responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées » et que ces États « ne peuvent se soustraire à leurs obligations en plaçant leurs contingents à la disposition d’une coalition ad hoc ».
Mais la responsabilité ne se limite pas uniquement aux États ayant participé aux attaques de la coalition de manière active.
En vertu de l’article 1er commun aux quatre Conventions de Genève de 1949, tous les États parties aux Conventions de Genève ont l’obligation non seulement de respecter mais aussi de « faire respecter » les règles du droit international humanitaire.
Selon le CICR – et cette interprétation est partagée par les experts du Conseil de Sécurité –ceci implique une obligation « de ne pas encourager ni apporter aide ou assistance à la commission d’une violation des Conventions. Le fait, par exemple, pour [un État]de contribuer à financer, équiper, armer ou entraîner les forces armées d’une partie à un conflit […] le place dans une position privilégiée pour influencer le comportement de ces forces et donc pour faire respecter les Conventions ».
Cette idée trouve une application concrète dans l’article 6 (§3) du Traité sur le Commerce des Armes conclu en 2013 et entré en vigueur le 24 décembre 2014 : « Aucun État n’autorise le transfert d’armes classiques […] s’il a connaissance, au moment où l’autorisation est demandée, que ces armes […] pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie. »
* * *
Comme on l’a vu, les rapports du groupe d’experts du Conseil de Sécurité des Nations Unies contiennent d’amples informations relatives à la commission des violations des règles du droit humanitaire et, potentiellement, des crimes de guerre et crimes contre l’humanité.
De même, dans un communiqué de presse du 8 août 2017, le CICR a lui aussi condamné « la récurrence des frappes aériennes contre des civils » en ces termes : « [D]es lieux publics, comme les marchés, ainsi que des habitations civiles sont régulièrement pris pour cible par les belligérants. C’est une tendance que nous déplorons et qui va à l’encontre des principes essentiels du droit des conflits armés. »
Eu égard à l’ampleur et au caractère public de ces informations, il nous semble hautement improbable que les États impliqués dans un commerce d’armes avec l’Arabie saoudite puissent prétendre, pour reprendre les termes de l’article 6 (§3) du Traité sur le Commerce des Armes, qu’ils n’avaient pas connaissance « que ces armes pourraient servir à commettre des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre ». Un tel commerce serait donc contraire tant à l’obligation énoncée dans le traité de 2013 qu’à l’obligation de faire respecter le droit humanitaire, énoncée dans l’article 1er commun aux Conventions de Genève, obligation qui a acquis le statut de norme coutumière.
Reste à voir ce que les gouvernements des États concernés (par exemple, les États-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni ou la Belgique) feront pour se conformer à cette obligation.
Malgré les appels à cet effet, rien de concret ne semble avoir été fait jusqu’à présent…