Il est très souvent difficile de le retrouver, l’étroit sentier de la vérité, tout comme celui de l’indépendance, lorsqu’on s’est perdu dans les coulisses obscures du club pas toujours très honorable des médias « d’information » ; où les compromissions et contingences diverses qui jonchent le chemin du pèlerin sont parfois à ce point implacables qu’elles le détournent inexorablement de l’objet de sa quête.
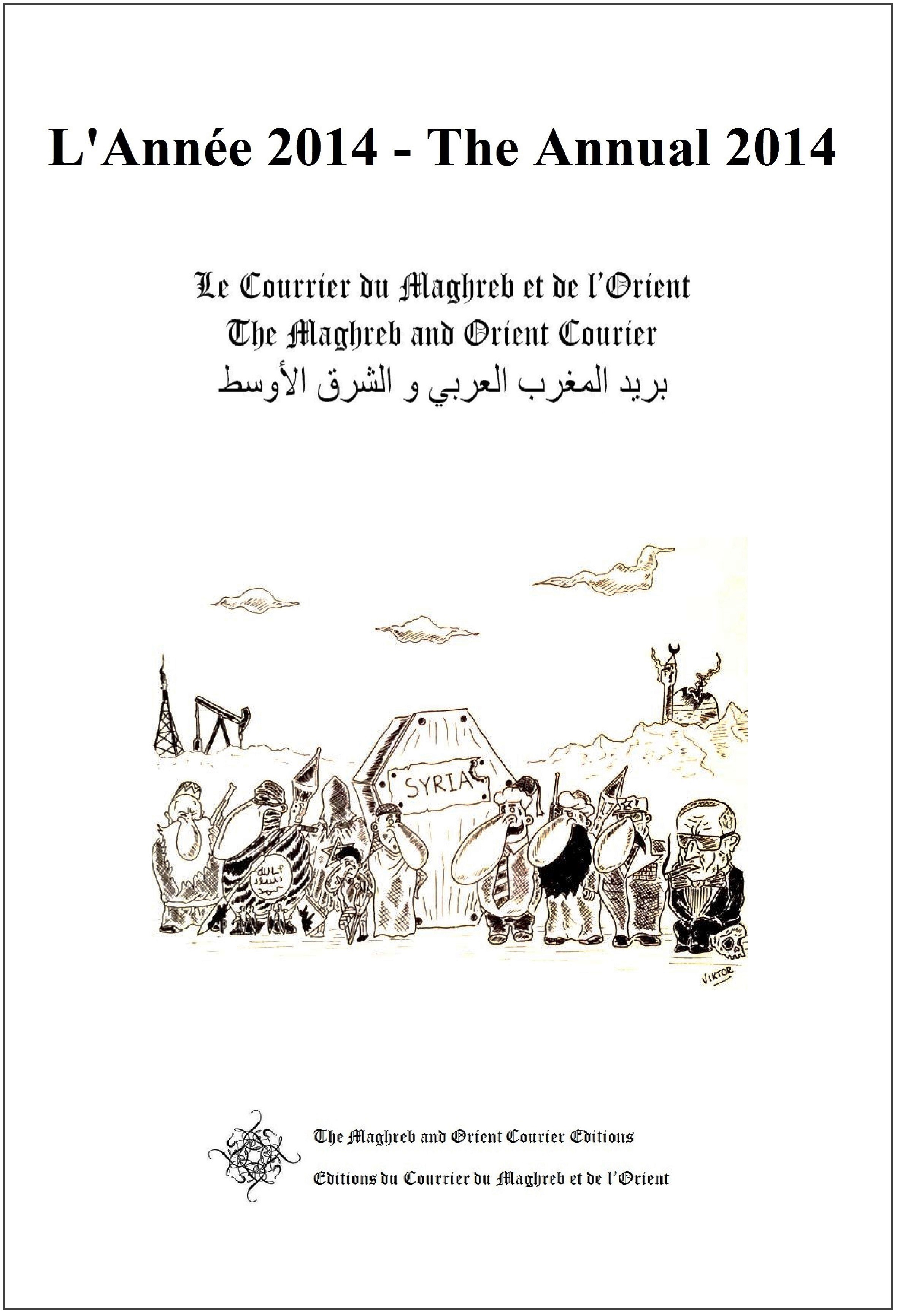 La publication de l’Annual 2014 du Courrier du Maghreb et de l’Orient, en cette rentrée de septembre, a ainsi été l’occasion pour notre rédaction de s’interroger sur le bilan d’une année et demie d’existence, une année et demie de liberté et de sincérité, un pari bien difficile à tenir sur le long terme…
La publication de l’Annual 2014 du Courrier du Maghreb et de l’Orient, en cette rentrée de septembre, a ainsi été l’occasion pour notre rédaction de s’interroger sur le bilan d’une année et demie d’existence, une année et demie de liberté et de sincérité, un pari bien difficile à tenir sur le long terme…
La réflexion s’imposait avec d’autant plus d’acuité que 2015 fut une année noire pour la presse, sur laquelle se sont encore resserrées les deux mâchoires de l’étau castrateur que sont l’actionnariat, d’une part, et, d’autre part, les agences publicitaires dont dépend la survie de nombreux médias « mainstream » : dans le contexte de la crise actuelle, des groupes financiers ou industriels sans complexe aux ramifications transversales s’offrent journaux et chaînes de télévision en difficulté économique, revendus au rabais, et leur imposent ensuite d’autorité la ligne éditoriale qui convient le mieux à leurs intérêt multiples ; d’autres sanctionnent indirectement les rédactions qui n’obtempèrent pas ou déplaisent, en leur retirant les budgets publicitaires qui les financent en grande partie –la méthode n’est pas nouvelle, mais elle se généralise désormais comme le meilleur moyen de contrôler le formatage de « l’information »…
La conséquence est sans appel : non, « les médias [ne] vous mentent [pas] sur tout ! », bien sûr ; mais les rédactions omettent certains sujets, qui disparaissent ainsi de « l’actualité », et certains dossiers ne sont pas présentés comme ils devraient l’être, c’est-à-dire dans tous leurs aspects et en tenant compte de tous les points de vue, quand d’autres ne font pas plus simplement l’objet d’un matraquage univoque qui confine à la propagande grossière. En outre et plus encore, les intérêts convergents des propriétaires de ces groupes de presse (ainsi mis sous tutelle de l’argent) génèrent une progressive uniformisation de « l’information », au détriment de la diversité d’expression et de toute forme d’esprit critique.
Le plus à plaindre est trop souvent le rédacteur en chef, ainsi réduit à la fonction de sbire, d’homme de main qui fait le sale boulot pour ses employeurs, intermédiaire entre l’actionnariat (ou le bailleur de fonds) et l’équipe journalistique, lui qui reçoit les ordres des « propriétaires » et doit les faire accepter par sa rédaction. C’est lui qui prend sur les doigts, si tout ne se passe pas comme décidé en haut lieu, et qui prend dans la figure, s’il reste encore dans son staff quelques fortes têtes bien décidées à résister et à faire le métier auquel elles avaient choisi de consacrer leur vie… Heureusement pour lui, ces empêcheurs de manipuler en rond sont de moins en moins nombreux ; la plupart des journalistes a depuis longtemps assimilé les principes élémentaires de « l’autocensure » : on sait ce qu’on peut écrire et la manière dont il faut présenter certains sujets, ce qui va passer, et ce qu’il ne faut surtout pas dire… pour ne pas se fâcher avec le rédac’ chef… De toute façon, heureusement aussi pour ce dernier, il y a toujours la solution du prochain plan social, ces plans de « restructuration », de « réduction du personnel », qui, depuis quelques années, se succèdent et permettent, à l’occasion, de se débarrasser des entêtés… Personne n’est à l’abri ; même les « vedettes » savent qu’elles sont sur un siège éjectable et que, le cas échéant, elles seraient vite oubliées, enterrées.
Comment en est-on arrivé là ? À qui la faute ?
Reprenons les bases du problème : un média, quotidien imprimé, revue ou chaîne télévisée, ça coûte très cher. Pour financer les salaires des personnels, la maintenance des locaux, les frais de déplacement et de reportage, etc., il faut beaucoup d’argent, tous les jours ; et ce ne sont plus ni la vente du journal dans les kiosques, ni les maigres recettes publicitaires, corrélativement en chute libre, qui peuvent assurer des rentrées suffisantes et la pérennité de l’entreprise.
Aussi, il faut absolument, désormais –et plus qu’auparavant-, des actionnaires, prêts à investir des fonds importants dans une entreprise qui… perd de l’argent (ou qui, en tout cas, n’en rapporte guère).
Peu fréquents étant les mécènes désintéressés prêts à donner généreusement sans rien obtenir en retour, la question s’impose : qu’attendent-ils, ces financiers et industriels, lorsqu’ils s’achètent un média ?
C’est l’évidence même : un moyen d’influencer l’opinion publique, dans les domaines qui les préoccupent, et rien d’autre ; et ce, évidemment, au moindre coût possible.
Le résultat est alarmant, concernant la presse, ce « quatrième pouvoir » qui façonne l’opinion et se targue (encore) de jouer le beau rôle de « porte-voix de la vérité et garant de la démocratie ».
Comment, ainsi, ne pas rappeler à quel point la presse internationale a été (et demeure) un facteur déterminant dans la mauvaise interprétation des ces phénomènes socio-économiques qui ont été rassemblés sous l’appellation générique de « Printemps arabe » ?
Des « journalistes », absents du terrain des événements et ignorant tout ou presque des réalités politiques et sociologiques des pays et populations concernées, ont émis des « avis », des « analyses », produites à travers des prismes occidentalo-centriques, allant, dans leur enthousiasme, leur méconnaissance des sociétés arabes, de leur pluralité, de leurs spécificités et singularités, ou encore leur incompréhension des phénomènes, jusqu’à comparer les révoltes arabes, pourtant si différentes les unes des autres, à la Révolution française de 1789 ou au Printemps de Peuples de 1848.
L’incompétence donc –si elle n’est pas seule en cause, elle ne doit cependant pas être éludée-, souvent, explique les erreurs assénées comme des vérités.
Souvenir d’ancien combattant… La rencontre, très tard, un soir, de cette jeune journaliste dont, par charité chrétienne, je tairai le nom du média qui l’avait envoyée à Antakia, à la frontière turque, où je me préparais à entrer en Syrie, pour y rejoindre la rébellion, à Alep. C’était en juillet 2012… La jeune fille n’avait jamais travaillé dans le Moyen-Orient ; elle en ignorait tout. Mais elle était « journaliste », n’était-il pas ? Mot magique qui qualifie de facto n’importe quel badaud titulaire d’une carte de presse… et en fait un expert « capable » de traiter tous les sujets, aussi complexes fussent-ils… D’où, probablement, la question qu’elle m’a posée, un peu désespérée car elle allait passer à l’antenne le lendemain matin : « Si je comprends bien, les rebelles attaquent Alep… C’est la capitale de la Syrie, alors ? »
Faire des reportages sur la Syrie depuis la Turquie… C’est aussi un symptôme intéressant de l’état des médias aujourd’hui : donner au public l’impression que le journaliste est au cœur de l’action, en l’envoyant dans un pays voisin, où il n’y a rien à craindre ni rien à apprendre… Phénomène encore plus pervers et malhonnête, ces quelques médias qui présentaient des reportages « en direct de Syrie »… Où se trouvaient en effet leurs envoyés spéciaux… Dans des zones parfaitement sécurisées par la rébellion (l’Armée syrienne libre) ou par l’armée régulière, où il ne se passait absolument rien et où il n’y avait rien à voir… Rapide petit aller-retour depuis la frontière turque ou libanaise…
La « sous-culture journalistique » que dénonçait en son temps déjà le président français François Mitterrand…
Mais ce fond de bêtise ambiante est loin d’être le seul chancre qui nécrose les médias de « l’information ».
L’instantanéité de « l’information » en est un autre. Internet ne laisse plus le temps aux rédactions de vérifier ce que rapportent leurs sources : si on prend le temps d’une vérification, d’un recoupement, on est battu à la course par les autres. Le journaliste qui reçoit « l’info » tombe dès lors aisément dans les panneaux de la guerre de propagande que se livrent sans pitié les protagonistes du terrain et répercute à grande vitesse n’importe quel bobard, sans aucun état d’âme ; il lui incombe uniquement de bien choisir le camp qu’il va croire, de ne pas se tromper sur le « bon camp », celui que tous les autres vont adouber (les rebelles syriens, par exemple, qui apparaissaient plus sympathiques, au début en tout cas… plutôt que le gouvernement de Bashar al-Assad).
Subséquemment, en effet, se constitue une « doxa médiatique » : la presse se nourrit d’elle-même ; on puise chez les autres ce qu’on va publier soi-même ; une « vérité » prend donc très vite forme, sur un sujet donné, à laquelle on ne déroge plus, car la presse se veut « crédible » et ne se contredit pas (ou exceptionnellement) et reproduit son propre discours et amplifie cette « réalité virtuelle », parfois très en déconnexion avec la (vraie) réalité du terrain. C’est en cela que le journaliste ne doit pas se tromper de camp, car celui qui déroge à la doxa est pris en chasse et réduit au silence par tous les moyens. On ne publie pas ses textes ; et, s’il parvient tout de même à faire entendre sa voix, on le discrédite alors par des attaques ad hominem, on le disqualifie, et plus personne ne l’écoute dès lors : c’est haro sur le baudet ; avec hargne, surtout si le malheureux apporte des éléments probants qui mettent sans ambiguïté en cause la fiabilité de l’ensemble des médias qui ont répercuté « l’info » erronée.
La presse n’a plus peur de colporter des « fakes »… Tout cela n’est effectivement pas très grave, in fine ; c’est sans conséquence… Le public accepte tout ; et puis, la presse, ça marche comme ça : tout le monde dit la même chose et, parce que tout le monde dit la même chose, personne ne reprochera jamais à quiconque de s’être trompé.
Mais il en va autrement si on a raison tout seul : réduit au silence, discrédité, on ne se relève que très péniblement. Le public se souvient seulement qu’on n’était pas « crédible », que tous les médias « sérieux » l’ont affirmé. Ils n’a plus mémoire des tenants et aboutissants… et personne ne reviendra en arrière pour écrie : « Mais… Lui, là… Il avait raison ! »
 Un exemple vécu, en guise d’illustration bien concrète de ces deux travers qui grèvent l’information : le 20 novembre 2011, la presse occidentale a comme un seul homme annoncé la destruction du siège du parti Baath, à Damas, par des tirs de roquettes de l’Armée syrienne libre, et a de facto conclu à la chute imminente du régime de Bashar al-Assad (les presses russe et chinoise avaient fait preuve de beaucoup plus de circonspection)… Connaissant particulièrement bien le terrain et la situation à Damas, dont je revenais à peine, très dubitatif, j’ai pris quelques contacts téléphoniques et via Facebook : il ne m’a pas fallu plus de dix minutes pour avoir complète infirmation. Non seulement le siège du Baath, l’un des bâtiments les mieux gardés de la capitale syrienne, était intact, mais il n’avait pas même été attaqué. Le lendemain, à ma demande, l’un de mes correspondants à Damas m’a envoyé une photographie de l’immeuble, avec en premier plan la une d’un quotidien occidental qu’il brandissait pour authentifier l’image. Quel scoop en perspective ! Et bien non… J’ai envoyé cette photographie et un billet à quelques amis dans différentes rédactions… Personne n’a voulu publier… Évidemment. La doxa était que le siège du Baath à Damas avait brulé et que Bashar al-Assad allait bientôt être renversé ; il était impossible d’écrire le contraire.
Un exemple vécu, en guise d’illustration bien concrète de ces deux travers qui grèvent l’information : le 20 novembre 2011, la presse occidentale a comme un seul homme annoncé la destruction du siège du parti Baath, à Damas, par des tirs de roquettes de l’Armée syrienne libre, et a de facto conclu à la chute imminente du régime de Bashar al-Assad (les presses russe et chinoise avaient fait preuve de beaucoup plus de circonspection)… Connaissant particulièrement bien le terrain et la situation à Damas, dont je revenais à peine, très dubitatif, j’ai pris quelques contacts téléphoniques et via Facebook : il ne m’a pas fallu plus de dix minutes pour avoir complète infirmation. Non seulement le siège du Baath, l’un des bâtiments les mieux gardés de la capitale syrienne, était intact, mais il n’avait pas même été attaqué. Le lendemain, à ma demande, l’un de mes correspondants à Damas m’a envoyé une photographie de l’immeuble, avec en premier plan la une d’un quotidien occidental qu’il brandissait pour authentifier l’image. Quel scoop en perspective ! Et bien non… J’ai envoyé cette photographie et un billet à quelques amis dans différentes rédactions… Personne n’a voulu publier… Évidemment. La doxa était que le siège du Baath à Damas avait brulé et que Bashar al-Assad allait bientôt être renversé ; il était impossible d’écrire le contraire.
Autre illustration, autre exemple vécu : le vendredi 15 juillet 2011, j’étais entré dans Hama, cœur de la contestation en Syrie, où l’opposition avait annoncé une immense manifestation, à la sortie de la prière de la mi-journée, dans cette ville cernée par l’armée régulière. En soirée, l’AFP a lancé « l’info » -fournie par le fameux Observatoire syrien des Droits de l’Homme (OSDH), un groupe d’opposants au régime baathiste, basé à Londres et qui, des années durant, a sciemment désinformé les médias mainstreams très complaisants à l’égard de cet organisme qui alimentait parfaitement leur doxa-, « info » reprise par tous les médias occidentaux sans exception, selon laquelle les rues de Hama avaient été envahies par plus de 500.000 manifestants. Depuis le début de la révolution, j’avais régulièrement et très librement sillonné la Syrie en long et en large, dans un banal véhicule de location… et constaté la disproportion ahurissante qui existait entre la réalité du terrain, plutôt calme dans l’ensemble, et le tableau qu’en brossaient les médias inspirés par l’OSDH, source quasi unique, celui d’un pays mis à feu et à sang… Aucune rédaction ne s’est interrogée sur cette manifestation monstre de 500.000 habitants ; personne n’a rien vérifié… Hama comptait alors 370.000 habitants ; les manifestants étaient moins de 4.000… Que fait un analyste politique qui reçoit cette « info », reprise dans tous les médias –et donc bien évidemment « fiable » ? Il en conclut –ce qui fut le cas à l’époque- que le régime est sur le point de tomber et que le président Bashar al-Assad peut immédiatement faire ses valises et prendre un billet d’avion pour Moscou. Cette fois-là, le magazine Afrique-Asie avais publié mes photographies et ma relation des événements, dans laquelle j’accusais les mainstreams d’incompétence, Euronews et Le Monde en particulier -vu la réalité constatée sur le terrain, j’avais aussi écrit que le régime avait encore de nombreuses années devant lui ; on m’avait alors qualifié d’idiot et de partisan de la dictature… Le Monde a contre-attaqué (« Pierre Piccinin da Prata, qui dit s’être rendu en Syrie… » -alors, ça, c’est toujours très sympa’ ; « qui dit… » ; ou comment insinuer et discréditer…), affirmant que Hama comptait 800.000 habitants. Le journaliste du Monde n’avait pas tort… Le « gouvernorat » de Hama, en effet, c’est-à-dire de la province dans son ensemble, compte bien 800.000 habitants. Confondrait-il ainsi la population de Paris avec celle de toute l’Île de France ?
Comment de telles erreurs et une telle médiocrité sont-elles possibles ?
Probablement, plus que l’incompétence ou l’instantanéité de l’information, faut-il épingler un problème structurel : les envoyés spéciaux sont de plus en plus rares ; assurances, frais d’hébergement, les fixers sur place, frais de transports… Tout cela coûte trop cher face aux calculs des actionnaires qui n’ont pas pour but d’informer, mais d’influencer, sans plus ; c’est pour eux la seule « utilité » du média, inutile de dépenser davantage qu’il ne faut pour atteindre cet objectif… D’où la suppression des missions d’investigation sur le terrain, la réduction drastique des personnels et l’abonnement systématique aux grandes agences de presse, qui réduisent elles-mêmes au maximum les coûts, en ayant recours des expédients peu fiables… Ce sont ces dernières qui vendent l’info ; les médias ne sont plus que des intermédiaires, qui revendent l’info à leurs lecteurs et auditeurs… Avec une rédaction devenue endémique, très réduite et qui ne quitte presque plus ses bureaux, on peut ainsi écrire tout un journal, sur base des seules dépêches d’agence, non-vérifiées, non recoupées, souvent mal rédigées, mal traduites et mal interprétées…
Une « info » biaisées, une « désinfo »…
Face à cette conjoncture devenue quasiment inextricable, quelques médias essaient de garder le cap de l’autonomie et de la vérité. Le Courrier du Maghreb et de l’Orient en a fait le pari, dans ce domaine aujourd’hui particulièrement éminent et sujet aux polémiques et à la « désinformation », celui du Monde arabe…
Son équipe extrêmement qualifiée et la qualité des analyses que ses membres proposent à leurs lecteurs lui assurent jusqu’à présent un lectorat en continuelle progression, mois après mois, édition après édition.
Toutefois, le pari économique devient peu à peu insoutenable : la croissance de notre revue, en quelque sorte victime de son succès, et la gestion de la publication nécessitent dorénavant des investissements et l’engagement de personnel administratif. Notre formule, celle d’une revue on line, a jusqu’ici permis d’éviter un grand nombre de coûts qu’engendrerait une publication-papier. Mais Internet n’est pas la panacée…
C’est donc le nouveau défi auquel est mise notre équipe internationale, et qu’il nous sera impossible de surmonter sans l’aide active de nos lecteurs ; car, in fine, qui plus que ses lecteurs eux-mêmes, ferait un meilleur actionnaire, soucieux de préserver l’intégrité et l’indépendance d’un média à la recherche de la vérité ?




