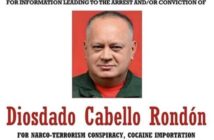Par deux parcours différents, Nelson Mandela et Mohamed Morsi sont devenus des figures emblématiques de résistance, de dignité et de sacrifice.
Mandela, avocat de formation, membre du Congrès national africain (qui lutta contre l’apartheid dès 1943) et dont il devint l’un des principaux dirigeants… Mandela, qui a appelé en 1952 à une campagne de désobéissance civile pour redonner leur place aux citoyens sud-africains de couleur…. Un échec face à la brutalité répressive du gouvernement des blancs.
Mandela avait dès lors, en 1961, opté pour l’usage de la force contre le régime de l’apartheid. En 1964, Mandela a été arrêté et condamné à la prison à perpétuité, où il allait passé vingt-sept années de sa vie, sans jamais renoncer à son combat. Il deviendra le symbole de la lutte acharnée pour la justice et la liberté.
Le sort du président Mohamed Morsi est différent. S’il est aujourd’hui un symbole pour certains Égyptiens, il a été oublié par beaucoup d’entre eux et par le reste du monde.
Pourtant, à l’annonce de la destitution du président Morsi par le chef de l’armée, le général al-Sissi, le 3 juillet 2013, des dizaines de milliers de personnes avaient manifesté en brandissant son portrait, réclamant le retour du premier président démocratiquement élu dans toute l’histoire de l’Égypte. En Malaisie, en Indonésie, en Afrique du sud, au Mali, au Nigeria, au Soudan, dans tout le Maghreb… Des manifestations avaient condamné le coup d’État en Égypte et la violation de la démocratie naissante.
Mais, alors que Mandela finit par recevoir le soutien de nombreuses organisations de défense des Droits de l’Homme qui amenèrent plusieurs gouvernements occidentaux à s’intéresser à son cas et à prendre position contre l’apartheid (un régime que l’Occident ne considérait plus comme indispensable après la désintégration de l’Union soviétique), Mohamed Morsi a en revanche fait les frais d’un accommodement général de la part de tous les acteurs impliqués dans la question égyptienne.
Moi, Mohamed Morsi
Né en 1951 dans un village isolé, al-Sharqiya, dans le delta du Nil au nord-est du Caire, Mohammed Morsi grandit dans une famille de paysans pauvres et aurait repris la charrue de son père si ce dernier ne l’avait poussé dans ses études. C’est ainsi qu’il finira diplômé en ingénierie civile de l’université du Caire, en 1975. Son parcours universitaire se poursuit aux États-Unis où il obtient en 1982 un doctorat de l’université de Californie, où il enseigne quelques années.
En 1985, Mohamed Morsi renonce à la carrière qui se présente à lui ; il rentre en Égypte pour se consacrer à son gouvernorat natal et enseigner à l’université de Zagazig, et non pas au Caire, le centre scientifique, culturel et du pouvoir dans le pays.
Depuis 1979, il a adhéré à la Confrérie des Frères musulmans, le mouvement islamique le plus puissant d’Égypte depuis sa fondation en 1928. C’est dans ce cadre qu’il veut servir son pays et la cause de l’Islam politique ; c’est l’idéal qu’il s’est choisi, et sa personnalité sert son projet : organisé et obsédé par le travail, capable de motiver des groupes et discipliné, reconnu pour son attitude raisonnable et pragmatique, il s’impose en très peu de temps comme l’une des chevilles ouvrières de ce mouvement où les qualités utiles et le mérite constituent le premier critère d’avancement.
Morsi est donc désigné par la Confrérie des Frères musulmans pour représenter le mouvement au parlement égyptien. : élu député en 2000 et 2005, à la chambre basse du parlement, il y dirige le bloc d’opposition et le groupe parlementaire des Frères, face au Parti national démocratique (PND) de Moubarak.
Convaincu que la voie démocratique est possible en Égypte, il s’active personnellement à la tracer. En 2006, il est condamné à sept mois de prison pour avoir participé à une marche de soutien aux magistrats qui réclamaient une réforme de la Justice. Il préconise des alliances politiques des Frères avec les différentes forces d’opposition et parvient à promouvoir des rapprochements, notamment avec les libéraux, pour exiger des réformes en Égypte. La Confrérie lui octroie ainsi la fonction de porte-parole et une place au sein de son bureau politique.
Lorsqu’en 2010, le contexte devient très critique économiquement, une situation qui entraîne de fortes tensions sociales et voit s’exacerber les revendications politiques pour un changement de régime, plusieurs personnalités de la société civile égyptienne, tel Mohamed el-Baradai, l’ancien directeur général de l’Agence internationale de l’Énergie atomique (AIEA), ainsi que plusieurs factions d’opposition à l’appareil du régime, comme les organisations 6 avril et Kefaya, décident de se rassembler, avec les Frères musulmans, et s’accordent sur la fondation d’un mouvement visant la réforme démocratique en Égypte.
Cette alliance, baptisée « Association nationale pour le changement », bénéfice largement de la force de mobilisation des Frères musulmans, dont Mohamed Morsi est désormais le chef du bureau politique : ce sont les Frères qui apportent 700.000 du million de signatures en faveur de la pétition lancée par l’association pour exiger les réformes en Égypte.
Le 28 janvier 2011, quatrième jours des manifestations qui ont spontanément éclaté et s’amplifient au Caire, le régime, qui espère ainsi juguler le risque de révolution, ordonne une campagne d’arrestation des activistes politiques dans tout le pays ; les Frères musulmans sont les premiers concernés et Mohamed Morsi, avec une quarantaine de leaders de la Confrérie, sont enfermés dans le centre de détention de Natron, dans le désert occidental du pays. Ils n’y resteront pas longtemps : pour semer le chaos et la terreur parmi les Égyptiens, avec le dessein de discréditer la révolution en cours et d’amener le peuple à réclamer le retour à l’ordre, le gouvernement décide d’ouvrir les portes de toutes les prisons du pays et donne à la police la consigne de ne pas intervenir contre les délinquants de droit commun qui sont ainsi encouragés à développer un climat d’insécurité générale…
Le 11 novembre 2012, la révolution n’a cependant pas faibli et l’armée égyptienne se résout à prendre les choses en main, par un coup d’État en douceur, le premier depuis 1952 : l’armée, qui était jusqu’alors demeurée dans l’expectative, annonce d’autorité la destitution du président Hosni Moubarak et met en œuvre son plan pour s’assurer le pouvoir.
Le Conseil suprême des Forces armées (CSFA), qui affirme se rallier aux revendications de la population, s’érige en gouvernement provisoire et va jouer tous les coups possibles pour empêcher ou du moins retarder toutes les étapes qui conduiraient à transférer le pouvoir à une autorité civile élue. Toutefois, la révolution sociale qui s’est maintenant politisée, notamment du fait de l’engagement dans le mouvement contestataire de la jeunesse estudiantine, réclame la concrétisation du processus de démocratisation et les manifestations se poursuivent, tandis que la dégradation de l’image de l’armée oblige le CSFA à finalement procéder à des élections présidentielles et législatives.
Le CSFA, inquiet du soutien populaire dont disposent les Frères musulmans tenteront bien une dernière manœuvre pour affaiblir le potentiel électoral de la Confrérie, en imposant à l’appareil judiciaire d’invalider la candidature de ses deux figures de proue, Salah Abu Ismail et Khairat al-Shater. Mais en vain…
Le dimanche 24 juin 2012, Mohamed Morsi, qui a été présenté in extremis par les Frères, devient le premier président élu de la toute jeune démocratie égyptienne.
Entre l’armée, détentrice de 70% du patrimoine foncier égyptien et de plus de 30% des industries du pays, et les Frères musulmans, c’est un bras de fer intense qui commence et qui s’achèvera lorsque, ayant épuisé toutes les ficelles institutionnelles pour contrer le chef de l’État et sa majorité parlementaire, les militaires, en dernière option, recourront à la force, brutale et sans merci, le 3 juillet 2013.
Morsi et « l’Alliance non-sainte »
Dès le commencement de sa présidence, une « alliance non-sainte » d’une composition très étrange s’est de facto constituée contre Mohamed Morsi et les Frères musulmans, un croisement d’intérêts politiques, économiques et sociétaux qui ont fait converger l’hostilité des forces internationales, régionales et nationales opposées au projet du nouveau gouvernement.
Les forces locales, d’abord, à savoir les institutions de l’État égyptien, notamment les hauts fonctionnaires hérités de l’ancienne administration, la police et l’appareil judicaire, de nombreux journalistes dans les médias jusqu’alors au service de la propagande de la dictature, les hommes d’affaires qui avaient été en cheville avec le régime… Autant de personnes qui avaient profité de la corruption généralisée de l’ancien régime, depuis longtemps, et qui craignaient de perdre leurs intérêts si le système changeait et devenait plus transparent.
Le Conseil suprême des Forces armées (CSFA), ensuite et surtout…
Morsi entamait son mandat en faisant face à une situation économique déjà désastreuse avant le départ de Moubarak (et qui en avait été la cause principale), mais qui s’était encore détériorée un an et demi durant du fait des troubles révolutionnaires et de la chute du tourisme et des investissements étrangers ; les salaires, les routes, la gestion des immondices, toutes ces questions non-réglées se présentaient à lui, tandis que l’armée allait faire de son mieux pour lui mettre des bâtons dans les roues.
En outre, Mohamed Morsi prenait la tête de l’État avec des pouvoirs limités, du fait de la déclaration constitutionnelle que le CSFA avait promulguée le 17 juin 2012, juste avant de quitter le pouvoir et de le remettre le pouvoir au président. Cette déclaration constitutionnelle fut en somme le deuxième coup d’État du CSFA, qui s’attribuait le pouvoir législatif et la gestion du budget, après avoir dissout le premier parlement démocratique élu après la révolution du 25 janvier 2011.
Ainsi, par exemple, lorsque Mohamed Morsi voulut mettre en œuvre son projet de développement du canal de Suez, le gouvernement dut demander l’autorisation de l’armée pour obtenir l’attribution de terrains concernés par les travaux d’expansion. L’armée, en effet, dispose de cette prérogative en ce qui concerne toute question foncière, sous le prétexte de la sécurité nationale. La réponse de l’armée à cette requête du gouvernement a mis plus de six mois à lui parvenir, laquelle qualifiait la presque totalité des terrains de la zone du canal comme « domaines militaires » inaliénables.
Autre exemple, dans le domaine sécuritaire : la péninsule du Sinaï a toujours été placée sous le contrôle exclusif des militaires, et ce depuis 1952 ; même le gouverneur et les hauts fonctionnaires en charge du Sinaï sont d’anciens militaires. Or, il semble bien que l’état-major a conclu que des troubles dans le Sinaï pouvaient déstabiliser le chef du pouvoir exécutif et servir à démontrer son incapacité à assurer la sécurité du pays. Dans cette logique, en novembre 2012, les services secrets ont à tout le moins laissé se dérouler une opération sanglante contre des soldats égyptiens en faction dans le Sinaï, une tragédie dont les médias déchaînés ne manquèrent d’imputer la responsabilité à « l’incompétence » du président Morsi. Toutefois, se dernier su retourner l’événement à son avantage, prétextant de l’attentat pour envoyer à la retraite le maréchal Hussein Tantaoui, ministre de la Défense depuis vingt ans, ainsi que quelques-uns des chefs militaires qui lui étaient hostiles.
Conscient de la nécessité de diminuer le potentiel de nuisance de l’armée à son égard, Morsi décréta d’autorité l’annulation la déclaration constitutionnelle de juin 2012, une décision qui fut toutefois négociée avec l’état-major et ne fut acceptée qu’à la condition que le général al-Sissi, alors directeur des services secrets, fût nommé en tant que nouveau ministre de défense.
Mohamed Morsi n’a pas vu se refermer le piège que lui avaient tendu l’état-major ; au contraire, il s’était senti les coudées plus franches avec, à ce poste-clef, un général que l’on disait sympathisant de la cause islamiste.
Certes, durant les deux mois qui ont précédé le coup d’État, d’après des témoignages récents de collaborateurs du président, Morsi se doutait de la préparation de quelque chose par l’armée. Mais il espérait un retour de conscience des généraux du CSFA et, surtout, comptait sur les officiers subalternes et les hommes de troupe, auxquels il avait adressé un dernier message clair, en direction aussi des forces de police, le 28 juin 2013 : « Protégez les intérêts suprêmes du pays et respectez la volonté de peuple. »
La police contribua aussi au sabotage de la présidence de Mohamed Morsi.
La police est la seconde institution armée dans le pays et elle a joué un rôle majeur dans le renversement du président Morsi envers lequel elle avait fait preuve de défiance dès le lendemain de son élection : un peu partout au sein des forces de l’ordre on répétait ce slogan, « la police se met en congé pour quatre ans ».
L’appareil judiciaire hérité de Moubarak fut la troisième institution à se dresser sur le chemin du président.
En effet, le rôle de la Cour suprême constitutionnelle (CSC), par exemple, fut décisif pour la contre-révolution. Son rôle a commencé avant la présidence de Morsi. La CSC avait invalidé la commission constituante chargée de rédiger la nouvelle constitution ; puise, en juin 2012, la CSC avait dissout, à la demande du CSFA, la première assemblée législative, la chambre basse, démocratiquement élue. La CSC avait tenté, en décembre 2012, de dissoudre également la chambre haute du Parlement et la seconde commission constituante, quelques jours avant qu’elle termine sa mission de rédaction de la nouvelle constitution. Il ne faut pas non plus oublier le rôle du procureur général nommé par Moubarak, et celui des procureurs adjoints qui ont poussé à la démission le nouveau procureur nommé par le président Morsi.
Quant aux juges, beaucoup n’ont pas accompli leur mission de garantir le bon déroulement des divers processus électoraux qui ont suivi la révolution et d’en dénoncer les fraudes. Un comportement particulièrement significatif fut celui du président du club des juges, qui, à l’occasion d’une conférence de presse, a appelé le président américain Obama à intervenir en Égypte contre « la dictature des Frères musulmans »…
Un dernier exemple éloquent fut donné par la haute commission électorale chargée d’organiser et l’élection présidentielle de 2012 et d’en annoncer les résultats ; dissoute constitutionnellement immédiatement après la fin du scrutin, elle avait essayé de ressusciter en 2013, six mois plus tard, pour remettre en question les résultats de l’élection.
Les libéraux furent la quatrième force qui a joué contre Morsi, lesquels n’ont jamais accepté de collaborer avec les islamistes.
Les libéraux occidentalisés reproduisent en Égypte la lutte que les Européens ont opposée à l’église à partir du XVIIIème siècle, alors que les conditions politiques, sociales et avant tout la religion elle-même sont différentes de ce qu’il en était en Occident. Par ailleurs, la dictature en Égypte a duré soixante ans (depuis Nasser, en 1952) et n’a pas laissé émerger une classe politique libérale qui est dès lors très faible, à l’instar des mouvements de gauche, et souffre en outre de l’indifférence populaire, la grande majorité des Égyptiens se préoccupant essentiellement de gagner leur vie dans des conditions très difficiles et ne manifestant aucun intérêt pour les questions sociétales. Une réalité qui n’a pas eu ces conséquences pour les Frères musulmans, lesquels, durant ces années de misère, ont obtenu la confiance de la population par l’aide sociale et économique qu’ils ont dispensée à travers leurs institutions caritative, d’où leurs victoires successives aux cinq échéances électorales qui ont suivi le départ de Moubarak.
Incapables de s’imposer par les urnes, les libéraux ont donc préférer soutenir l’armée contre les Frères musulmans. La question reste de savoir quel a été le calcul de ce mouvement : est-ce de la naïveté qui a poussé les libéraux à penser que, Morsi renversé, l’armée allait préserver les acquis révolutionnaires et poursuivre le processus de démocratisation ? Ou bien certains ont-ils espérer partager le pouvoir avec le CSFA ?
Leur critique des Frères musulmans a quoi qu’il en soit été acerbe et les patrons de la presse à laquelle Morsi avait donné la liberté ont tiré à boulet rouge sur le président, notamment à propos de l’alliance des Frères avec les Salafistes et de l’arrogante dont certains leaders islamistes ont fait preuve à chaque victoire électorale ; en cela, ils avaient probablement raison.
Mais, en démocratie, la sanction de l’incompétence est administrée par les urnes, et non pas par un coup d’État.
Des forces internationales ont accompagné la réaction de l’intérieur.
Les États-Unis ont généralement préféré, au cours de leur histoire, collaborer avec les militaires et des dictatures, un peu partout dans le monde, l’Amérique latine ayant été l’illustration la plus évidente de leur politique étrangère. Or, en Égypte, les enjeux sont sensibles pour Washington.
L’Égypte leur octroie ainsi une priorité de passage sur le canal de Suez et l’autorisation de survol du Sinaï, d’un côté, tandis que, de l’autre, l’enjeu est la sécurité d’Israël.
Lorsque le « printemps égyptien » a commencé, on a vu comment la diplomatie américaine s’est trouvée inefficace, incapable de réagir aux événements. Dans un premier temps, Obama a soutenu Moubarak. Jusqu’à ce qu’il devienne évident que leur allié allait devoir se retirer du pouvoir. L’attitude de Washington a alors été très équivoque et incertaine.
La position dure du président Morsi face aux raids israéliens contre la bande de Gaza (attaque israélienne contre Gaza, en novembre 2012, l’opération « Pilier de Défense ») a dévoilé les intentions de l’Égypte démocratique par rapport au dossier palestinien. Mais c’est surtout la difficulté d’établir des relations stables et bien définies sur le long terme avec les Frères musulmans qui ont placé les États-Unis dans l’expectative.
Aussi, si les Américains n’ont probablement pas été impliqués directement dans le coup d’État, ils ne s’y sont pas opposés et l’ont considéré comme un soulagement (ignorant alors que l’armée n’avait pas l’intention de revenir au statu quo antérieur à la révolution et à un partenariat privilégié avec les États-Unis, mais favoriserait un multilatéralisme et un rapprochement avec Moscou).
Al-Sissi ne cache d’ailleurs pas les rapports étroits qu’il avait entretenus à partir de mars 2013 avec le secrétaire d’État américain à la Défense, auquel il avait confié l’éventualité d’un coup d’État militaire en Égypte.
L’Europe et la Russie ont également approuvé le putsch, fût-ce par leur silence. Les doutes et les soupçons qui avaient émergé dans les chancelleries européennes et en Russie à propos d’un président islamiste ambitieux dont un des points forts du programme était de parvenir à terme à l’autarcie égyptienne dans les domaines de l’armement, de la production agricole, de l’industrie pharmaceutique et du développement technologique, furent certainement déterminant du choix de ne pas coopérer avec lui et, même, au final, de favoriser d’une manière ou d’une autre sa disparition.
Les institutions internationales ont également adopté une position très ambiguë envers Morsi. Il suffira de rappeler comment le FMI qui a fait traîner pendant plus de huit mois les discussions concernant une prêt de 4.5 milliards de dollars, exigeant en outre comme préalable que l’accord soit entériné par le parlement égyptien ; en revanche, cette même institution a immédiatement accordé au régime d’al-Sissi un prêt de 12 milliards de dollars, dont 3 milliards ont été débloqués en urgence, sans attendre le vote parlementaire…
Les forces régionales, enfin, se sont elles aussi défiées de la démocratisation de l’Égypte. La plupart des régimes postcoloniaux toujours en exercice dans les pays arabes ne fait qu’assurer la continuation de la domination coloniale au Moyen-Orient, même si certains intérêts ont plus ou moins changé de mains.
Les monarchies du Golfe, en particulier, qui disposent de leviers financiers considérables, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït et le Bahreïn, se sont inquiétées de la réussite potentielle d’un modèle démocratique égyptien et de l’expansion à leurs États du phénomène du « Printemps arabe ». Elles se sont donc non seulement abstenues d’aider le gouvernement de Mohaled Morsi (à l’exception du Qatar, dans une certaine mesure), mais ont financé les mouvements d’opposition aux Frères musulmans, subventionnant par ailleurs la presse hostile à Morsi.
Une prise de position qui s’est affirmée sans complexe lorsque, au lendemain du coup d’État, Riyad a ajouté sa propre contribution financière en plus de l’aide du FMI apportée à la dictature.
Les derniers jours de la démocratie
Le 30 juin 2013, des centaines de milliers de personnes manifestent dans toutes les grandes villes d’Égypte contre le président Morsi et réclament son départ. La situation économique n’a pas pu être améliorée en quelques mois seulement de gouvernement et les médias agitent l’opinion contre les Frères musulmans en ciblant systématiquement le président.
Depuis son élection, rien ne lui est épargné ; la moindre aspérité qui permet une critique est surexploitée, jusqu’à des moqueries et des railleries prenant à partie des aspects physique du personnage. Tout est bon pour le ridiculiser. Et cependant, Morsi ne prend aucune mesure qui limiterait la liberté de la presse et lui garantirait le silence de ses ennemis de l’intérieur.
Poussée par les libéraux et surtout l’armée, toute une population est descendue dans la rue pour exiger la démission du président, fatiguée du marasme socio-économique qui s’est aggravé au gré des remous révolutionnaires (et par les séries de problèmes artificiellement créés, comme les coupures d’électricité à répétition et les pénuries de gaz et d’essence, qui furent comme par miracle abondement disponibles le lendemain de la destitution de Morsi).
Quelques semaines auparavant, le 2 juin, Mohamed Morsi avait adressé un discours sans équivoque à son peuple et aux institutions du pays. Il avait rappelé la situation de l’Égypte avant la révolution de 25 janvier, sa participation dans les événements de la révolution et durant la période qui avait précédé son élection, puis il avait fait le bilan de sa première année à la présidence et énuméré l’accumulation de problèmes qui, depuis une cinquantaine d’années, menaient l’Égypte à la banqueroute ; tout en reconnaissant avoir commis certaines erreurs au cours de cette première année. Il avait insisté sur la légitimité de sa présidence et affirmé qu’il ne se plierait à aucune pression contre la volonté de peuple qui était déterminé par son élection démocratique. Une légitimité qu’il a répétée tout au long de son discours, comme la voie unique par laquelle devait être résolus tous les problèmes politiques, économiques, de sécurité et pour garantir l’unité de pays. Il ne fut pas entendu. La presse tourna ses propos en dérision. Et les foules, incrédules et désinformées, se sont jetées bien naïvement dans les bras des militaires.
Le 3 juillet 2013, prétextant intervenir pour répondre aux aspirations du peuple, l’armée avait s’est saisie de la personne du président qui fut un temps séquestré dans l’enceinte du club de la garde républicaine. Cinq jours plus tard, le 8 juillet 2013, l’état-major ordonna le coup de feu contre des partisans du président qui manifestaient en sit-in devant le club ; au moins 54 manifestants furent tués.
Après ce massacre, le président Morsi disparut. On apprit, six mois plus tard, que les putschistes l’avaient emmené et gardé prisonnier dans une base navale isolée, à proximité d’Alexandrie.
Quatre années de prison
Depuis juin 2013, Mohamed Morsi refuse fermement de céder à la junte qui s’est emparée du pouvoir et d’accepter la proposition des militaires de reconnaître la légalité de sa destitution en échange de sa libération. Opposant sans relâche la légitimité qu’il avait acquise par l’élection démocratique, Morsi rejette cette option, qui avait été suggérée par l’ex-président Obama et Anne Patterson, l’ambassadeur des États-Unis au Caire.
Lorsque Catherine Ashton, qui représentait l’Union européenne, avait insisté pour rencontrer le président dans sa prison, elle avait réitéré cette même proposition à Mohamed Morsi, qui lui avait confirmé son refus.
Le président, depuis quatre années, est privé tous ses droits ; il n’a été autorisé à recevoir sa famille qu’à une seule occasion. Il a protesté de ne pas pouvoir rencontrer son avocat sans la présence d’auditeurs désignés par la junte. Morsi a en outre montré des signes d’affaiblissement inquiétants ; il a plusieurs fois sollicité du tribunal que la qualité de la nourriture qui lui est servie soit surveillée, parce qu’il craint qu’on l’assassine discrètement.
Le coup d’État et son appareil juridique s’est montré très obéissant lorsque Donald Trump est intervenu pour obtenir la libération d’Aya Hijazi, une Égypto-américaine, son époux et huit autres membres de l’organisation caritative qui avait été visée par le gouvernement, tout comme beaucoup d’autres ONG étrangères, et de journalistes étrangers dès qu’ils se montrent un peu trop critiques envers le régime et en dénoncent les exactions, notamment les atrocités commises dans les prisons.
Par contre, cet appareil a fait preuve de moins de délicatesse à l’égard de Mohamed Morsi, multipliant les procédures iniques et falsifiant les « preuves » présentées lors de procès théâtraux où sont également multipliés les chefs d’accusation ; allant jusqu’à s’en prendre à son fils et même à intimider son avocat. Sans compter la chasse aux sorcières qui sévit en Égypte depuis 2013, où les membres de la Confrérie des Frères musulmans sont partout traqués et éjectés des emplois publiques, voire qualifiés de « terroristes » et emprisonnés.
Tant qu’il reste en vie, Mohamed Morsi demeure pour ceux qui s’en souviennent le symbole vivant de la légitimité démocratique, de la révolution du 25 janvier 2011 anéantie par les militaires, de l’espoir de changement brutalement écrasé le 3 juillet 2013.
C’est pourquoi le régime essaie de le faire disparaître des mémoires.
Depuis presqu’un an, aucune information n’a pu sortir de la prison où il est enfermé sur l’état de santé exact et les conditions de détentions du président Morsi.
Seules quelques nouvelles ont filtré, via d’autres détenus… Mais le régime, qui a muselé la presse mieux encore qu’à l’époque de Moubarak, interdit aux médias d’évoquer le nom de Mohamed Morsi.
Des instructions du général al-Sissi qui s’expliquent probablement par le contexte politique à venir : les élections présidentielles, prévues en 2018.