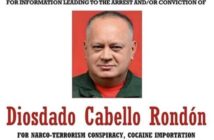Comment l’Islam pourrait-il ne pas être politique ? Comment pour un Musulman un État pourrait-il être autre qu’islamique ?
Depuis la fondation du premier État musulman, en 622, à Yathrib, qui deviendrait al-Medina al-Monawara après qu’y fut arrivé le Prophète, et jusqu’au début du XIXème siècle, jamais personne ne posa de telles questions, incongrues pour qui connaît l’Islam.
Dieu est souverain en toutes choses, et pour l’Oumma, l’ensemble des Musulmans, des croyants, dans le monde et pendant près de quatorze siècles, l’Islam est une religion qui embrasse la vie et la mort de l’être humain ; de là, elle est par le fait intrinsèquement mêlée à l’action politique et, de là, découle un système politique qui a pour objet d’organiser cette vie, en accord avec les principes admis par les croyants pour leur vie entière.
Les oulémas et faqih (les savants et les jurisprudentiels de l’Islam), en fonction de la Charia (la loi musulmane qui découle du Coran), visent à préserver cinq principes fondamentaux commun à tous les croyants et qui sont la religion, la vie, la raison, les biens et l’honneur ; il faut donc que se mette en place un système de gouvernance qui permette l’accomplissement de la mission des docteurs de l’Islam, qui soit compatible avec la loi musulmane donnée par Dieu et inscrite dans le Coran et qui garantisse le respect et la promotion des principes fondamentaux édictés.
L’Islam, ainsi, sans aucun doute, ne peut pas ne pas être politique ; mais soyons d’emblée sans équivoque : l’Islam, dans sa dimension politique, ce n’est pas le modèle imposé par l’État islamique en Irak et au Levant, par « Daesh », ni non plus celui de la république islamique d’Iran, ni encore ce qu’en a fait la dynastie régnante d’Arabie Saoudite…
Parce que, dès l’origine, l’Oumma (la Communauté des Croyants) doit organiser la vie au quotidien dans le respect des lois de Dieu, une ou plusieurs formes politiques d’inspiration religieuse sont de facto apparues, qui ont dirigé la communauté musulmane, laquelle, au fil du temps, s’est étendue sur un plus vaste territoire que l’empire romain.
La question qui se pose n’est donc pas de savoir si l’Islam est politique, mais si ces formes de gouvernement d’inspiration islamique étaient sincères et quel a été le degré de fidélité de chacune d’elles aux principes de la charia.
L’Islam, indissociabilité de la religion et de l’État
Historiquement à partir seulement de la seconde moitié du XIXème siècle, il n’y a eu qu’un très petit nombre de penseurs, se comptant sur les doigts de la main, uniquement en Égypte et au Liban, qui se sont penchés sur la question de la séparation de l’État et de la religion en terre d’Islam, tant il était évident pour les autres que les deux allaient de pair ; pour les penseurs musulmans des siècles précédents, la question d’une éventuelle séparation entre la politique et l’Islam était aussi inutile que l’eût été un débat sur la pertinence de la mythologie grecque.
Ces penseurs, bien qu’ils appartenaient ethniquement et linguistiquement à la région musulmane, avaient été formés « à l’occidentale », et plusieurs d’entre eux n’étaient pas musulmans. Les raisons de leur interrogation et du fait qu’elle émergea dans ces deux pays, ce furent le conflit religieux qui éclata au Liban en 1860, d’une part, et, d’autre part, la question de la colonisation britannique en Égypte, qui devint centrale dans ce pays à partir de 1882.
Sur le terrain, le fait que la notion de laïcité est étrangère à la culture musulmane n’avait en effet pas empêché l’apparition de diverses pratiques dans l’administration des régimes précoloniaux, dans différents domaines, principalement en matière de justice et de commerce ; ce fut le cas en Égypte, sous la gouvernance de Mohamed Ali Pacha, et en Grande Syrie, à partir de la seconde moitié du XIXème siècle.
À fin du XIXème siècle, c’est l’administration coloniale qui, dans la plupart des pays arabes (musulmans), impose ces pratiques étrangères, voire contraires, à la tradition socio-politique islamique, et ce tout en ayant séparé ces pays du califat ottoman. Ensuite, au début du XXème siècle, la Sublime Porte (l’Empire ottoman) est défaite au terme de la première guerre mondiale, et la république turque laïque fondée par Kemal Atatürk met fin au califat musulman : à partir de 1924, Istanbul n’est plus la capitale du monde musulman.
C’est alors Al-Qāhira (Le Caire), deuxième ville en taille après Istanbul et qui a fait partie du califat ottoman pendant trois siècles, qui prend le relais en tant que centre religieux, bénéficiant d’un prestige incontesté, l’université islamique de la mosquée al-Azhar continuant à jouer son rôle religieux et culturel pour l’ensemble des Arabes et des Musulmans.
En 1925, les oulémas d’al-Azhar, alors même qu’ils n’ont pas encore pris conscience de l’impact que va avoir la chute du califat musulman, se trouvent confrontés à un autre choc, lorsqu’un savant, pourtant –et a fortiori- de culture islamique, soulève pour la première fois la question du système du pouvoir dans l’Islam : le cheikh Ali Abd al-Raziq, dans son livre Al-Islam wa uṣūl al-Hukm (L’Islam et les fondements du pouvoir), fut le premier « alim qadi » (savant-juge), formé à al-Azhar, à nier non seulement l’existence d’un système politique et de gouvernance propre à l’Islam, mais aussi à prétendre, radicalement, que la politique n’avait aucun lien avec l’Islam.
La thèse présentée dans son livre par Ali Abd al-Raziq n’était en soi pas particulièrement pertinente et fut rapidement démontée par de nombreux ouvrages et articles qui suivirent de près sa publication, mais il a eu l’effet d’une sonnette d’alarme qui a alerté les penseurs musulmans sur l’infiltration de plus en plus évidente des principes de la laïcité dans la mentalité des croyants, et en particulier dans la société égyptienne et ses institutions, y compris au sein de cette institution de premier plan, al-Azhar. Si les oulémas acceptaient que les Occidentaux, du fait de leur ignorance des réalités essentielles de la culture sociopolitique musulmane (et peut-être aussi à cause de la longue histoire conflictuelle qui opposait l’Occident chrétien et l’Orient islamique et qui remontait au cœur du Moyen-Âge), puissent se poser ces questions sur la compatibilité de l’action politique et de l’Islam, il était ahurissant d’entendre un faqih d’al-Azhar s’interroger à ce propos et ses conclusions étranges étaient inacceptables.
Pour d’aucuns, il s’agissait simplement d’une ingérence de la pensée occidentale dans le système culturel et politique islamique, et l’objectif de ce questionnement saugrenu s’apparentait à une tentative d’effacer une histoire de 1.400 ans de civilisation musulmane, présente sur trois continents.
« Laïcité », un concept ignoré en Islam
La « laïcité » est née (et tardivement) dans le contexte historique, religieux et culturel spécifique de l’Europe latine chrétienne ; et elle ne fut au départ qu’une réaction à la domination et à la tyrannie du clergé de l’Église romaine.
En effet, les hommes d’église ont pratiqué en Europe occidentale, pendant des siècles, une sorte de domination sur toutes les activités politiques, économiques et sociales (et même scientifiques), qui dépassait le cadre de leur activité religieuse initiale. Par contre, en terre d’Islam, si la religion est indissociable de la vie politique, il n’y a pas eu, dans l’ensemble et à de rares exceptions près, en quatorze siècles d’histoire islamique, de clergé constitué et centralisé susceptible de mettre sous sa coupe la société entière et dans tous ses aspects.
Tandis que le Pape vendait les « indulgences » à l’époque de la Renaissance, pratiquait l’excommunication ou choisissait qui était saint et qui ne l’était pas, l’Islam ne permettait rien de tel. Rien de commun entre l’immense pouvoir même du simple prêtre d’une petite église de village qui reçoit la confession de quiconque et lui peut ou non lui accorder le pardon de ses péchés et ouvrir au fidèle, par quelques paroles, les portes du paradis et l’état d’un faqih même reconnu le plus sage des sages ou encore d’un grand Mufti du Caire, qui n’oseraient ni l’un ni l’autre, quel que soit leur degré d’influence dans la société, ni promettre le salut dans l’au-delà, ni pardonner au nom de Dieu.
La laïcité est le produit du XVIIIème siècle européen, un tout nouveau produit apparu en Occident, après qu’il a abandonné la religion ; elle a ensuite été progressivement importée, par la colonisation, dans l’espace géographique et culturel arabo-musulman, mais elle n’y demeure pas moins un corps étranger.
Au début XIXème siècle, cependant, la plupart des État occidentaux ont d’une manière ou d’une autre adopté le principe de laïcité ; et, dans le même temps, ces pays ont tourné leurs appétits vers l’Orient, jusqu’à finir par se partager le califat ottoman. Or, l’Islam représentait un obstacle considérable à l’accomplissement de ce partage, surtout du fait de l’identité que l’Islam donne aux croyants, une identité et une appartenance à une communauté qui outrepasse les formes d’identités occidentales, telle que la nationalité.
Aussi, si les forces armées coloniales n’avaient aucun mal à imposer des frontières au sein de l’espace géographique arabo-musulman, encore fallait-il créer des régimes locaux pro-coloniaux et y faire adhérer les populations ainsi soumises, d’où la nécessité de promouvoir des institutions de gouvernance dénuées de toute tendance islamique. Il était donc évident que tous les régimes créés sous la tutelle du colonialisme devaient adopter le principe de séparation de l’État et de la religion.
Ces régimes ont à leur tour réussi à produire une classe sociale et culturelle indigène qui partageait ces mêmes valeurs laïques, laquelle allait par la suite s’opposer aux mouvements islamiques.
L’exemple de l’Égypte
Le cas de l’Égypte fournit en la matière un exemple très complet.
À partir de 1889 (à peine quelques années après leur arrivée en Égypte, en 1882), les colonisateurs britanniques ont modifié le système d’éducation, le contenu de l’enseignement, puis l’organisation de l’administration et de l’appareil judiciaire. Les résultats de cette politique de long terme sont devenus évidents à la fin de la première guerre mondiale, lorsque même la résistance à la présence britannique, qui se manifeste en 1919, fut conduite par les libéraux qui minimisèrent autant qu’ils le purent le rôle des institutions islamiques, malgré la participation des cheikhs d’al-Azhar.
Comme l’ont alors suggéré plusieurs penseurs musulmans, tels Rashīd Riḍā (1865-1935), Muhib al-din al-Khateeb (1886-1969) et Hassan al-Banna (le fondateur des Frères musulmans, 1906-1949), face à la chute du califat et à la division des Musulmans désormais répartis dans des États coloniaux, le retour au système islamique dans toutes ses dimensions, sociale, politique et économique, lequel a fonctionné pendant des siècles, constitue le moyen le plus sûr de recouvrer l’indépendance et l’unité, et certainement une alternative au libéralisme ou au communisme. L’Islam -et la charia (par son nature divine, pur qui est croyant)- est la seule solution possible à la détresse socio-économique et politique des Musulmans, non seulement en Égypte mais pour tout le Monde arabe.
En Égypte, en 1928, à Ismailia, une ville que borde le canal de Suez, Hassan al-Banna fonda dans cette perspective la confrérie des Frères musulmans, dont l’objectif fut de remettre en pratique l’Islam dans sa dimension politique. La formation ou la réforme de l’individu, qui croit et applique le manuel de l’Islam dans toutes ses activités, est la première étape du processus, celui qui conduit à la réforme de la famille, de la société, de l’État et finalement du monde. Pour Hassan al-Banna, les Musulmans ne doivent pas seulement prêcher l’Islam ; ils doivent le mettre en œuvre. Ainsi, concrètement, Hassan al-Banna avait-il remarqué que, dans la ville d’Ismailia, qui avait été créée et était administrée par la Compagnie universelle du Canal, c’est-à-dire par l’influence coloniale, les maisons closes étaient légales et nombreuses. Or, la prostitution est évidemment illicite en Islam. Pour résoudre ce phénomène, Hassan al-Banna avait donc fourni du travail aux prostituées et un abri ; et il tenta même de leur permettre de se marier, pour qu’elles puissent fonder leur famille.
Les principes de la confrérie se sont répandus dans toute l’Égypte, en une vingtaine d’années seulement, puis dans les autres pays arabes, mais aussi dans des pays musulmans non arabes ; et la confrérie s’est étendue, sous différentes appellations.
Dans les années 1940, les Frères musulmans, devenus suffisamment nombreux, étaient actifs dans tous les domaines, politique, économique, sociale, et étaient présents dans toutes les couches de la société, dans les campagnes, aux côtés des paysans dans les champs, dans les usines, sur les marchés, dans les cafés, les clubs, les universités et toutes les institutions de l’État, y compris la police et l’armée, et plus rarement dans les mosquées. Les Britanniques, qui contrôlaient l’Égypte en sous-main, n’étaient pas à l’aise face aux proportions que prenait la confrérie, notamment lorsqu’elle commença d’intervenir à l’encontre du mouvement sioniste qui prétendait de plus en plus clairement s’emparer de la Palestine.
La classe dirigeante du régime théoriquement libéral qui prévalait en Égypte s’inquiète elle aussi du succès que rencontrent les Frères musulmans auprès d’une large majorité de la population, et la confrontation devient inévitable, jusqu’à ce que le pouvoir décide de se débarrasser d’Hassan al-Banna, qui est assassiné en 1949.
Par la suite, le régime postcolonial militaire de Gamal Abdel Nasser combat violemment les Frères musulmans, malgré l’appui qu’ils ont apporté aux Officiers libres au moment du coup d’État de 1952 : les objectifs sont communs, en cela que Nasser et les Frères veulent libérer le Monde arabe des influences étrangères et l’unifier. Mais, pour le premier, cela passe par l’unification politique, le panarabisme, dans un cadre laïque et socialiste, le Tiers-mondisme. La rupture était inévitable.
Le cas des Frères musulmans d’Égypte n’est pas unique, car tous les régimes postcoloniaux qui se mirent en place dans les pays arabes, s’ils revendiquent l’Islam comme religion d’État, en limitent les effets à un islamisme rituel, souvent retaillé sur mesure et qui ne dépasse pas les célébrations des fêtes religieuses et les danses soufies ; ce qui rappelle le général Bonaparte, se déclarant musulman à son arrivée en Égypte, à la tête de l’armée française et en colonisateur.
Le retour à l’État islamique
Le processus de retour à l’État islamique initié par les Frères musulmans dans la première moitié du XXème siècle est un processus de long terme, confronté à a volonté néocoloniale de l’occident, plus actif que jamais en terre d’Islam, et aux mutations profondes que la colonisation a induites et qui ont affecté les sociétés arabes musulmanes tout au long des XIXème et XXème siècles.
Ces mutations ont fait oublié aux dernières générations ce que fut jadis la grandeur de l’Islam politique et que l’Islam, religion et État, a donné un cadre de gouvernance à vocation universelle pendant plus d’un millénaire.
C’est avant tout une question de mentalité. Même instruit, un Musulman, aujourd’hui, s’il ne fait pas l’effort de réflexion nécessaire, peut se trouver convaincu que l’Islam n’est pas politique, car les mots « parlement » ou « constitution » ne sont pas inscrits dans le Coran. L’absence de ces noms communs, souvent récents, ou d’une fonctionnalité, a conduit même certains penseurs musulmans « modernes » à nier l’existence concrète de l’Islam politique, pourtant ancestral ; et ceux qui, au sein de cette mouvance, admettent l’existence d’un système politique dans l’Islam, prétendent qu’il ne s’agit cela dit que de simples principes généraux.
La contradiction qui apparaît cependant immédiatement dans la position que défendent ces penseurs « modernes », c’est qu’ils ne peuvent que reconnaître que le Prophète Mohamed était tout à la fois chef de l’armée, gouverneur de Médine et guide religieux de tous les Musulmans. De plus, ils doivent aussi admettre que les quatre califes qui ont succédé au Prophète ont suivi à la lettre les traditions, les règles et les comportements mis en place par le Prophète, en gardant dans leurs mains l’ensemble des pouvoirs religieux, politique, militaire et juridique.
Il faut se rendre à la bibliothèque… On y trouvera des centaines d’écrits qui, dès les origines, ont fixé le système des pouvoirs au sein de l’État musulman, précisé, par exemple, le rôle du calife à la tête de ce système, défini les termes, les conditions de la compétence du candidat au califat, ses devoirs vis-à-vis de l’Oumma, ses droits, la durée de son pouvoir, les raisons et la façon prévalant à sa destitution, ses relations avec les peuples… La question qui se pose est: est-ce que ces docteurs de l’Islam décrivaient des procédures concrètes et pratiques, mais qui n’avaient pas vocation à durer, ou bien étaient-ils en train de fixer la théorie du pouvoir ?
*
* *
L’Islam, y compris dans sa dimension politique, c’est avant tout une question de foi.
Or, toutes les constitutions connues dans le monde, écrites, orales, imposées par un monarque ou votées par les peuples, toutes sont les œuvres des êtres humains et sont aussi modifiables. Un acte interdit aujourd’hui par la loi pourra être toléré demain après que la loi aura été modifiée. L’initiative des lois et leur adoption appartiennent aux êtres humains, aux chefs d’État ou aux membres des parlements, et ils en sont la raison d’être.
À la différence des toutes ces constitutions, la Charia, à la fois constitution et lois suprêmes de l’Islam, est immodifiable. L’initiateur de la Charia est Allah, le grand Dieu qui créa l’être humain et sait ce qui est le mieux pour lui, sur terre et dans l’autre monde. C’est du moins le point de vue du « Croyant » ; et c’est non négociable.
Aucun Musulman dans le monde ne peut voter ou accepter une loi qui tolérerait une chose qui a été interdite par Dieu. C’est un des principes de l’Islam, « al-Ḥakimiyyah », la souveraineté d’Allah en toute chose.
Le célèbre théologien membre des Frères musulmans, Sayyid Qutb, qui fut exécuté par pendaison, en 1966, au Caire, condamné par le régime de Nasser, écrivait : « Quand nous appelons les gens à l’Islam, il est de notre devoir de leur faire comprendre qu’il ne s’agit pas d’une des religions ou idéologies artificielles créées par l’Homme, ni d’un système créé par l’Homme – avec leurs noms, bannières variées, tout leur attirail – ; il s’agit de l’Islam, et rien d’autre. L’Islam a sa propre personnalité immuable, sa conception, ses modalités éternelles. L’Islam garantit pour l’humanité une bénédiction plus grande que tous les systèmes terrestres superficiels réunis. L’Islam est noble, pur, juste, beau ; il naît de la source du Plus Grand, Allah le Très-Haut. »