Quelles sont les origines de la crise que traverse l’islam depuis l’émergence du wahhabisme au XVIIIème siècle ? Jusqu’où remontent les origines de cette crise ? Le problème est-il dans les textes fondateurs de l’islam ou dans la lecture qu’en font les musulmans ou dans les deux à la fois ? La réalité de l’islam est-elle dans la loi exotérique (charia) ou dans la connaissance ésotérique (hakika) ? La loi (charia) continuera-t-elle à exister dans l’islam de demain ?
L’islam pourra-t-il dépasser la loi exotérique (charia) qui ne répond plus aux besoins et aux questionnements du monde actuel, pour enfin se réaliser dans la connaissance ésotérique, c’est-à-dire le soufisme ? Est-il possible que nous assistions demain à un islam purement spirituel et universel, un islam sans loi (charia) ni frontières sectaires et surtout sans oulémas (docteurs de la loi) ?
En gros, quel islam pour le monde de demain ?
Autant de questions pour lesquelles nous tenterons d’ouvrir des pistes de recherche et d’analyse, et par là même d’essayer d’apporter des éléments de réponse.
Les 2ème et 3ème parties seront publiées dans les éditions de juillet-août
et septembre 2017 du Courrier du Maghreb et de l’Orient
À l’origine, une spiritualité laïque
L’islam, à l’origine, est une spiritualité séculaire (laïque). C’est à dire que l’islam n’a rien à voir ni avec l’État ni avec la politique. Le Prophète n’a fait que communiquer un message spirituel.
Il se trouve que cet islam originel a été détourné juste après le décès du prophète Mohamed, au profit d’un projet politico-religieux auquel on a donné le nom de « Califat ». Depuis, l’islam spirituel originel a été marginalisé et persécuté par les pouvoirs en place et les foukahas (docteurs de la loi musulmane) alliés historiques de ces pouvoirs. En effet de nombreux soufis ont été excommuniés et exécutés par les pouvoirs à la suite des fetwas (avis) décrétées par les foukahas. C’est le cas de Hadjar Ibn Adi, Halladj, Souhrawardi, Nassimi, Djami, pour ne citer que ceux-là. En revanche, les foukahas ont inventé une armada de textes et interprétations religieuses, afin de légitimer les agissements et politiques des pouvoirs en place (les califes), dont leurs conquêtes coloniales hégémoniques, officiellement et religieusement appelées « Djihad contre les mécréants » pour soi-disant « islamiser les populations non arabes ».
À la place de cet islam spirituel, les foukahas ont propagé un islam politique officiel qui a légitimé tous les pouvoirs temporels et détruit toute possibilité (théorique ou pratique) de vivre ensemble entre les différentes écoles musulmanes (doctrinales et jurisprudentielles telles que les Muatazilites, Ibadites, Philosophes, Soufis, etc.) sans parler des autres confessions telles que les Juifs et les Chrétiens qui étaient désormais considérés par les foukahas comme des « Dhimmis » c’est-à-dire pratiquement des « citoyens de deuxième collège ».
Le soufisme, représentant par excellence de la spiritualité musulmane, et contrairement au discours des foukahas, a de tout temps reflété l’image la plus belle et la plus lumineuse de l’islam, pour les valeurs d’amour, d’ouverture, de liberté, de vivre ensemble et d’universalité qu’il représente.
La destruction du vivre ensemble causée par la persécution du soufisme, est en grande partie responsable de la violence perpétrée malheureusement au nom de l’islam et qui a fait et continue à faire des milliers de victimes à travers le monde.
Par contre, les soufis n’ont jamais cautionné ou légitimé l’exclusion de l’autre, et encore moins la violence, sauf dans le cas de la résistance contre l’envahisseur étranger.
Mais pourquoi et comment les musulmans sont-ils passés de l’islam spirituel pacifiste et ouvert sur le monde, à un islam intégriste fermé, djihadiste et terroriste ?
Les causes du phénomène intégriste islamiste
Nulle part ailleurs que dans le monde musulman, le fanatisme religieux n’a fait, ces dernières années, autant de victimes, en Égypte, et surtout en Afghanistan, en Algérie, puis depuis quelques années en Syrie, en Iraq en Lybie et ailleurs, suite à la vague noire des « printemps arabes ».
Ce sont donc des raisons tout à fait particulières qui doivent expliquer la montée de l’intégrisme et du fanatisme islamique. À cet effet, on a souvent avancé les facteurs économiques et sociaux : la pauvreté, le chômage, la crise du logement, l’envahissement de la ville par la campagne, la corruption quand et là où elle existe, le régime politique, le système des libertés publiques, etc.
Loin de nous l’idée de négliger ces causes de mécontentement légitime dans nombre de pays. Mais, d’une part, le fondamentalisme existe partout dans le monde musulman, y compris dans les pays du Golfe où le niveau de vie est très élevé comparé aux autres pays arabes et musulmans. N’y souffre de pauvreté et d’exploitation parfois intolérable que la main-d’œuvre étrangère non occidentale. D’autre part, dans les pays non pétroliers où les causes de mécontentement économique et social sont réelles, une question se pose : ailleurs, partout dans le monde, ces facteurs sont invoqués en eux-mêmes ; les mouvements d’opinion se forment et les organisations se créent pour réclamer des logements, des augmentations de salaires ; alors pourquoi dans les pays musulmans ces différentes revendications sont-elles fondues dans une réclamation chimérique de retour à un État islamique où tous les problèmes seront résolus par la baguette magique de l’application de la charia (droit musulman classique) ? La réponse est-elle alors culturelle ?
On parle souvent des « particularités de la religion islamique » ou des « spécificités de la civilisation arabo-musulmane » qui doivent être respectées ; propos justes en eux-mêmes parce qu’ils signifient le respect de l’autre, mais qui ne justifient ni le retour aux châtiments corporels, ni le maintien de l’oppression de la femme, ni la reconstruction d’un État théocratique.
Toutes les civilisations et toutes les conceptions religieuses évoluent. N’oublions pas que les traces de l’héritage gréco-romain ne sont plus perceptibles dans l’organisation de l’État et le mode de vie des citoyens en Europe ou en Amérique. La pensée chrétienne d’aujourd’hui ne rappelle en rien les idées qui prévalaient à l’époque des croisades, de l’Inquisition ou du procès de Galilée. Depuis Vatican II, l’Église a pris congé du Moyen-Âge et fermé la parenthèse de la Contre-Réforme. Elle ouvre grandes ses portes et ses fenêtres. Certes, elle prend de temps à autre des positions contestables, mais il reste que le chemin parcouru depuis un siècle environ est impressionnant. Même en Israël où l’État est pourtant fondé sur la religion, avec l’émancipation de la femme, la loi mosaïque n’est plus respectée que partiellement.
C’est ainsi que la prohibition chrétienne du divorce ou la polygamie dans la loi mosaïque sont devenues des pièces de musée, et leur disparition aujourd’hui ne provoque aucun déchirement pour la grande majorité des croyants de ces deux religions. Ces innovations sont tellement bien intégrées dans la pensée collective chrétienne ou juive, qu’aucun courant politique européen ou israélien important ne réclame le retour à ces vieilles lois au nom de l’identité ou de l’authenticité ou d’un autre concept d’immobilisme ; et l’existence ici et là de sectes ou tendances fanatiques ne remet pas en cause le bien-fondé de ces affirmations, car ces groupes tout à fait minoritaires sont sans influence sur les conceptions dominantes du judaïsme ou de la chrétienté.
Cette métamorphose des deux autres religions monothéistes, par rapport à ce qu’elles étaient il y a quelques siècles, n’a rien d’étonnant car la loi de la vie est l’évolution et cette loi s’applique aussi aux conceptions religieuses.
L’islam n’est pas moins apte que le christianisme ou le judaïsme à évoluer.
Seulement, si les Européens ont vécu, souvent dans la douleur et avec des flux et des reflux, de profondes mutations technologiques, économiques, culturelles et politiques au cours des derniers siècles, les peuples musulmans ont, au contraire, connu un grand retard dans tous les domaines. Mais ce retard n’est pas une condamnation définitive et perpétuelle. Il peut être rattrapé. Les châtiments corporels ont disparu dans la plupart des pays musulmans depuis longtemps. En Tunisie, par exemple, les règles de la charia punissant le voleur de l’amputation du poing ou l’auteur d’adultère de la peine de mort par lapidation sont tombées en désuétude depuis des siècles. Le système bancaire, facteur de développement quand il est correctement organisé et bien dirigé, fonctionne normalement dans la quasi-totalité des pays musulmans malgré la prohibition religieuse du prêt à intérêt. La femme musulmane s’est évadée de ses trois prisons : elle n’est plus cloîtrée chez elle, elle a brisé les barreaux invisibles de l’ignorance et elle a déchiré son voile pour devenir citoyenne à part entière.
Ces différentes évolutions n’ont pas été réalisées sans difficultés ni débats parfois passionnés. Ainsi, pour citer un autre exemple d’évolution, quand l’esclavage a été aboli en Tunisie entre 1842 et 1846, certains chefs religieux « bornés » – les intégristes de l’époque – ont crié au scandale et à la trahison de l’islam sous prétexte que le Coran tolère cette institution et qu’on n’a pas le droit d’interdire ce que les textes sacrés autorisent. Bien plus, précurseurs de certains islamistes d’aujourd’hui, ils ont accusé les inspirateurs de l’abolition de vouloir « plaire à l’Occident ». Les réformateurs s’en sont courageusement défendus. Quand on lit les articles de Bayram, penseur tunisien du milieu du XIXe siècle, on les croirait écrits par un démocrate d’aujourd’hui. Ils ont démontré que l’abolition est plus conforme à l’esprit de la religion que le maintien de l’esclavage et qu’elle évite au maître les péchés nombreux qu’il commet en maltraitant ses esclaves.
Plus tard, Kacem Amine en Egypte et Abdelaziz Thaalbi en Tunisie ont appelé à l’instruction des filles et à la suppression du voile des femmes en utilisant toujours la même méthode de justification des réformes par l’esprit de la religion et la relecture de ses textes fondateurs.
Cette évolution a été possible grâce à de multiples facteurs. D’une part, les penseurs éclairés et les réformateurs ont souvent inspiré l’action de l’État quand il a fonctionné comme moteur de changement. D’autre part, la grande majorité de la population a suivi sans difficultés ; constituée d’une paysannerie souvent illettrée, elle ne s’est jamais distinguée par une religiosité fanatique ou un respect scrupuleux des préceptes sacrés ; la Bédouine, la Kabyle ou même la Chaouia par exemple n’a jamais porté le voile. Enfin la seule résistance au changement était confinée dans les universités religieuses, la Zitouna en Tunisie ou El-Azhar en Égypte, dont l’influence sur l’opinion publique ou la marche de l’État n’était pas déterminante.
Quand on pense à ces changements considérables, on est tenté de dire que les peuples musulmans ont réalisé leur mutation, qu’ils ont bel et bien quitté le Moyen-Âge pour accéder de plain-pied à la modernité et qu’ils ont su s’adapter aux exigences des temps nouveaux tout en restant fidèles à leur religion.
Mais les événements récents prouvent à l’évidence que ces changements restent fragiles. La raison en est que les structures politiques, juridiques, économiques et sociales ont beaucoup évolué alors que le système de références culturelles et le discours politique sont restés à la traîne.
Dans l’ensemble du monde musulman, parallèlement aux autres mesures de modernisation et de développement, une politique de généralisation de l’enseignement a été adoptée. Dans ce domaine, malheureusement, on a souvent, presque toujours, pensé en termes quantitatifs. Le contenu et les méthodes de l’éducation n’ont pas été mûrement réfléchis et sérieusement débattus. Généralement, on s’est contenté d’ajouter des enseignements de sciences et de langues étrangères aux programmes des écoles traditionnelles. Ces dernières n’enseignaient pas l’islam seulement en tant que religion. Elles le présentaient à la fois comme une identité et comme un système juridique et politique.
Or, la nation, entité naissante, n’est pas « l’Umma » (communauté des musulmans) ; le régime politique nouveau, fondé théoriquement sur la souveraineté populaire, n’a rien à voir avec le califat. Le régime juridique nouveau n’a rien à voir non plus avec la charia, ni par ses sources ni par son contenu. Le droit nouveau est adopté par le parlement théoriquement issu du suffrage universel, alors que la charia est l’œuvre de théologiens. Le droit pénal nouveau est conçu pour réhabiliter le délinquant ou au moins le mettre hors d’état de nuire, alors que le droit pénal chariaïque fait, comme tous les droits pénaux anciens, de châtiments corporels, contient des peines, comme la lapidation, dont le but est de faire souffrir.
Ce sont là des innovations considérables qui n’ont jamais été expliquées et justifiées à l’opinion.
D’année en année le fossé se creuse entre le système idéalisé et sacralisé, hérité des ancêtres et propagé par l’école, et le système nouveau qui apparaît de plus en plus comme étranger, importé et contraire à la religion. Les populations souffrent ainsi d’une grave distorsion, d’une déchirure douloureuse, et sont à la limite de la schizophrénie. Car elles ne veulent sacrifier ni l’islam ni la modernité. Elles sont autant attachées à l’islam en tant que religion qu’aux structures modernes de l’État dont elles revendiquent à juste titre la réelle démocratisation et la représentativité. En même temps, elles sentent confusément la contradiction, voire l’incompatibilité entre les deux. Le dysfonctionnement du système musulman moderne est tel que la situation actuelle devient précaire.
Les islamistes appartiennent à une fraction minoritaire de la population qui veut faire prévaloir l’islam sur la modernité.
Ils ont un discours apparemment logique et cohérent : nous sommes musulmans ; nous devons donc appliquer l’islam tel que nous l’avons hérité et tel que nous l’avons appris.
Leur discours est aujourd’hui dominant par ce qu’ils ont l’allure de militants purs et durs qui ont en face d’eux des régimes rongés par le népotisme, la corruption et l’incapacité de réaliser le développement promis. De plus, et surtout, ils bénéficient de l’immense avantage de l’absence d’un contre discours crédible. Car, dans la plupart des pays musulmans, les attitudes réelles comme le discours officiel des gouvernants traduisent une modernité hésitante, non assumée et non conciliée avec l’islam.
Sur ces trois aspects essentiels, la Tunisie se singularise par une attitude un peu plus cohérente que les autres.
Modernité hésitante
À la fin des années 1950 et tout au long des années 1960, le monde arabe était déchiré entre plusieurs discours politiques divergents. À l’est, au pays du Croissant fertile, le parti Baath régnait en maître incontesté. En Égypte et au Maghreb, trois hommes de grande stature, Nasser, Boumediene et Bourguiba, développaient des discours différents.
Un parti et trois hommes avaient chacun sa stratégie propre et son style particulier. Aujourd’hui, il serait utile de tenter de comparer les résultats de ces quatre approches.
Le Baath était, à ses débuts, un parti laïc et moderne. Constitué par un noyau de chrétiens et de musulmans qui ne pouvaient donc s’entendre sur une base religieuse, il a élaboré un projet indépendant des religions. Mais la modernité de la société était pour lui secondaire par rapport à l’objectif principal : l’unification du monde arabe. Le modèle, tant de fois cité et constamment présent à l’esprit, était celui de l’unification de l’Italie et de l’Allemagne au XIXème siècle. On pouvait donc, surtout pour agir vite, utiliser tous les moyens, y compris les moyens militaires et la prédominance d’un État unificateur. Pour cela, les efforts ont été concentrés sur les forces armées.
Au lieu de multiplier les fédérations de militants et les clubs d’intellectuels qui discutent, on aligne les bataillons de blindés qui s’affrontent. D’où les putschs à répétition et finalement la scission entre Baath syrien et Baath irakien. On chercherait en vain la moindre divergence idéologique réelle pour expliquer l’opposition entre ces deux fractions. En fait, entre ces deux armées, le conflit ne peut se comprendre que si l’on se rappelle que, le rêve étant de reconstituer l’âge d’or des Arabes, cet âge d’or était pour les Syriens celui de la dynastie omeyade dont la capitale était Damas et pour les Irakiens celui de la dynastie abbasside dont la capitale était Bagdad.
Le panarabisme n’est plus que de façade et se réduit donc à un micro-nationalisme expansionniste. Les régimes sont de plus en plus autoritaires. Ils font taire les concurrents, partisans d’un autre dépassement des frontières, les islamistes. Pour réduire leur influence, on essaie de contenter leur clientèle, les couches sociales traditionnelles. Adieu donc les projets de modernisation. Le régime syrien s’allie à l’islamisme radical de l’Iran et du Hezbollah libanais. En Irak, on va jusqu’à prétendre que Miche Aflak, le président-fondateur du parti, d’origine chrétienne, s’est converti à l’islam sur son lit de mort… pour tenter d’effacer cette sorte de « péché originel ». Au lendemain de l’invasion du Koweït, Saddam Hussein inscrit en toutes lettres « Allah akbar » (Dieu est plus grand) sur le drapeau irakien.
Aujourd’hui, il suffit de se promener dans les villes du Moyen-Orient pour voir que la grande majorité des femmes ont repris le voile, après l’avoir abandonné au cours des années 1950 et 1960. On peut en conclure que les projets de laïcité et de modernité ont été sacrifiés au profit du projet d’unification, qui a par ailleurs échoué ; et le parti Baath n’est plus que l’ombre de lui-même.
Quant aux trois hommes, Nasser, Boumediene et Bourguiba, un conflit, parfois feutré, souvent déclaré, les opposait. Des nuances séparaient les deux premiers et une divergence profonde les opposait tous les deux à Bourguiba.
Nasser était un grand tribun mobilisateur de foules. Un homme admiré par son honnêteté et son intégrité et un dirigeant sincèrement moderniste. Cependant, son modernisme était hésitant parce qu’il passait au second plan par rapport à deux autres objectifs qu’il jugeait prioritaires : l’unité arabe et la libération de la Palestine.
Pour atteindre ces objectifs, il fallait mobiliser le peuple, faire plaisir à l’opinion publique et n’en négliger aucune fraction. Cette recherche d’adhésion populaire massive l’a amené à faire d’énormes concessions à la frange traditionnelle de la population. Certes, il s’est opposé aux Frères musulmans et est allé jusqu’à faire exécuter leur doctrinaire, Sayed Kotb. Mais cette opposition ne concernait pas le fond des problèmes et ne menait pas loin. C’était en réalité un conflit fratricide. Car l’islamisme et l’arabisme, étant les deux facettes de la stratégie identitaire, sont parfois ennemis mais toujours frères.
Pour mieux s’opposer aux islamistes qui avaient essayé de le tuer, Nasser a beaucoup ménagé les Oulémas (docteurs de la religion), c’est-à-dire l’islam officiel qui est la pépinière de l’islam populaire et militant. Il a développé l’université théologique d’El-Azhar (qui va compter en 1995 plus de cent mille étudiants) et freiné tout ce qui pouvait contrarier les islamistes. Ainsi, le mouvement de libération de la femme, qui était le plus fort du monde arabe jusqu’en 1952, s’est essoufflé depuis la prise du pouvoir par les « officiers libres ». Aucun pas significatif n’a été accompli dans le sens de la codification du droit de la famille. Les tribunaux confessionnels faisaient figure d’institutions archaïques ; Nasser les a alors supprimés en 1955, mais en attribuant leurs compétences aux tribunaux ordinaires dominés par des magistrats musulmans à la formation traditionnelle qui appliquaient la charia dès qu’il y avait un musulman partie au procès, si bien que la situation des coptes égyptiens s’est aggravée au lieu de s’améliorer. Aucune politique de planning familial n’a été tentée de peur de contrarier les oulémas d’El-Azhar. Si Nasser n’a pu réaliser ni l’unité arabe ni la libération de la Palestine, il n’a pas non plus modernisé la société égyptienne qui a en revanche reculé de plusieurs pas.
Boumediene, en Algérie, avait une politique assez proche de celle de Nasser, avec cependant des particularités. Outre son arabisme, c’était un fervent adepte du socialisme scientifique et du combat anti-impérialiste. Il rêvait de faire jouer à l’Algérie le rôle de dirigeant de l’Afrique et même du Tiers-monde. Comme Nasser, il pensait que, pour des projets aussi grandioses, l’unanimisme était nécessaire.
Aussi, tout en étant moderniste, il a fait ce qu’il fallait pour contenter la frange traditionaliste de la population et surtout le courant des oulémas réformistes (qui étaient pro-intégristes et les ennemis jurés du soufisme). Il offre donc un cadeau superbe aux oulémas en leur cédant quatre des secteurs les plus importants : l’éducation, la culture, les affaires religieuses, et l’information. Il continue la politique de Ben Bella en faisant appel, en très grand nombre, aux coopérants égyptiens et autres coopérants arabes pour mettre en œuvre sa politique d’arabisation dont l’échec total est devenu flagrant à partir des années 1980.
Nasser en a profité pour se débarrasser momentanément d’une bonne partie de ses intégristes qui, employés comme enseignants, vont former les futurs cadres et militants de tous les mouvements islamistes algériens qui ont été créés après l’indépendance : les frères musulmans, les « Djazaaristes », les salafistes, puis le FIS et ses différentes ailes armées dont le MIA, le GIA, le GSPC, etc.
Boumediene crée parallèlement toute une série d’instituts d’études islamiques où seules les théories les plus classiques sont enseignées. Pour le droit de la famille, il a hésité jusqu’à sa mort entre un projet de code de modernisation des structures familiales et d’émancipation de la femme et un projet traditionnel. C’est cette dernière solution qui par la suite a été retenue par Bendjedid. Si bien que, en 1991, beaucoup d’électeurs ont estimé que, entre les principaux candidats, du FIS et du FLN, il n’y avait pas de différence. Ce qui explique le fort taux d’abstention.
En effet, Bendjedid a continué la politique de Boumediene en ce qui concerne le volet religieux. Il est même allé plus loin que Boumediene. Il a confié la gestion pédagogique et administrative de l’université religieuse Emir Abdelkader de Constantine (celles d’Alger et d’Oran avaient le même programme que celui de Constantine) à un intégriste membre des Frères musulmans égyptiens, le cheikh Mohamed El Ghazali. Il en a fait son conseillé personnel et lui a même concédé une heure d’antenne par semaine pour ses prêches religieux télévisés, au moment où il n’y avait pas d’antennes paraboliques et où les Algériens étaient obligés de suivre les programmes de la seule et unique chaîne nationale. Ghazali en la largement profité pour former les futurs militants des différents mouvements islamistes. Sans parler des fetwas anti-algériennes qu’il décrétait parfois, comme celle où il accusait l’écrivain Kateb Yacine d’apostasie et d’athéisme et où il proclamait qu’il « ne devrait pas être enterré en Algérie ».
Notons aussi que les cheikhs Ghazali et Karadaoui (un autre intégriste frère musulman égyptien) ont chassé le professeur Mohamed Arkoun de la grande salle de conférences à l’hôtel El-Aurassi à Alger en 1981 lors d’un séminaire de la pensée islamique organisé par le ministère des Affaires religieuses. Ils l’ont chassé de la salle pendant qu’il donnait sa conférence, le traitant d’athée et d’apostat.
Quant à Bourguiba, malgré la solide réputation qui lui a été faite, il n’était ni antimusulman ni anti-arabe. Simplement, il avait un certain mépris pour les dirigeants arabes de l’époque.
Le risque calculé et bien médité qu’il a pris à Jéricho en 1965 en prononçant le discours historique où il a appelé aux négociations avec Israël, à un moment où Jérusalem-Est, la Cisjordanie et Gaza étaient encore arabes, prouve son attachement à la cause palestinienne. Le torrent d’injures qu’il a reçues de la part de l’opinion publique arabe encouragée par ses dirigeants et les remous de l’opinion tunisienne qu’il a supportés prouvent qu’il a payé plus cher pour ses sentiments arabo-musulmans que la plupart des autres dirigeants arabes.
Pour Nasser, le colonialisme est à l’origine des malheurs des pays arabes. Il a exploité et opprimé les Arabes et leur a imposé des frontières artificielles qu’ils doivent supprimer. Pour cela, Nasser prononçait des discours enflammés en flattant la fierté des citoyens et leur sentiment national, pour les mobiliser contre l’impérialisme. Bourguiba, lui, n’attisait la passion de personne, mais il intéressait tout le monde. Il s’adressait calmement à la raison des citoyens pour expliquer les causes de leur sous-développement qui, depuis l’indépendance, ne sont plus qu’en eux-mêmes. Et il leur indiquait les moyens de s’en sortir. Ils doivent émanciper leurs femmes pour qu’elles participent à l’œuvre d’édification d’une société nouvelle, d’où le code du statut personnel. Ils doivent limiter les naissances pour que la croissance économique ne soit pas anéantie par le poids démographique, d’où les efforts considérables fournis en matière de planning familial. Ils doivent réfléchir aux causes de leur retard, se mettre au travail et changer leurs mentalités et leurs structures sociales pour se moderniser afin de « rejoindre le train de la civilisation ».
Analyse fondée sur plus d’autocritique que de critique des autres. Objectifs apparemment plus modestes mais finalement à la fois plus réalisables et plus importants. La Tunisie récolte aujourd’hui les fruits de cette politique.
Ce qui n’empêche pas que Bourguiba ait été par ailleurs un dictateur mégalomane ayant une haute opinion de lui-même et gouvernant avec le parti unique, la torture et la Cour de Sûreté de l’État. Ces atteintes aux libertés publiques n’étaient ni légitimes ni même utiles à sa politique ; et Bourguiba a fait que la modernité tunisienne, bien que réelle, reste nettement insuffisante faute de démocratie.
Dans les autres pays arabes et islamiques, la modernisation de l’État et de la société n’est pas considérée par les pouvoirs publics comme étant une priorité. Elle est encore moins assumée.
Modernité non assumée
Le problème pour le monde musulman, écrit Olivier Carré, est avant tout non pas d’inventer la laïcité qui existe, mais de penser la réalité qu’il nie (Le Monde, 13 octobre 1994).
Le propos est optimiste. Car les pays qui maintiennent, dans la pratique sociale et dans la législation, des institutions comme la polygamie, la répudiation ou le mariage des filles impubères (mineures) sur la base du simple consentement du père, ne peuvent être qualifiés de pays laïcs. C’est le cas de l’ensemble du monde musulman à l’exception de la Turquie et de la Tunisie.
Pour mesurer à quel point le statut d’infériorité de la femme est, malgré certaines apparences, une réalité sociale et juridique, rappelons par exemple cet incident révélateur qui a défrayé la chronique des années 1980. En Égypte, le pays qui a joué pendant longtemps le rôle d’avant-garde en matière d’émancipation de la femme, Aicha Rateb, ministre des Affaires sociales, avait des difficultés avec son mari et vivait séparée de lui en attendant le divorce. Quand elle a pris l’avion pour un voyage officiel, son mari a réussi à empêcher l’avion de décoller pendant un bon moment car le voyage allait être effectué sans l’autorisation maritale.
Quand un intellectuel tente d’émettre des propos de conciliation entre l’islam et la modernité, les oulémas se mobilisent contre ce penseur « affreux mécréant à abattre » et les gouvernants, par peur ou par démagogie, font chorus.
Cette pratique est malheureusement déjà ancienne. Lorsque, en 1925, Ali Abderrazek, penseur musulman libéral, publie son ouvrage capital L’Islam et les fondements du pouvoir pour concilier la religion et la modernité en matière de régime politique, les oulémas le dénoncent vigoureusement et l’excluent de l’université d’El-Azhar, et le gouvernement égyptien les approuve. Bien plus, Saad Zaghloul, chef du parti dominant de l’époque, le Wafd, parti du combat pour l’indépendance et qu’on disait laïc, a dénoncé le livre et l’auteur avec la même vigueur. Aujourd’hui encore, les autorités égyptiennes n’ont pas changé sérieusement de politique à ce sujet. Certes, l’ouvrage d’Abderrazek est aujourd’hui édité à des dizaines de milliers d’exemplaires aux frais du gouvernement. Mais cela ne change rien au fait que l’œuvre d’Ali Abderrazek reste ignorée dans les écoles égyptiennes.
À la même époque, Tahar Haddad a publié en Tunisie son livre, œuvre majeure Notre femme dans la charia et dans la société pour appeler à l’émancipation de la femme et démontrer que l’islam bien compris ne s’y oppose pas. Il a été soutenu par la frange éclairée des intellectuels et de la population et dénoncé par les oulémas de l’université la Zitouna qui l’a exclu de ses rangs. L’administration coloniale a appliqué la décision des oulémas en empêchant ce penseur d’accéder à la fonction de juge. Mais, dès l’indépendance, le gouvernement l’a réhabilité. On se réfère souvent à lui dans les discours officiels. Un club culturel est créé portant son nom. Ses œuvres sont enseignées dans les écoles.
Sans nier le grand mérite de Bourguiba dans l’adoption du code du statut personnel, il est pratiquement admis par tout le monde que le code est fondé sur la théorie de Tahar Haddad.
Mais, dans ce domaine, l’exemple tunisien reste l’exception au sein du monde arabo-musulman qui n’a pas encore réussi une conciliation entre la religion et la modernité.




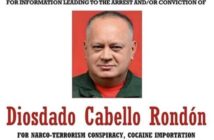
2 Comments
Dire que l’islam n’a été que spirituel au début est faux puisque le prophète de l’islam a été un dirigeant politique, un chef d’Etat, un juge et même un chef de parti, le “Hezbollah”. Il est clair que le message de l’islam est politique, économique et social puisque le principal péché en islam après le shirk (ou adoration des veaux d’or) est l’usure et donc tout système politique tolérant l’usure doit être combattu, ce qui passe par la lutte politique. L’islam est un projet holistique qui englobe tout et, bien sûr, à cause de cela il a été détourné par des pouvoirs politiques oppressifs et exploiteurs voulant se justifier et dans ce but lui retirer sa charge révolutionnaire et qui ont fait interpréter les textes en ce sens. Mais s’il y a un islam politique conservateur, “réactionnaire”, s’il y a aussi à côté un islam spirituel de progression individuelle, il y a aussi un islam révolutionnaire de progrès social. D’où l’enjeu de s’emparer de l’islam pour lui faire dire ce qu’on veut lui faire dire et l’empêcher de dire ce qu’il a à dire. Nier cet enjeu est impossible et la charia n’est pas un code juridique fermé mais un ensemble de règles éthiques puisées dans le Coran et adaptables en fonction de l’évolution des sociétés. Car les messages prophétiques ont été révélés successivement pour souligner que la vie est progression et donc que la vie politique, sociale et juridique est aussi progression constante. Donc il n’y a pas une charia mais une voie qui évolue à mesure que progresse la spiritualité de l’humain et sa conscience sociale et politique sur fond de développement économique.
Les sociétés arabes, du Maroc à l Irak, à l exception du royaume saoudien en mal de légitimité, sont des sociétés tout à fait laïques. Les hommes et les femmes vaquent à leurs occupations quotidiennes sans se référer aux canons religieux. Jusqu’au statut constitutionnel de la religion, il n est que pure forme, au regard des permissivités aux antipodes des textes. Les sociétés arabes refusent, peut etre, la cadence vers la modernité qu on leur impose. L explosion démographique nettement notable chez les ruraux, installés anarchiquement dans les villes, y est pour l essentiel. Il reste que, ce bouillonnement composite comme si bien décrit dans la communication, met face à face , deux adversaires minoritaires mais mieux organisés que les autres et prêts à en découdre : les régimes politiques cloîtrés dans leur tour d ivoire ,i refusant jusqu’à aux réformes initiés de l intérieur et les partisans d un levier mobilisateur qui ne mobilisé plus.