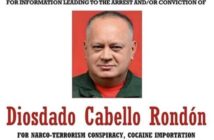Il serait stupide de vouloir déjà enterrer Donald Trump, alors qu’il vient d’être élu par l’Amérique profonde, l’Amérique des sans voix, de tous ceux qui en général ne se déplacent jamais pour une élection, fût-elle présidentielle.
Ce n’est pas le moindre mérite, voire le moindre talent, pour cet homme que rien ne prédisposait à présider aux destinées de la première puissance du monde. Cela pourrait rappeler aussi l’épopée hétérodoxe d’un Donald Reagan, issu des studios d’Hollywood, lequel avait sidéré le monde entier quand il réussit à accéder à la magistrature suprême américaine. Lui non plus ne provenait pas du sérail et pourtant, entouré de conseillers de talent, il a contribué à donner un nouveau visage à l’Amérique et remporta un second mandat.
Il faut donc se méfier de ces figures que le microcosme politique et médiatique qualifie trop vite d’incompétents. Ils ont le privilège parfois d’explorer des solutions ignorées, que certains qualifieraient d’invraisemblables (« off the beaten track »).
Déjà, il faut reconnaître au président Trump la pertinence de son analyse en ce qui concerne l’importance numérique de l’Amérique profonde, de celle qu’on n’entend jamais et qui souffre autant, si ce n’est plus, que les citoyens de l’Europe profonde souvent mieux protégés socialement. C’est cette Amérique profonde qu’il a su réveiller et c’est elle qui l’a fait gagner ; et ce processus a des chances de se répéter ailleurs. Donald Trump, issu du monde impitoyable des affaires américain puisera dans son expérience les ressources nécessaires à impulser un rebond pour son pays qui, sous les huit années de gestion démocrate, n’a pas réussi à sortir de la crise structurelle malgré des statistiques parfois flatteuses, mais trompeuses ; l’administration Obama a trop facilement eu recours à l’endettement extrême et à la dévaluation de facto du dollar pour impulser une fausse croissance qui n’a rien de vertueux…
Mais c’est sur le plan des relations internationales que l’Amérique s’apprête à effectuer un « U-turn », qui devrait pulvériser l’héritage d’Obama en la matière, héritage médiocre en ce qui concerne le Moyen-Orient (dans d’autres régions du globe, le rétablissement de relations avec La Havane et avec Téhéran est cela dit à porter au crédit du président sortant).
Concernant le monde arabo-musulman, il ne fait pas de doute que les conceptions variées exprimées par Donald Trump, même sans grande précision encore, ont de quoi désorienter tout les experts… Il ya toutefois quelques principes majeurs auxquels le nouveau président des États-Unis semble ne pas vouloir déroger, présentés avec vigueur et constance tout au long de la campagne électorale.
Ainsi en va-t-il du retour de la diplomatie américaine vers des préoccupations autocentrées, ce que l’on pourrait assimiler à un certain isolationnisme, lequel contrasterait durement avec les stratégies expansionnismes débridées de la période Clinton (Europe centrale et Yougoslavie), G.W. Bush (guerre en Irak) et Obama (guerres camouflées par mandataire interposé ou « proxy wars », les pires de toutes, car opaques, qui ont permis à Obama de manœuvrer en sous-main dans tout le Moyen-Orient en y déversant des milliards de dollars et des tonnes de matériel militaire à l’insu de la communauté internationale).
La fin d’une stratégie de protection gratuite des pays dits alliés, ce qui implique que ces pays soient vite appelés à contribuer financièrement aux coûts énormes du maintien du « parapluie américain ».
Une volonté farouche de s’entendre avec la Russie, ce qui constitue une césure brutale dans la stratégie antirusse de son prédécesseur, au moment où les relations américano-russes ont, depuis la fin de la guerre froide, atteint l’étiage le plus bas jamais connu. L’obsession antirusse d’Obama était en effet d’ordre idéologique, alors que les Républicains se sont montrés toujours plus pragmatiques. Bush-père avait ainsi renoncé à s’attaquer à Hafez al-Assad après la fin de la guerre de libération du Koweït (1991), guerre où la Syrie s’était positionnée du côté américain.
Une aversion du monde musulman, exprimée à plusieurs reprises de façon abrupte, notamment quand le candidat Trump a affirmé vouloir interdire l’immigration musulmane aux États-Unis, au moment il est vrai où les attentats islamistes s’intensifiaient dans le monde et où des flux de migrants sans précédent déferlaient sur une Europe incrédule. Si cette politique était mise en œuvre, l’ensemble des relations des États-Unis avec le monde musulman s’en trouverait modifié ; l’assistance militaire et financière américaine se raréfierait et répondrait aux seuls cas où les turbulences à combattre pourraient avoir un impact direct sur les États-Unis eux-mêmes.
Le monde unipolaire américain impliquant des interventions américaines tous azimuts touche à sa fin. Et il ya une logique à tout cela : pour trouver des solutions pérennes au marasme interne américain, il faut investir en Amérique de façon colossale et donc réaffecter les ressources budgétaires limitées aux seuls besoins domestiques. Ainsi, Donald Trump va se désengager, ou tout du moins, se distancer de tous les conflits internationaux, à commencer par ceux du Moyen-Orient, une hémorragie financière pour le pays ; sauf si ces conflits constituent une menace pour l’Amérique. Cette prise de position est cohérente avec la stratégie consistant à mettre d’abord les ressources américaines au service des besoins internes du pays.
En ce sens, en ce qui concerne la Syrie, Donald Trump porte un regard complètement différent de celui de son prédécesseur, lequel regardait le Moyen-Orient d’une façon idéologique, dans le sillage des libertés débridées des printemps arabes qui ont apporté partout, sauf peut-être en Tunisie, chaos et confusion. Obama avait ciblé exclusivement la chute du régime syrien, ce qui lui servait à justifier toutes ses entreprises, y compris les plus opaques, comme si Bachard al-Assad était le seul autocrate arabe à combattre, des régimes bien pires existant pourtant dans le monde arabo-musulman. Il suffit pour s’en convaincre de s’interroger sur tous les États de la péninsule arabique. Donald Trump a quant à lui explicitement déclaré, dans une interview exclusive pour le Wall Street Journal, qu’il allait mettre dans ses priorités la lutte contre Daech, plutôt que le renversement de Bachar Assad.
Encore plus explicite fut cette autre déclaration : « Si Washington attaque le gouvernement syrien, cela finira par le déclenchement d’une guerre contre la Russie. Je pense que les Américains luttent contre le gouvernement syrien et le gouvernement syrien lutte contre Daech alors que nous aussi, nous devons nous débarrasser de Daech. À présent, la Russie reste sur la même longueur d’onde que la Syrie. Là, il ne faut pas oublier l’Iran qui, lui aussi, agit de concert avec Damas. C’est en raison de notre laxisme que l’Iran se renforce de plus en plus. Nous soutenons les opposants à Bachar al-Assad alors que nous ne savons pas qui ils sont exactement. »
Et de conclure : « Bien que Bachar al-Assad ne constitue pas une option idéale, il pourrait, pourtant, être une meilleure option que les groupes qui pourraient le remplacer. »
Un revirement en la matière ! Et, rapprochement probable avec la Russie de Poutine oblige, Donald Trump condamne aussi les agissements des groupes terroristes actifs en Syrie, à commencer par le Front al-Nosra (récemment rebaptisé depuis Fatah al-Cham), longtemps cajolé par l’administration Obama, et ce bien que, jusqu’à un passé récent, le groupe se considérait officiellement comme la branche d’al-Qaeda en Syrie (ce qui en dit long sur la pertinence de la stratégie du camp démocrate en Syrie, et surtout sur sa dangerosité).
Il ne faut pas oublier que pendant les dix-huit derniers mois, le secrétaire d’État John Kerry avait dépeint les membres de cette mouvance djihadiste sous les traits de citoyens démocrates ne désirant que « renverser le régime syrien, mais pas plus ». Le pire, c’est qu’à force de le répéter, l’Europe, fortement perméable à la méthode Coué, avait fini par le croire et par adouber ce groupe islamiste. On se souvient des paroles d’un certain ministre français des Affaires étrangères déclarant « qu’al-Nosra avait fait un bon boulot ! ». Un comble !
Certes, pour se refaire une virginité, ce groupe qui a commis des centaines d’attentats et de crimes, aussi crapuleux que ceux commis par le régime, a décidé depuis peu de changer d’appellation, pour brouiller les pistes ; et il s’est donc choisi ce nouveau nom, Fatah al-Cham (« la Conquête du Levant »), pour mieux maximiser ses chances de survie et de représentativité dans l’avenir post-Assad. Cependant, des révélations de plus en plus troublantes sur les exactions et ambitions de ce groupe ont ébranlé la diplomatie américaine : Obama, selon un article récent du Washington Post, aurait décidé l’élimination immédiate, avant la fin de son mandat, des responsables de cette mouvance, s’inquiétant aussi de ce qu’al-Nosra était en train de multiplier ses bases opérationnelles au nord de la Syrie, prés des frontières européennes… De nouvelles bases dans lesquelles al-Nosra coopérerait activement avec de hauts responsables d’al-Qaeda venus du Pakistan et d’Afghanistan. Il aura fallu du temps à l’administration Obama pour voir clair dans cette affaire ; et c’est toute sa diplomatie syrienne qui est en train de s’écrouler. Selon plusieurs sources, l’administration Obama voudrait tout simplement effacer toutes les traces de la coopération entre Washington et al-Nosra avant que Donald Trump ne les dévoile au monde. Obama s’est soudainement changé en « lame duck » : sa stratégie syrienne est un échec total, d’autant que l’autre groupe rebelle sur lequel il l’avait fondée, « l’Armée syrienne libre » (ASL), s’est réduit comme une peau de chagrin et ne représente plus une solution crédible dans un « avenir post-Assad ».
En résumé, si Donald Trump considère le président syrien comme un « bad guy », le nouveau locataire de la Maison blanche n’a aucune intention d’apporter son soutien à des rebelles « que personne ne connaît ». Il prône au contraire une alliance avec « la Russie qui, comme l’Iran et Assad, combat l’État islamique, pour lutter contre les djihadistes », face auxquels il a élaboré une stratégie dont il a refusé de dévoiler jusqu’à présent le contenu pour ne pas perdre… « l’effet de surprise ».
Donald Trump devrait pousser plus loin encore l’entreprise de démolition de la politique obamienne, d’autant qu’il entend l’orage qui gronde déjà en Europe contre l’islamisme militant, lequel s’en prend de plus en plus franchement aux valeurs de l’Occident. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est lui-même influencé par les milieux évangélistes qui l’ont fait élire. De ce fait, Donal Trump a aussi dans son collimateur les Frères musulmans ; et il trouvera dans ce dossier, avec le président al-Sissi, un allié puissant, une alliance avec l’homme fort du monde arabo musulman, qui voue aux gémonies la confrérie des Frères musulmans qu’il rend responsable de tous les malheurs actuels de l’Égypte.
En effet, pour Donald Trump, les Frères musulmans forment « une des plus dangereuses organisations terroristes », et il serait prêt à les frapper militairement pour les anéantir, alors qu’Obama les protégeait, les invitait régulièrement à Washington, ayant même soutenu jusqu’au bout Mohamed Morsi en Égypte et s’appuyant sur le parti Ennahdha en Tunisie. Une analyse partagée par un député égyptien, président de la commission des relations avec l’Afrique du parlement, lequel a été proche de Donald Trump durant la campagne électorale américaine ; il a qualifié l’arrivée de Trump à la Maison blanche de « désastre pour les Frères musulmans ».
Lutter à la fois contre Daesh, Jabhet al-Nosra (Fatah al-Cham) et les Frères musulmans, voilà à quoi devrait ressembler la stratégie de Donald Trump au Moyen-Orient, stratégie aux antipodes des choix obamiens depuis 2011.
Ainsi, parmi les objectifs de Trump en politique extérieure, la stabilisation de la situation au Proche-Orient passe par l’éradication du terrorisme, premier facteur de guerre. Pour Donald Trump, présenté comme hostile à la guerre, il y a d’autres moyens pacifiques de servir les intérêts des États-Unis que cette compromission avec des organisations qui, comme les Frères musulmans, nourrissent l’idéologie du terrorisme.
Le régime saoudien, à ce nouveau jeu, risque d’être le grand perdant, lui qui avait misé sur Hillary Clinton et avait financé une partie de sa campagne électorale, selon les révélations faites par les médias. On se souvient des insultes du prince Al-Walid, membre de la famille royale saoudienne, connu pour son franc-parler, et qui dirige le groupe Kingdom Holding Co, dont les intérêts s’étendent aux géants américains Citigroup et Time Warner. En décembre 2015, il s’en était vivement pris à Donald Trump parce que ce dernier avait proposé, alors qu’il était en campagne pour les primaires républicaines, d’interdire aux musulmans l’entrée aux États-Unis. La réplique de Donald Trump avait été cinglante : « Le stupide prince Al-Walid veut contrôler nos hommes politiques américains avec l’argent de son papa. Il ne pourra pas faire cela quand je serai élu. » Tout ceci a laissé des traces, et le nouveau président ne peut l’oublier.
Le candidat républicain avait ensuite modifié sa position sur les musulmans pour appeler à une interdiction de l’entrée aux États-Unis de ressortissants des seuls pays ayant « une histoire prouvée de terrorisme » et « à un contrôle plus poussé des migrants ». Cela n’a pas empêché le prince milliardaire saoudien Al-Walid de féliciter par la suite Donald Trump, après l’avoir qualifié de « honte pour l’Amérique » ; mais le ressentiment du nouveau président envers le royaume saoudien est toujours vif et il est inéluctable que la stratégie américaine vis-à-vis du royaume se durcira. Un froid avait déjà été perçu entre Obama et le nouveau monarque saoudien, qui n’avait jamais accepté le traité sur le nucléaire iranien signé sous l’impulsion d’Obama.
Certes, Trump n’ira probablement pas jusqu’à handicaper les intérêts économiques américains dans les monarchies du Golfe. Il ne pourra oublier par exemple, que la compagnie Kingdom Holding Co du prince saoudien détient des parts dans des sociétés aussi diverses que le parc d’attractions Euro Disney, la chaîne hôtelière Four Seasons, Citigroup et le géant des médias News Corporation. Le milliardaire saoudien est en outre devenu le deuxième actionnaire de Twitter…
Mais il faut s’attendre a minima à deux réactions de la nouvelle administration : l’imposition d’un frein à l’expansion du wahhabisme mondial financé par la manne pétrolière saoudienne, idéologie reprise par la plupart des djihadistes et dont l’Arabie est pleinement responsable depuis des décennies ; et l’exigence d’une participation financière accrue du royaume s’il veut continuer à bénéficier du parapluie militaire américain. Ainsi Donald Trump déclarait-il naguère : « Regardez, nous protégeons l’Arabie saoudite. Nous les protégeons en échange de presque rien. Et sans notre protection, ils ne survivraient pas plus d’une semaine. Nous les protégeons comme nous en protégeons d’autres… Et on se demande pourquoi notre dette publique s’élève à 19 trillions de dollars ! »
Le royaume est riche ; et Donald Trump l’a déjà menacé de devoir participer activement à la guerre contre Daesh, en envoyant et finançant des troupes au sol en Syrie, sous peine de se voir imposer des sanctions économiques. Trump a même laissé entendre que, sans le soutien de Washington, l’Arabie saoudite pourrait « imploser » ! Le réveil sera dur pour les Saoud…
Quant aux islamistes, ils assistent médusés à l’irruption imprévue de Donad Trump dans leurs stratégies et projets. Il est sûr qu’ils auraient mieux aimé le prolongement de la stratégie « soft » et parfois complaisante d’Obama, lequel ne reconnaissait alors comme seuls ennemis de l ‘Amérique que les partisans de Daech et aucun autre.
Le ton est donné et beaucoup de militants djihadistes s’attendent à « des batailles sanglantes et un chaos encore plus grand ». Le 9 novembre 2016, Abou Mohammed Al-Maqdissi (proche du chef d’Al-Qaida, Ayman Al-Zawahiri) et Abou Qatada Al-Filistini, ancien représentant en Europe d’Oussama Ben Laden, ont parlé d’un retour aux années Bush, celles du choc frontal entre le réseau terroriste et la Maison blanche : « Puisse le mandat de Trump devenir le début d’une division de l’Amérique et le temps de la désintégration. », a déclaré Abou Mohammed Al-Maqdissi.
Déjà, sur l’injonction d’Obama, comme s’il s’agissait d’une transition douce, un raid aérien programmé par les conseillers du Pentagone ont tué deux cadres d’al-Nosra dans la région d’Idlib et les États-Unis ont par ailleurs réinscrit, le 10 novembre, le Front Fatah Al-Cham sur leur liste des organisations terroristes. Du jamais vu sous la présidence Obama, forcé de durcir le ton avant l’arrivée de Donald Trump. Comme si la longue récréation était terminée !
Il serait injuste aussi de ne pas prendre en compte que, dans cette nouvelle configuration, l’État hébreu vient de marquer de sérieux points. Nul n’ignore que le chef de l’exécutif israélien, Benjamin Netanyahu, en froid avec l’administration Obama, avait plus appuyé Donald Trump qu’ Hillary Clinton lors de la campagne électorale…
Si Donald Trump avait au départ promis d’adopter une position de neutralité par rapport au conflit israélo-palestinien, il a ensuite durci son discours en faveur d’un soutien total à Israël, en promettant, entre autres, s’il était élu, de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël, mettant ainsi fin ainsi aux revendications palestiniennes.
En outre, Donald Trump a déclaré, peu après son élection, que la création d’un État palestinien « n’était désormais plus d’actualité »… Naftali Bennett, le ministre de l’Éducation et chef du Foyer juif (un parti religieux fervent partisan de la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens) a ainsi insisté, fin novembre, sur le fait que, avec l’élection de Trump, « l’époque d’un État palestinien (était) révolue ».
C’est à coup dur pour l’Autorité palestinienne et encore plus pour le Hamas dont Trump parle toujours en termes belliqueux. Cependant, Israël s’inquiète de la possibilité que le président Barack Obama puisse promouvoir, avant son départ du pouvoir le 20 janvier 2017, une résolution à l’ONU sur le conflit avec les Palestiniens à laquelle s’oppose l’État hébreu. L’administration américaine actuelle a en effet durci ses critiques contre la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est annexée.
Et le leader du parti religieux séfarade Shass, Aryé Dery, d’affirmer, le 10 novembre, que l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis pourrait présager « l’avènement de l’ère messianique ».
L’Iran, au contraire, risque fort de se retrouver dans le camp des perdants, tant est grande l’aversion de Donald Trump envers le traité nucléaire iranien qui a eu pour conséquence de faire entrer à nouveau l’Iran des ayatollahs dans le concert des nations.
Cependant, si Donald Trump prenait position contre le traité nucléaire multilatéral, l’Iran n’hésiterait pas à reprendre ses activités d’enrichissement, comme l’ont déjà confirmé les dirigeants iraniens. Les États-Unis pourraient alors se retrouver isolés si les autres signataires maintenaient leur adhésion au traité, car il s’agit d’un accord multilatéral et approuvé internationalement. D’ailleurs, à peine quelques semaines avant la tenue des élections aux États-Unis, le président iranien Rohani et son équipe, en prévision d’une éventuelle victoire de Trump, ont signé délibérément un énorme contrat pétrolier avec la compagnie française Total. Ce contrat est sensé préserver l’Iran des impacts que pourrait avoir une révocation de l’accord nucléaire par Washington. L’Iran tenterait aussi de faire miroiter à Donald Trump, dont le tropisme pour les affaires est important, les avantages pour les entreprises américaines d’investir en Iran… Les Iraniens entendent également suggérer à Trump de tirer leçon du comportement de la France, l’un des pays à avoir durement résisté à la signature de l’accord avec l’Iran, au point de sen mordre les doigts.
Ainsi, la politique de Donad Trump se dessine lentement.
Si les détails sont ignorés, il n’en reste pas moins que certains principes directeurs, ceux qui viennent d’être évoqués, commencent à se matérialiser, même si d’ores et déjà des contradictions commencent à poindre.
Contradictions ? Ainsi, le nouveau président souhaite se rapprocher des Russes, et par conséquent du régime syrien ; mais il a pourtant critiqué avec virulence l’attitude de l’Iran, l’autre parrain du régime syrien, contre lequel il a promis la renégociation de l’accord sur le nucléaire. C’est une contradiction majeure : comment ménager le binôme Poutine-Assad tout en tapant sur le régime iranien ?
Mais ceux qui sont sûrs d’y perdre au change, ce sont les groupes djihadistes que l’administration Obama a laissé pulluler dans le Moyen-Orient, voire a favorisées. Ceux-là seront les premiers visés par la nouvelle stratégie américaine. L’Arabie saoudite et le Qatar devront modifier leur approche de leurs soutiens permanents à toutes ces mouvances qui sont devenues un danger non seulement pour le Moyen-Orient, mais aussi pour l’Europe et les Etats-Unis.