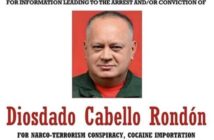Ce 21 décembre 2014, la Tunisie élira au suffrage universel son premier président depuis la révolution de 2010-2011. Elle choisira entre les deux candidats issus du premier tour : le président sortant, Moncef Marzouki, qui a été élu à titre provisoire, en 2011, par les membres de l’Assemblée constituante, et Béji Caïd Essebsi, vétéran bourguibiste et leader du parti Nidaa Tounes. Beaucoup reprochent à ce dernier son passé à la tête du ministère de l’Intérieur de Bourguiba et ses accointances avec le la dictature de Ben Ali. Mais, pour d’autres, ce n’est pas l’ancien régime qui revient au pouvoir ; et l’élection d’Essebsi assurerait la stabilité politique en Tunisie et ferait barrage aux ambitions des islamistes…
À la veille de ce second tour où, malgré des estimations serrées, Essebsi est donné favori, la Tunisie est incontestablement divisée en deux camps. D’une part, les islamistes et les partisans de l’ex-Troïka, rangés derrière Marzouki, redoutent le « taghaouel » de Nidaa Tounes,vainqueur aux législatives du 26 octobre dernier, c’est-à-dire la mainmise totale de ce parti sur l’appareil de l’État ; ilsespèrent cependantconjurer ce risqueen remportant la présidence. De l’autre, les partisans la coalition menée par Nidaa Tounes, dans laquelle diverses sensibilités allant de la droite libérale à l’extrême-gauche sont réunies, redoutent les retombées d’un éventuel bicéphalismede l’exécutif (président vs. premier ministre) et appellent de tous leurs vœux la défaite de Marzouki.
Avant d’analyser ces enjeux et ces appréhensions, il faut d’abord souligner que, même si la magistrature suprême en Tunisie n’a plus, constitutionnellement, les compétences qui étaient les siennes sous Bourguiba ou son successeur Ben Ali, le prochain président tunisien aura un poids inestimable dans la réussite ou l’échec de la politique gouvernementale, sachant que les orientations générales de la défense, les affaires étrangères, la ratification des traités internationaux, l’assurance de la sécurité intérieure de la République, la nomination du Gouverneur de la Banque centrale et du Mufti de la République, le droit de grâce (il convient de noter ici que, sous les trois ans du mandat provisoire de Moncef Marzouki, les assassinats politiques ou les actes terroristes visant l’armée et la police ont été en partie l’œuvre d’anciens prisonniers graciés ; et beaucoup de ces prisonniers graciés ont traversé les frontières pour grossir les rangs des djihadistes en Irak, en Syrie ou en Libye), entre autres compétences, font partie des droits régaliens du président. Sachant aussi que le président aura aussi le pouvoir de renvoyer des projets de lois adoptés par le Parlement, pour une seconde délibération ; il pourra également soumettre au référendum populaire les projets de lois sensibles liées aux droits et libertés, au statut personnel ou tout projet de révision de la Constitution. Sachant enfin qu’il pourra assister au Conseil des ministres et le présider. On peut donc imaginer les scénarios potentiels qui suscitent les craintes des uns et des autres en cas d’élection du candidat du camp adverse…
En cas de victoire de Béji Caïd Essebsi, ainsi, la Tunisie ne connaîtrait pas les crises politiques à répétition qui, dans le cas contraire, pourraient opposer le gouvernement au président de la république. L’entente au sein de l’exécutif, garantie de facto par l’appartenance du premier ministre et du président à la majorité parlementaire, épargnera au pays les dissidences du pouvoir, à redouter d’une la cohabitation qui s’annoncerait difficile, voire impossible.
Par contre, si Moncef Marzouki était élu, le dualisme installé à la tête du pouvoir exécutif ne pourrait que ralentir le travail du gouvernement, qui se verrait bridé, bloqué peut-être, voire dissout en cas de conflit ou de bras de fer entre les deux têtes de l’exécutif. La situation du président lui-même ne serait pas enviable : il risquerait l’isolement, s’il se mettait à dos un gouvernement contrarié de façon abusive et systématique. Et, dans un tel cas de figure, il va sans dire que le pays ne pourrait que pâtir des conséquences négatives d’un tel marasme politique.
Pour les partisans de Marzouki, en revanche, le vrai danger, c’est plutôt celui de l’accaparement de tous les pouvoirs par la partie adverse. D’autant que celle-ci, à leurs yeux, constitue un dangereux avatar de la dictature déchue. Derrière Béji Caïd Sebsi et son parti Nidaa Tounes, les inconditionnels de Marzouki ne voient que les anciens militants ou adhérents du RCD (Rassemblement constitutionnel démocratique, le parti unique du régime de Ben Ali), les « azlams »(terme péjoratif qui désigne les taupes, les auxiliaires de l’ancien régime) de Ben Ali, recyclés et déjà de retour, sous les oripeaux du social-libéralisme bourguibiste.
Par conséquent, seule une victoire de Marzouki à la présidentielle pourra dresser un« rempart » face au retour de la dictature. C’est en tout cas le leitmotiv des marzoukistes et de leur candidat, depuis le début de la campagne électorale.
Mais ce spectre du retour de la dictature, qu’agitent inlassablement Marzouki et ses partisans, n’a aucun fondement concret. C’est un épouvantail électoraliste éculé, qui a déjà servi aux islamistes d’Ennahdha lors de la campagne électorale de 2011. Et l’anathème sans cesse lancé contre Béji Caïd Essebsi et son parti (« taghaoual » et « azlams ») ne peut duper que les simples d’esprit.
Car la réalité de Nidaa Tounes est toute différente de l’image caricaturale et ridicule que tentent d’en donner Moncef Marzouki et ses partisans : fondé et autorisé en 2012 sous la gouvernance de la Troïka et avec la bénédiction du ministre de l’Intérieur islamiste Ali Larayedh qui en a signé le visa d’autorisation, ce parti a pu rassembler en deux ans les diverses sensibilités opposées au régime de la Troïka. Que ce parti compte aujourd’hui parmi ses adhérents beaucoup d’anciens destouriens et RCDistes, cela est indiscutable. Mais la grande majorité de ses dirigeants -et il n’est que de voir ses comités constitutif et exécutif pour s’en rendre compte- sont d’authentiques opposants à Ben Ali, dont beaucoup sont issus de la mouvance progressiste et des divers courants de la gauche.
Ainsi le numéro deux de ce parti, Taïeb Baccouche, n’est autre que l’ancien secrétaire général et l’idéologue de l’UGTT (Union générale tunisienne du Travail), en exercice entre 1981 et 1985. Ce leader syndical était aussi, de 1998 à 2011, le président de l’Institut arabe des Droits de l’Homme. À côté de Taïeb Baccouche, on trouve Boujemâa Remili, militant du Parti communiste tunisien (devenu Mouvement Ettajdid, puis Pôle démocratique moderniste). On trouve aussi Mohsen Marzouk, qui a milité au sein du Travailleur tunisien (mouvement marxiste-léniniste) et ensuite au sein de la Ligue tunisienne des Droits de l’Homme. Citons encore le doyen des défenseurs des Droits de l’Homme, Ali Ben Salem, ou le militant et leader syndical Abdelmajid Saharaoui…
Quel crédit donner, dès lors, aux accusateurs de Nidaa Toues, quand on sait que la plupart de ces militants droits-de-l’hommiens ont subi la persécution et la prison, soit sous Ben Ali, soit sous son prédécesseur, soit sous l’un et l’autre et même pour certains, auparavant déjà, à l’époque de la présence française ?
Mais il faut souligner aussi que ceux qui, malgré ces considérations, accusent Nidaa Tounes d’être la nouvelle officine des RCDistes oublient que le premier parti à avoir recyclé en masse les anciens du RCD, au lendemain des élections de 2011, c’est Ennahdha, ce même mouvement qui soutient aujourd’hui, directement ou à travers son électorat, la candidature de Marzouki.
Quant aux reproches du même ordre qui ciblent plus particulièrement la personne de Béji Caïd Essebsi, ils sont tout autant dénués de fondement.
En 1980, en effet, Béji Caïd Essebsi a été le premier proche de Bourguiba à avoir eu le courage de prôner le multipartisme. Et il a appelé à la mise en place d’un régime réellement démocratique et à la fin de l’hégémonie du parti unique. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire c’est d’avoir été président de la Chambre des députés, sous Ben Ali, durant un an et demi. Mais Essebsi s’était retiré de lui-même de la scène politique, en 1991, et n’y est revenu que vingt ans plus tard, après la révolution du 14 janvier 2011.
Les Tunisiens n’oublient pas que c’est sous la gouvernance de cet homme, désigné au poste de premier ministre, entre le 27 février et le 24 décembre 2011 (sous la présidence intérimaire de Fouad Mebazaa) que leur pays a pu organiser ses premières élections libres et démocratiques, en octobre 2011.
Par conséquent, il est certain que le spectre de « la dictature revenante » qu’il faudrait combattre en soutenant la réélection de Moncef Marzouki n’est qu’un alibi malhabile qui ne peut tromper les Tunisiens avertis.
Les Tunisiens avertis savent que la véritable bataille pour la présidentielle ne se joue pas entre Marzouki et Essebsi, mais entre ce dernier et Ghannouchi, le chef de file d’Ennahdha. C’est-à-dire entre le camp séculier et le camp islamiste. Marzouki, effet, dont le parti, le CPR (Congrès pour la République), n’a remporté que 4 sièges aux législatives récentes, avec 2,4% des voix (contre 86 sièges et 37,86% des voix pour Nidaa Tounes) ne sert que de prête-nom circonstanciel à Ennahdha ; et, sans le report de voix islamistes qui lui a permis de remonter la pente, Marzouki n’aurait pas franchi le premier tour des présidentielles. Il n’aurait même pas distancé son associé dans l’ex-Troïka Mustapha Ben Jaafar, classé dixième, qui n’a obtenu que 0.67% des voix.
Les Tunisiens avertis savent que, ce qui inquiète en réalité Marzouki et ses amis, ce n’est pas le retour de la dictature. La Tunisie en est désormais protégée par un rempart infranchissable : la nouvelle constitution, adoptée le 26 janvier 2014 et promulguée le 10 février de la même année.
Les Tunisiens avertis savent que, ce qui inquiète Marzouki et ses amis, c’est d’avoir à rendre des comptes, pour les abus de pouvoir et les crimes politiques (dont les assassinats de Belaïd et Brahmi) qui ont marqué la gouvernance de la Troïka, de décembre 2011 à janvier 2014.