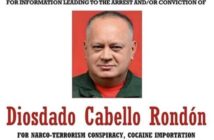La menace globale que constitue l’État Islamique aurait pu susciter une « alliance sacrée » associant toute la Communauté internationale, y compris les États de la région du Golfe persique. Pourtant, le projet d’une véritable « coalition internationale » sous mandat de l’ONU n’aboutira pas, victime de la permanence des deux blocs sunnite et chiite ; mais aussi des tensions diplomatiques liées à la crise ukrainienne. Une autre logique de blocs, que l’on avait à un moment cru disparue… Le front irako-syrien qui se dessine apparait donc fragmenté, tiraillé entre deux paires d’axes parfaitement concurrents.
L’actuelle coalition emmenée par les États-Unis est condamnée à mener sa guerre depuis les airs, faute de pouvoir inclure les forces qui, au sol, s’opposent depuis bientôt deux ans à la nébuleuse djihadiste, à savoir l’axe Syrie-Iran-Hezbollah-Russie.
De crainte de renforcer ces alter egos, la guerre improvisée du président états-unien Barack Obama et de son vice-président Joe Biden se construit dans les faits autour d’un second objectif, celui de contenir l’influence croissante de l’Iran et de ses alliés ; et ce même si les relations entre Washington et Téhéran se sont remarquablement détendues depuis l’élection d’Hassan Rohani à la présidence de l’Iran.
Par ailleurs, la rivalité croissante qui dresse Moscou et Washington l’une contre l’autre ne se cristallise pas qu’en Europe centrale : si l’Ukraine est devenue un nouveau terrain de guerre froide, la Syrie l’était déjà depuis 2011…
Iran – États Unis : une alliance impossible ?
Malgré les déclarations régulières niant toute collaboration avec les États-Unis, l’Iran a réellement tenté d’utiliser la crise irakienne comme le levier de sa réintégration au sein de la Communauté internationale, dans la droite ligne de la politique pragmatique menée par Rohani depuis 2013.
D’importantes concessions ont été imposées à la ligne dure des conservateurs, comme signe de bonne volonté. Ainsi, après avoir accepté le départ de son protégé Nouri al-Maliki (l’ancien premier ministre chiite d’Irak), le Guide suprême aurait même consenti à écarter des opérations en Irak Qassem Suleimani, le très anti-américain commandant de la Force al-Qods des Gardiens de la révolution. Son remplacement par le modéré Ali Shamkhani, actuel président du Conseil suprême de la Sécurité nationale et ancien ministre du gouvernement libéral de Mohammad Khatami, devait permettre d’afficher un interlocuteur acceptable pour les Occidentaux et pour les Irakiens, Shamkhani étant en effet un Arabe d’Iran.
Reste que le statut « d’allié » dans la lutte contre le terrorisme ne sera finalement jamais adopté par les Américains. Cet échec diplomatique est un camouflet cuisant pour la ligne des pragmatiques qui soutiennent Rohani ; et le président de l’Iran fait désormais face à de virulentes critiques provenant de son aile droite, conservatrice et violemment anti-américaine : on lui reproche sa rencontre récente avec David Cameron, le premier ministre britannique, qui fut suivie d’une déclaration américaine continuant d’affirmer que l’Iran faisait partie des États soutenant le terrorisme dans le monde.
Une position de force au Moyen-Orient qui inquiète Washington
Le fait que l’Iran reste exclu ne peut s’expliquer uniquement par l’enlisement des négociations sur son programme nucléaire. Certes, malgré les appels à un « règlement définitif » de l’émissaire du Guide suprême, Abbas Araghchi, Téhéran n’a fait aucune concession réelle envers ses interlocuteurs du 5+1 (les cinq membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, plus l’Allemagne) lors de cet énième « round » qui devrait ainsi se conclure, le 24 novembre prochain, par un nouvel échec, et donc un maintien du régime des sanctions occidentales. Cependant, l’administration américaine s’est montrée bien moins hargneuse dans ce dossier qu’elle ne l’avait été à l’époque de la présidence du conservateur Mahmoud Ahmadinejad.
Plus largement, donc, le choix d’Obama ne peut se comprendre qu’en prenant conscience du renforcement considérable de la position de l’Iran sur tous les fronts régionaux.Sur le théâtre syro-libanais, le régime d’Assad conserve en effet ses bastions et profite indirectement des frappes contre les djihadistes, tandis que le Hezbollah maintient son rôle prééminent sur la scène politique et sécuritaire du Liban. En Palestine, l’incapacité d’Israël à détruire les organisations militaires de la Bande de Gaza maintient intacte le potentiel de nuisance iranien en tant que fournisseur d’armes lourdes. En Afghanistan, le retrait militaire graduel de l’OTAN donne plus que jamais à l’Iran un rôle d’interlocuteur incontournable pour la stabilité du pays.
Au Yémen enfin, la récente victoire militaire des Houthistes (chiites), contre un régime dominé par les tribus sunnites et les Frères Musulmans, a conduit à un accord de paix favorable à cette rébellion chiite, armée et soutenue par l’Iran.
La paix finalement conclue au Yémen illustre d’ailleurs les progrès réalisés dans les relations saoudo-iraniennes : l’accord s’est conclu grâce à une concertation entre les deux puissances, l’Arabie saoudite se satisfaisant de la stabilisation de son voisin et de la défaite des Frères musulmans. Ryad a perdu confiance en Washington et serait dès lors ouvert au dialogue avec son éternel adversaire, même si cette ouverture se confrontera fatalement aux intérêts fondamentaux des deux pays, qui restent incompatibles.
On le voit : la question de la réhabilitation de l’Iran au sein de la Communauté internationale et de la place qui serait consentie à cette puissance au Moyen-Orient ne peut se comprendre sans prendre en compte l’interdépendance de ces différents théâtres diplomatico-militaires, où Téhéran a partout renforcé son influence.
Téhéran en passe de phagocyter l’appareil sécuritaire irakien
Mais le principal sujet d’inquiétude américain, lequel a largement motivé le retour à une intervention directe en Irak, c’est le constat d’une prise de contrôle grandissante des Gardiens de la révolution sur l’appareil d’état irakien, à la faveur de la guerre menée contre l’État islamique.
Face à la menace de la chute de Bagdad, al-Maliki avait confié la défense des zones chiites aux différentes milices issues de cette communauté : Badr, Saraya al-Salam, Kataeb Hezbollah ou encore Asaib Ahl al-Haq. Ces groupes armés, qui ont joué un rôle fondamental dans cette guerre, ont multiplié leurs effectifs et contrôlent à présent des portions entières du territoire irakien. Le pouvoir qu’ils ont acquis à la faveur de cette crise leur garantit une influence majeure sur le futur politique de l’Irak. Or, ces groupes restent des satellites de l’Iran, à qui ils doivent leur armement, leur entrainement et leur vision doctrinale.
Malgré le retrait de Suleimani, d’autres acteurs conservent un rôle prééminent à toutes les échelles et sur tous les théâtres d’opération en Irak. Comme le général de brigade Seyed Chafi,qui supervise les quelque 500 formateurs de la Force al-Qods en Irak. Le commandant Abou Mehdi Mohandessen, qui dirige le siège de la force à Bagdad. Le colonel Abdollereza Chalaï, qui entraîne les milices chiites du Kataeb Hezbollah. Enfin, Agha Ja’afari, adjoint de Shamkhani : il est le responsable des relations avec les Kurdes, qui ont largement fait appel à l’Iran au moment de l’offensive djihadiste sur Erbil.
Ces personnages, qui n’apparaitront jamais dans les médias, comptent pourtant parmi les acteurs les plus influents en Irak.
Malgré la présence des conseillers militaires américains, l’évolution de l’appareil sécuritaire d’État irakien montre clairement l’influence prééminente des Iraniens : le cabinet du premier ministre a récemment présenté un projet de loi sur une nouvelle force d’élite sur le modèle des Pasdarans iraniens.
Face à ce que les Américains interprètent comme une prise de contrôle de l’Irak par les supplétifs de l’Iran, le choix d’Obama est un refus officiel de toute coordination directe ou de partage d’information stratégique entre les alliés de l’Iran et ceux des Etats-Unis.
De fait, jusqu’à présent, les deux coalitions se sont tacitement cantonnées sur deux fronts séparés en Irak : la défense de Bagdad et la reconquête de la région de la Diyala, d’une part, est principalement le fait des milices chiites, tandis que la majorité des frappes aériennes et des infiltrations de forces spéciales, d’autre part, au nord et le long de la frontière syrienne, ont été organisées par les États-Unis et leurs alliés.
Des communications indirectes existent toutefois, à la marge, et se transmettent via les rares acteurs qui dialoguent avec les deux parties : les Kurdes irakiens, l’état-major de l’armée irakienne et, dans une moindre mesure, l’armée libanaise.
La coalition internationale dans une impasse
Beaucoup a été écrit sur l’actuelle coalition contre l’État islamique et sur ses défauts originels : ni l’objectif ni les moyens proposés n’ont été clairement fixés, et ils tiennent moins de la planification que d’une improvisation opportuniste.
La principale réussite de cette opération est donc moins la campagne de frappes aériennes, qui accuse un impact limité sur le terrain, que l’effort de John Kerry, le Secrétaire d’État US aux Affaires étrangères, de contraindre les pays du Golfe de choisir clairement un camp, du moins officiellement.
Les état-majors occidentaux sont effectivement parfaitement conscients de la complexité d’amener les pays de l’axe sunnite à s’impliquer réellement dans la coalition : faiblement menacés par l’État islamique, leur engagement est davantage motivé par le souci de réhabiliter leur image face aux accusations de financement des groupes djihadistes dans la région, mais aussi par le désir de peser sur les décisions stratégiques orientant le choix des frappes. Car la notion d’ennemi ne peut se penser en termes conventionnels dans une région où la majorité des grandes coalitions tribales de Syrie et d’Irak (Shammar, al-Baggara, Dulaimi) ont des liens de sang avec des tribus du Golfe, parfois avec les al-Saoud eux-mêmes…
Reste que tous les experts s’accordent sur un point fondamental : dans ces zones peuplées des vallées de la Jezireh (nord-est de la Syrie), comme dans les immensités du désert syro-irakien, aucune victoire militaire ne sera possible sans soldats au sol pour occuper le terrain ouvert par les frappes aériennes.
Ce rôle, exclu pour les soldats occidentaux, devra donc échoir à un acteur local.
L’opposition syrienne armée pourrait jouer ce rôle de « boots on the ground ». Mais, compte tenu de ses effectifs actuels, sa capacité à occuper le terrain reste limitée.
En outre, certains de ces groupes se sont durablement décrédibilisés vis-à-vis de la communauté internationale : la porosité qui existe entre groupes modérés et djihadistes est plus qu’évidente ; d’autre part, nombre de katiba de l’Armée syrienne libre se sont vendues au plus offrant ou ont fini par pratiquer un banditisme effréné dans les régions passées sous leur contrôle.
La Turquie fournirait-elle les troupes au sol dont a besoin la coalition ?
Si la coordination des opérations avec le régime syrien reste un impensé absolu (officiellement en tout cas), le recours aux forces kurdes syriennes comme agent stabilisateur est une option qui fait son chemin. Le Kurdistan d’Irak a d’ailleurs joué ici le rôle de précédent.
Débattue à Washington, l’option est cependant catégoriquement rejetée par la Turquie : pour Ankara, l’affaiblissement des groupes affiliés au PKK est devenu une priorité au même titre que la chute d’al-Assad. Ce sont d’ailleurs ces objectifs qui avaient motivé le soutien turc au futur État islamique, qui présentait l’avantage de contester aux Kurdes les gisements pétroliers de la Jezireh syrienne.
Ce choix impossible explique le récent revirement d’Erdogan, le premier ministre turc : en guise de réponse aux critiques de la Communauté internationale sur sa coupable passivité, le parlement turc a voté sur proposition du gouvernement une loi permettant d’occuper militairement le territoire syrien. Or, cette décision, prise sans l’accord ni du régime syrien ni des milices kurdes, laisse perplexe quant à son agenda et ses objectifs véritables. À court terme, elle devrait se limiter à des incursions de soutien à l’Armée syrienne libre.
Cette guerre est en effet fortement clivante en Turquie, où l’électorat de l’AKP se partage entre un réflexe de solidarité sunnite avec l’État islamique et un souhait de pacifier la frontière sud du pays.
Erdogan devrait donc refuser de s’enliser dans un rôle de supplétif de l’OTAN. Ce qui laissera entier la problématique des forces au sol pour la coalition internationale.
Les tribus sunnites et les Kurdes, forcés de s’intégrer à la logique des blocs
Le jeu diplomatique demeurant très ouvert, il est trop tôt pour préjuger de l’évolution de cette campagne militaire bicéphale.
La priorité des deux blocs, qui est de réduire rapidement la capacité de nuisance de l’État islamique, devrait garantir à court terme une « coopération froide » entre les deux camps, facilitée par les relais que sont les Kurdes d’Irak et les armées irakiennes et libanaises.
Mais la prévisible incapacité à s’entendre sur un règlement global des crises de la région devrait renvoyer le Moyen-Orient à une logique de blocs, encouragée par une Russie désormais prête à une nouvelle guerre froide avec Washington.
Dès lors, on peut dès à présent conjecturer que le recul probable des djihadistes dans les mois à venir fera émerger un enjeu stratégique nouveau : le choix politique des populations qui seront libérées et de facto confrontées au retour de l’autorité d’États qu’elles rejettent tout autant que leurs occupants actuels.
Éternels tampons du jeu des puissances, Sunnites et Kurdes, d’Irak et de Syrie, seront effectivement contraints de faire leur choix entre ces deux coalitions, entre ces deux blocs, décision terrible à prendre puisqu’aucun de ces deux camps n’acceptera de concéder l’un à l’autre le moindre pouce de terrain.
Pire, très probablement : les deux axes choisiront d’organiser la déstabilisation de ces zones plutôt que d’y voir prospérer un foyer d’opposition.
La conséquence, à présent que l’État islamique a rebattu les cartes, ce sera vraisemblablement la continuation de la polarisation radicale du Moyen-Orient et, en arrière-plan, le risque de voir s’imposer dans les régions concernées le règne durable des milices et des seigneurs de guerre locaux, tour à tour instruments et profiteurs du grand jeu des puissances.