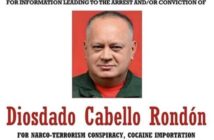Le wahhabisme saoudien n’a rien à envier à l’État islamique (EI) en matière de sauvagerie institutionnalisée. La religion d’État, qui détermine nombre d’aspects de la vie quotidienne, privée et publique, en Arabie Saoudite, ne s’exprime pas autrement que dans les territoires conquis par les djihadistes de l’EI.
Les médias ont d’emblée stigmatisé les atrocités commises par la justice de l’État islamique, les décapitations, les crucifixions, les flagellations publiques, de même que les destructions du patrimoine culturel des régions annexées, vestiges archéologiques millénaires et sites religieux chiites, dont nombre de mausolées de saints, objet de cultes récusés par l’Islam sunnite ; des médias qui ont fait mine de « découvrir » ces pratiques, comme s’il s’agissait de barbaries insolites dans le paysage du Moyen-Orient… Alors que, depuis fort longtemps, de pareils usages sont en vigueur en Arabie Saoudite, allié de toujours des États-Unis et à laquelle la France du président Hollande vient tout juste de vendre plusieurs dizaines de vedettes pour sa marine de guerre et presque autant d’avions de combat, qui ne serviront vraisemblablement pas à combattre l’État islamique mais plutôt la rébellion chiite qui, avec le soutien de l’Iran, s’est emparée de la capitale du Yémen voisin, Sanaa.
Ainsi en témoignent les mises à mort régulières qui émaillent la chronique judiciaire saoudienne (souvent à la suite de faits strictement religieux), les châtiments corporels cruels, le cortège macabre de pendaisons suivies de la crucifixion des corps, exposés à la curiosité de la population, mises en scène sadiques tout droit issues d’un autre âge, et les excès coutumiers de la police religieuse, qui veille à la stricte application de la Charia, la législation coranique, et ceux du fameux Comité pour la Promotion de la Vertu et la Prévention du Vice, l’un des plus puissants ministères du royaume.
En témoignent de même les destructions d’édifices religieux hérités du passé ; et même la tombe du Prophète Mohamed, sise dans la mosquée de Médine, pourrait faire les frais du rigorisme saoudien.
Principale communauté religieuse non-sunnite présente sur le territoire saoudien, les Chiites constituent la cible privilégiée du régime, plus encore que les Chrétiens dont les manifestations cultuelles sont totalement interdites.
Dernières exécutions en date, massives, celles d’une cinquantaine d’opposants à la monarchie absolue, principalement, quarante-sept personnes exactement, des opposants condamnés en même temps que quelques djihadistes du mouvement al-Qaeda, auteurs d’attentats sur le territoire du royaume, et eux-mêmes qualifiés de « terroristes » par le régime, qui a su prendre exemple sur la dialectique occidentale en la matière et en tirer le meilleur parti pour justifier la répression de la contestation.
On n’en aurait pas parlé dans les médias occidentaux, ni russes ou chinois (Moscou et Pékin profitant de la brouille qui couve entre Washington et Ryad pour se rapprocher des Saoud), pas plus que des 153 exécutions connues pour l’année 2015 dont on n’avait pas fait grand cas, si, cette fois-ci, une figure importante du Chiisme n’avait également été exécutée dans le lot, provoquant l’ire de la communauté chiite d’Arabie Saoudite et de virulentes réactions en Iran et dans les pays voisins, en Irak notamment, où les milices chiites combattent activement l’État islamique en partie soutenu par la population sunnite d’Irak et de Syrie, et au Bahreïn, où l’événement semble avoir relancé la contestation née à l’époque du « Printemps arabe » et sitôt écrasée par les chars saoudiens venus en renforts des forces de police bahreïnies.
Le cheikh chiite Nimr Bakr al-Nimr, un des leaders des Chiites saoudiens et de l’opposition à la monarchie absolue des Saoud, arrêté en 2012, a en effet été décapité début janvier 2016, après plusieurs années d’incarcération. Cette exécution, symbolique, apparaît comme une provocation envers l’Iran et un moyen pour le gouvernement saoudien de stigmatiser la communauté chiite du pays, considérée par la monarchie comme un auxiliaire de Téhéran à l’intérieur des frontières du royaume.
 La communauté chiite est ainsi régulièrement inquiétée par la police politique du régime saoudien ; et ses leaders en particulier. La famille du cheikh al-Nimr redoute elle-même l’exécution d’un autre de ses membres, le jeune Ali Mohamed, neveu du cheikh décapité.
La communauté chiite est ainsi régulièrement inquiétée par la police politique du régime saoudien ; et ses leaders en particulier. La famille du cheikh al-Nimr redoute elle-même l’exécution d’un autre de ses membres, le jeune Ali Mohamed, neveu du cheikh décapité.
Ali Mohamed al-Nimr avait été arrêté en 2011, dans la ville de Qatif, sur la côte est de la péninsule. Le garçon de 17 ans y participait à une manifestation organisée dans la foulée des mouvements du « Printemps arabe » pour réclamer la démocratie. Accusé de sédition (et du « crime » d’avoir aidé une organisation visant à la « démocratisation » du royaume –sic), il a été privé de contacts avec son avocat à plusieurs reprises et a avoué, sous la torture, avoir été en possession d’armes et, en sus, d’être l’auteur d’un vol à main armée. Ce pour quoi il a été condamné, en 2014, à être décapité, puis son corps, crucifié et exposé publiquement jusqu’à pourrissement, un verdict ratifié fin 2015 par le nouveau roi, Salmane.
Le jeune homme ayant bénéficié d’une campagne de soutien internationale, la sentence n’a pas encore été exécutée et Ali Mohamed demeure incarcéré. Toutefois, après les premières exécutions de 2016 et parce que les actes d’hostilité envers les Chiites se sont multipliés au fur et à mesure que les relations avec l’Iran se sont dégradées, la famille al-Nimr n’a que peu d’espoir de sauver Ali Mohamed, devenu l’emblème de la répression anti-chiite qui s’exerce en Arabie Saoudite, un emblème dont le gouvernement, qui ne peut plus reculer dans cette affaire, voudrait se débarrasser au plus vite. L’inquiétude de la famille est d’autant plus vive que l’exécution du jeune homme pourrait servir les intérêts du régime en participant à la campagne de provocations commencée à l’égard de l’Iran depuis quelques mois.
Par ailleurs, ce sont aussi les vestiges du passé qui sont visés par l’intransigeance wahhabite, y compris le patrimoine historique et archéologique de l’Islam.
 Une vive polémique avait ainsi mis en émoi le monde musulman, à l’annonce, en septembre 2014, du projet de réaménagement de la mosquée al-Nabawi de Médine, troisième lieu saint de l’Islam, qui prévoyait la destruction de la tombe du Prophète Mohamed, enseveli dans « sa » moquée au VIIème siècle. Le projet, qui ne faisait que reprendre une intention déjà exprimée en 2007, visait à mettre fin au culte dont la tombe fait l’objet, une pratique prohibée par l’Islam rigoriste et donc réprouvée par le Wahhabisme –au contraire du Chiisme, qui favorise la prière adressée aux saints et honore leurs mausolées. Le corps du Prophète devait être exhumé et ré-enterré secrètement et dans une tombe anonyme, dans un cimetière de Médine.
Une vive polémique avait ainsi mis en émoi le monde musulman, à l’annonce, en septembre 2014, du projet de réaménagement de la mosquée al-Nabawi de Médine, troisième lieu saint de l’Islam, qui prévoyait la destruction de la tombe du Prophète Mohamed, enseveli dans « sa » moquée au VIIème siècle. Le projet, qui ne faisait que reprendre une intention déjà exprimée en 2007, visait à mettre fin au culte dont la tombe fait l’objet, une pratique prohibée par l’Islam rigoriste et donc réprouvée par le Wahhabisme –au contraire du Chiisme, qui favorise la prière adressée aux saints et honore leurs mausolées. Le corps du Prophète devait être exhumé et ré-enterré secrètement et dans une tombe anonyme, dans un cimetière de Médine.
L’annonce de ce projet a cependant provoqué un tel tollé dans tout le monde musulman, y compris dans les communautés sunnites, que les autorités saoudiennes ont été contraintes, avec empressement, d’en nier la véracité et de démentir toute intention à ce sujet, et ce en dépit de nombreux documents déjà rendus publics qui attestaient, entre autres, de l’existence de plans architecturaux visant à déplacer la tombe.
Il semble que, depuis lors, le projet ait été sinon annulé, à tout le moins gelé.
N’empêche, si les reliques du Prophète sont jusqu’à nouvel ordre sauvées de la destruction, nombre d’édifices religieux et de vestiges islamiques antiques ont été réduits en poussières depuis l’avènement de la monarchie saoudienne ; une catastrophe archéologique, sur ce territoire qui a vu naître l’Islam et où se trouvent ses traces les plus anciennes.
95% des quartiers anciens de La Mecque et de Médine ont été rasés dans la seconde moitié du XXème siècle, laissant place aux immenses gratte-ciels de la ville moderne, au détriment d’un patrimoine archéologique et culturel irremplaçable ; et, dans ce cadre, plusieurs sites religieux ont été détruits, comme, par exemple, la tombe du père du Prophète : pour éviter qu’on lui rende un culte, le corps a été arraché du cimetière al-Baqi de Médine, dans les années 1970.
Ce fut le cas également, dès le début du XIXème siècle, lorsque les guerriers du clan Saoud s’emparèrent de Médine, en 1806, d’autres tombes, qui abritaient les dépouilles de plusieurs des compagnons du Prophète. À cette époque déjà, les Wahhabites avaient envisagé la destruction de la tombe du Prophète Mohamed, mais ils en furent empêchés par le Sultan de l’Empire turc ottoman qui envoya une armée pour protéger les lieux saints et, en 1818, fit reconstruire les monuments déjà démolis. Mais les destructions reprendront dans les années 1920, lorsque Abdelaziz ben Abderrahmane al-Saoud, le fondateur du royaume saoudien actuel, s’emparera de La Mecque pour se proclamer roi peu après ; elles s’intensifieront particulièrement à partir des années 1990, après la promulgation d’une fatwa du grand mufti du royaume incitant à faire disparaître les tombes des saints, mais aussi les bâtiments de l’époque du Prophète, qui constituaient selon lui des lieux de pèlerinage et d’idolâtrie et conduisaient les fidèles à l’hérésie.
Il est parfois difficile d’obtenir des informations précises concernant ces destructions et le détail exact du désastre archéologique est encore inconnu, mais, selon l’Institute for Gulf Affairs, plus d’un demi-millier de sites ont été détruits sur base de cette fatwa, dont, parmi les plus prestigieux, « la Maison du Prophète », à La Mecque, un bâtiment daté de la fin du VIème siècle, et la maison où il vécut ensuite à Médine ; la maison dite « de Khadija », la première épouse du Prophète ; Dar al-Arqam, la première école islamique, où le Prophète aurait lui-même enseigné ; la mosquée qui abritait la tombe d’Hamza, « le Lion d’Allah », oncle de Mohamed, célèbre vainqueur de la bataille de Badr, en 624, et décédé l’année suivante à la toute aussi célèbre bataille de Uhud, contre les Mecquois ; la mosquée de Fatima, fille du Prophète ; le premier cimetière musulman de La Mecque, Jannat al-Mualla ; le mausolée d’Amina, la mère du Prophète… Des pans entiers de l’Islam des origines à jamais perdus pour l’histoire de l’art et l’archéologie.
Tout un ensemble de similitudes et de correspondances religieuses et idéologiques qui ne trompent pas sur les apports étroits et originels qui associent intrinsèquement le Wahhabisme saoudien et le salafisme intransigeant qui anime les djihadistes de l’État islamique.
Ce qui s’explique, peut-être, par les relations politiques et les contacts directs qu’entretiennent la maison royale saoudienne et le leadership de l’État islamique, dont le financement qui a accompagné la naissance du mouvement djihadiste, pourvu par des princes arabes et de richissimes hommes d’affaires issus des États monarchiques du Golfe, d’Arabie Saoudite et des royaumes vassaux ; et ce qui explique, probablement, pourquoi Riyad n’a montré que de la mauvaise volonté à participer à la Coalition internationale mobilisée par Washington et Londres pour arrêter la progression de l’État islamique et son expansion sur l’Irak du Chiite Nouri al-Maliki et la Syrie de Bachar al-Assad, allié de l’Iran.
Les préoccupations saoudiennes sont parfaitement lisibles : la priorité du roi Salmane, c’est bien l’endiguement de l’influence de l’Iran chiite qui s’étend en péninsule arabique. D’où les financements alloués aux factions djihadistes, sunnites, pour affaiblir le baathisme syrien et le gouvernement irakien, très majoritairement chiite depuis le renversement de Saddam Hussein, en 2003, lequel s’appuyait sur la minorité sunnite ; après que les États-Unis ont décidé, à l’inverse, de s’appuyer sur la majorité chiite et d’expulser de l’armée irakienne les anciens officiers baathistes, issus pour la plupart de la communauté sunnite du pays (amorçant par le fait la division de l’Irak et la fracture aujourd’hui consommée).
La haine des Chiites, plus que partagée par l’Arabie Saoudite et l’État islamique, l’anti-chiisme viscéral de ces deux puissances locales, cimente solidement la cohésion des intentions de l’une et de l’autre.
Le fait est, aussi, que les États-Unis ont commencé à prendre leurs distances par rapport à l’Arabie saoudite. Le Pacte du Quincy (du nom de ce bateau de guerre américain sur lequel, en 1945, le tout fraîchement couronné roi Abdelaziz ben Abderrahmane al-Saoud signa avec le président Franklin Roosevelt un accord assurant au premier la protection de son trône par la première puissance mondiale et, au second, un approvisionnement en pétrole régulier) se fissure aujourd’hui ; les États-Unis sont presque autonomes sur le plan énergétique et n’ont plus besoin de cet allié ambigu qui alimente le terrorisme islamiste. D’autant moins que le changement de majorité en Iran et l’arrivée au pouvoir de dirigeants plus « pragmatiques » ont permis un rapprochement entre Washington et Téhéran ; Hassan Rohani a mis en sourdine les grosses caisses idéologiques de la révolution de 1979 et réussit peu à peu à faire oublier la dureté doctrinale de son prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad. La partie n’est pas encore tout à fait gagnée face aux héritiers de Khomeiny, mais la Maison blanche fait internationalement des pieds et des mains pour y aider…
Les Saoudiens ont bien compris qu’ils pèsent beaucoup moins, désormais, dans les intérêts états-uniens ; ils l’avaient déjà soupçonné en 2013, lorsqu’ils avaient soutenu de tout leur appareil diplomatique, avec même d’indécents relents jubilatoires, une intervention militaire en Syrie, contre le régime au pouvoir à Damas, accusé d’avoir bombardé des quartiers rebelles de la capitale avec des armes chimiques, l’occasion d’abattre al-Assad qui avait ainsi franchi « la ligne rouge » décrétée par Washington. Quel ne fut pas le désenchantement des Saoudiens, lorsque Barack Obama se rétracta et évacua d’un revers de la main les velléités d’invasion annoncées mais jamais assumées…
C’est encore que, face à la montée en puissance de l’Iran, le royaume n’a plus les moyens de sa politique régionale : la guerre des prix du pétrole lancée par Riyad pour faire chuter les cours et ruiner les exploitants de « pétrole de schiste », très coûteux à l’extraction, a, dans le même temps, privé le royaume saoudien de son principal levier, les pétrodollars, et ce à un moment critique où l’Arabie Saoudite a pris la décision, d’une part, d’acheter l’Égypte en finançant l’économie moribonde du maréchal al-Sissi et, d’autre part, d’augmenter sensiblement ses investissements dans l’armement pour se préparer à une escalade militaire avec l’Iran.
Jusqu’à présent peu efficace, cette guerre d’usure dans laquelle les Saoudiens ont réussi à entraîner l’OPEP depuis novembre 2014 n’est pas encore achevée et, aussi radicale que hasardeuse, génère des retombées sociopolitiques à très hauts risques qui menacent aussi la stabilité intérieure de l’État saoudien, qui, dans son propre espace non plus, ne saurait continuer à garantir par l’argent la relative absence de revendications sociales qui prévalait naguère. Contrairement à l’image souvent donnée et admise de la société saoudienne, la population comprend des classes appauvries, qui réclament une amélioration de leurs conditions de vie et une part du pouvoir politique, par le biais d’une représentation parlementaire…
C’est dès lors une maison royale saoudienne aux abois qui se débat, dorénavant, sur la vaste scène du Monde arabe.
Plus qu’une proximité religieuse et idéologique, donc, et même si la créature islamiste nourrie par les Saoudiens pourrait aujourd’hui exiger la soumission au Calife Ibrahim des maisons royales d’Arabie, au risque pour ces dernières de perdre leurs trônes (et peut-être même, à termes, la tête), ce sont des réalités politiques, militaires et économiques, face en particulier à un ennemi commun, l’Iran et les communautés chiites de la péninsule qui en sont les relais politiques et militants, qui lient les destins du royaume et du Califat et affermissent davantage encore l’accord tacite unissant depuis le début Riyad et ar-Raqqa [ndlr : ar-Raqqa, dans le nord-est de la Syrie, est la capitale de l’EI], tous deux à la poursuite d’un même objectif immédiat…
Certes, la Turquie a montré son intérêt pour l’État islamique, le soutient militairement, logistiquement, principalement contre les forces kurdes de Syrie, et participe très activement au commerce du pétrole provenant des zones contrôlées par les djihadistes en Syrie et en Irak et qu’Ankara achète à bas prix et revend ensuite sur le marché international. Mais il s’agit d’une alliance de circonstances très temporaire, et l’AKP d’Erdogan ne nourrit aucune affection d’ordre idéologique analogue au djihadisme de l’EI.
Aussi -et sans aucun doute-, parmi la quarantaine d’États dénoncés (à tort ou à raison) par le président russe Vladimir Poutine comme supporteurs des djihadistes en Syrie, l’Arabie Saoudite est, de très loin et objectivement, le meilleur allié de l’État islamique.