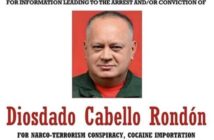Après la victoire d’El Alamein, qui a marqué le début d’un retournement de fortune durant la deuxième guerre mondiale, Winston Churchill a déclaré : « Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning. »
La même phrase pourrait être prononcée aujourd’hui au sujet du conflit syrien, dans un contexte aux relents de guerre froide : la quasi-élimination de l’État islamique, qui avait l’avantage de réunir tout le monde contre lui, a ouvert une nouvelle phase de la guerre ; ce sont désormais la Russie et les États-Unis qui s’opposent, mais aussi l’Iran et l’Arabie saoudite, empêchant qu’il y ait la paix en Syrie. La Syrie leur sert de terrain de jeu, chacun essayant de s’imposer au Moyen-Orient.
* * *
L’imbroglio international, l’entêtement américain
Le régime syrien et ses alliés sont déterminés à reconquérir les derniers bastions tenus par les jihadistes. Les Turcs ne peuvent tolérer la présence du PYD kurde à leur frontière. Moscou laisse Ankara attaquer les Kurdes pour les obliger à demander protection à la Russie via le régime syrien et à rompre leur alliance avec les États-Unis. L’éventualité d’une intervention israélienne qui multiplie les menaces contre la présence de l’Iran et du Hezbollah en Syrie n’est pas à écarter. Quant aux États-Unis, ils n’entendent pas s’effacer en Syrie, ni lâcher les Kurdes après les avoir utilisés comme supplétifs.
Ce qui semble le prouver, c’est l’annonce de la création d’une force frontalière de 30.000 hommes sous commandement américain, composée des forces (soi-disant démocratiques) syriennes (FDS) majoritairement kurdes.
Dévoilant la stratégie des États-Unis, le secrétaire d’État Rex Tillerson a justifié, le 18 janvier 2018, le maintien de la présence américaine en Syrie par la nécessité « d’empêcher une renaissance de l’État islamique, de s’assurer que la résolution de ce conflit ne permette pas à l’Iran de se rapprocher de son grand objectif, le contrôle de la région, et d’aboutir au départ de Bachar el Assad. » « Une Syrie stable, unie et indépendante, nécessite, in fine, un leadership post-Assad pour voir le jour », a-t-il insisté.
Miser sur le PYD pour faire pression contre le régime, l’Iran et Moscou, semble toutefois être un pari bien hasardeux, surtout que Washington ne se donne pas les moyens de sa politique ; et que le contrôle par les Kurdes appuyés par les Américains de villes comme Raqqa et Mambij suscite le vif ressentiment de leurs habitants arabes.
La Syrie, un bourbier pour Moscou et Téhéran
Comme s’ils n’avaient pas assez d’ennemis en Syrie, les Américains se sont mis à dos la Turquie.
Ankara et Damas ont bien entendu réagi avec virulence à l’annonce américaine.
L’initiative de Washington montre, comme il fallait s’y attendre, que la lutte d’influence se poursuit entre les protagonistes du conflit. De toute façon le chapitre des affrontements militaires est loin d’être clos. L’attaque en janvier 2018 de la base aérienne russe de Hmeimim et de la base navale de Tartous par une dizaine de drones armés, suppose une technologie sophistiquée qui implique un parrainage puissant.
Et plusieurs offensives menées respectivement par le régime et la Turquie ont débuté. Le régime a tenté sans succès de reprendre pied dans la partie riche en pétrole de la province de Deir ez-Zor située à l’est de l’Euphrate et tenue par les alliés kurde des Américains s’attirant une riposte dévastatrices de ces deniers. « Les États-Unis veulent garder la Syrie faible et pauvre », explique le professeur Joshua Landis. Selon lui, « ils occupent le nord-est de la Syrie pour l’empêcher d’accéder à son pétrole. Ils veulent que la Syrie devienne un bourbier pour la Russie et l’Iran. »
Victoires syriennes et turques
L’armée syrienne appuyée par ses alliés russe et iranien a lancé une offensive sur la province d’Idlib, la dernière encore aux mains des jihadistes, où se sont repliés ceux d’entre eux qui ont été chassés de leurs autres enclaves. Puis, en février 2018, elle a entrepris de déloger les rebelles de la Ghouta orientale. Au prix de bombardements meurtriers faisant des centaines de victimes parmi les civils, le régime est parvenu à rependre le contrôle de cette zone qui constituait une menace intolérable sur Damas.
Quant à Ankara, sa réplique à l’initiative américaine ne s’est pas fait attendre. Des combattants de l’Armée syrienne libre (ASL), bénéficiant d’un fort soutien de l’armée turque ont délogé le PYD du « canton » kurde d’Afrine avec l’assentiment tacite des Russes qui ont quitté la ville dès le début de l’offensive turque (opération « Rameau d’Olivier »).
Après en avoir pris le contrôle, la Turquie menace de pousser son offensive jusqu’à la rive occidentale de l’Euphrate. Toute la région frontalière devrait servir de zone d’accueil des réfugiés syriens installés en Turquie qui seraient placés sous sa protection. D’après Fabrice Balanche, spécialiste des pays du Levant à la Hoover institution de l’Université de Stanford, cette éventualité pourrait pousser les Kurdes à se tourner vers la Russie et l’Iran pour être protégés d’Ankara, dès lors que les Américains refusent de les soutenir.
2018 ne sera pas l’année de la paix en Syrie
Enfin, en février 2018, au cours d’un raid contre des objectifs iraniens en Syrie, un chasseur israélien F16 a été abattu par la défense aérienne syrienne ; signe évident que la guerre en Syrie est loin d’être terminée et que chacun de ses acteurs cherche à marquer son territoire. C’est l’opinion de Fabrice Balanche, pour qui l’année 2018 ne sera pas celle de la paix en Syrie et la solution ne sera pas politique mais militaire : « Les Occidentaux ne veulent pas s’avouer qu’ils ont perdu la guerre. Ils prolongent le conflit pour montrer aux Russes qu’ils n’ont pas abandonné le terrain. Ils crient au désastre humanitaire à l’ONU, mais quelque part, ils en sont aussi responsables. Toutes les personnes connaissent l’issue du conflit.»
Même si une division de jure de la Syrie est désormais exclue, et si la souveraineté du pouvoir central s’exercera nominalement sur tout le pays, il sera probablement de facto partagé en trois zones d’influence russo-iranienne, américaine et turque.
La majeure partie du territoire et de la population sera sous influence russo-iranienne. La Turquie exerce déjà son influence sur la province d’Idlib et le canton d’Afrine. Et elle veut l’étendre à la région bordant sa frontière allant d’Afrine à la rive ouest de l’Euphrate, après en avoir délogé les forces kurdes. Ces-dernières sont cependant appuyées par 2.000 hommes de troupes américains présents à Manbij, ce qui ne peut que créer des frictions supplémentaires entre Ankara et Washington ; à moins que les deux partenaires au sein de l’OTAN ne s’entendent sur le dos des Kurdes.
Il est cependant hors de question que les États-Unis renoncent à une présence militaire en Syrie qui pourrait toutefois se cantonner à la région située à l’est de l’Euphrate.
La prise de contrôle d’Afrine par les Turcs et l’éventualité d’un deal américano-turc pourraient ruiner les rêves d’autogouvernement kurdes, comme ils l’ont été en Irak. Les pays rivaux qui abritent des minorités kurdes sont en effet tous d’accord sur une chose : pas question d’entamer leur intégrité territoriale au profit des Kurdes.
Bashar et le Baath restent au pouvoir à Damas
Dans le contexte du rapport de forces qui lui est favorable, grâce au soutien russe et iranien, le régime est appelé à conserver le pouvoir et n’est pas prêt à faire des concessions à même de déboucher sur une solution politique.
Si une telle solution devait néanmoins finir par se concrétiser, des représentants de l’opposition « modérée » seraient supposés faire partie du gouvernement installé à Damas, à condition bien sûr qu’ils renoncent à réclamer le départ du président Assad.
L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a affirmé que l’opposition syrienne devait accepter qu’elle n’avait « pas gagné la guerre », tout en demandant au gouvernement de ne pas crier victoire.
Au cas où le régime consentirait malgré tout à donner son accord pour former un gouvernement incluant des représentants de l’opposition, celui-ci devrait en principe s’atteler à élaborer un projet de nouvelle constitution. Assad est naturellement en faveur du maintien d’un pouvoir central fort, alors que les formules qui ont le plus de chance de remporter l’adhésion des autres parties sont une large décentralisation administrative, voire un régime fédéral. Mais dans tous les cas de figure, il est illusoire de penser que cela puisse conduire à l’instauration de la démocratie.
Tant que Bachar el-Assad se maintiendra au pouvoir, ce qui est quasi-certain dans un avenir prévisible, le régime syrien ne sera pas reconnu par l’Occident et les monarchies pétrolières. Et ils n’accepteront pas de financer la reconstruction de la Syrie sans un changement assurant une transition politique effective. La Chine, qui en a les moyens, en profitera t’elle pour y prendre pied ?
* * *
Une autre question est celle des conséquences démographiques de la guerre au vu des déplacements de populations de grande ampleur prenant parfois le caractère d’épurations ethnico-confessionnelle.
Se pose aussi problème du sort des sept millions de réfugiés à l’extérieur du pays. Il est à craindre que la majorité d’entre eux ne voudra ou ne pourra pas regagner leurs foyers de sitôt, non seulement du fait de leur destruction et de l’énormité du coût de la reconstruction du pays mais du fait de la réticence probable du régime à les accueillir dans les régions dont ils ont été chassés.
Le régime a en effet tout intérêt à une diminution du poids démographique de la population sunnite, majoritairement hostile à son pouvoir.
Ce problème affecte non seulement la Syrie, mais aussi les pays voisins, surtout le Liban qui accueille plus d’un million et demi de réfugiés sur son sol dont la présence fait peser une menace existentielle sur son équilibre confessionnel.