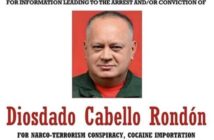On se souviendra du refus initial d’Ankara de laisser la force aérienne états-unienne utiliser la base militaire turque d’Incirlik (où les appareils de l’OTAN sont pourtant présents depuis des années déjà) pour frapper l’État islamique. Il avait ainsi fallu que le président Obama tirât lui-même l’oreille de son homologue turc pour aboutir, in fine, à une timide autorisation. Un événement et de vives tensions au sein de l’alliance atlantique qui avaient insinué le doute sur les intentions de la Turquie à l’égard de l’État islamique…
Mais, pour l’observateur accoutumé au théâtre syrien et physiquement présent sur le terrain des opérations, le doute n’existe pas : factuellement, la Turquie supporte financièrement et militairement l’État islamique.
Les actions qui l’attestent sont nombreuses, souvent accomplies aux yeux de tous et de fait connues de tout le monde.
 Au printemps dernier, j’ai accompagné les milices chrétiennes de Syrie (MFS), qui se battent aux côtés des forces kurdes, le YPG, sur le front face à l’État islamique. Durant la bataille, qui se déroulait sur la Khabour, petit affluent de l’Euphrate, barrière naturelle derrière laquelle les miliciens s’étaient retranchés pour arrêter la progression des islamistes, j’ai pu constater comment, sans ambiguïté, la Turquie appuyait les forces djihadistes…
Au printemps dernier, j’ai accompagné les milices chrétiennes de Syrie (MFS), qui se battent aux côtés des forces kurdes, le YPG, sur le front face à l’État islamique. Durant la bataille, qui se déroulait sur la Khabour, petit affluent de l’Euphrate, barrière naturelle derrière laquelle les miliciens s’étaient retranchés pour arrêter la progression des islamistes, j’ai pu constater comment, sans ambiguïté, la Turquie appuyait les forces djihadistes…
Le débit de la rivière Khabour est en effet contrôlé, en amont, par les barrages qui se trouvent en Turquie. Or, alors même que les pluies du printemps et la fonte des neiges faisaient monter le niveau des lacs de retenue obligeant la Turquie à effectuer des lâchés d’eau, le débit de la Khabour s’est progressivement ralenti quelques jours avant les dernières attaques de l’État islamique (EI), facilitant la traversée de la rivière par les combattants islamistes. Le même phénomène avait déjà été observé par les combattants du MFS lorsque eurent lieu les premières attaques importantes de l’EI sur la Khabour, en février 2015 : le niveau de la Khabour s’était abaissé dans les jours qui avaient précédé l’attaque.
Par contre, les eaux ont remonté, ensuite, dans les heures qui avaient suivi la contre-offensive conjointe du MFS et du YPG, piégeant ainsi leurs combattants sur la rive sud en leur coupant toute retraite…
Des faits très concrets qui, non seulement, attestent du soutien apporté à l’EI par Ankara, mais, plus encore, de l’existence nécessaire, pour coordonner ce type d’opérations, de contacts directs et réguliers entre les états-majors de l’EI et de l’armée turque.
Par ailleurs, j’ai pu constater, fréquemment, le trafic d’hydrocarbures auquel s’adonnent, en parfaite connivence, les autorités turques et celles de l’État islamique. Régulièrement présent à Erbil, au Kurdistan irakien, je me suis rendu à plusieurs reprises sur les lignes de front, tenues par les Peshmergas, les combattants kurdes d’Irak. La scène est pour ainsi dire surréaliste…
 Alors que les Peshmergas affrontent les djihadistes dans des assauts féroces où les pertes humaines se multiplient, on voit cependant des colonnes de dizaines de camions-citernes franchir la frontière, sans être nullement inquiétés. Le trafic a lieu dans les deux sens : les camions, lourds de leur cargaison, le pare-chocs arrière encore tout ruisselant du pétrole qui a débordé de la citerne emplie à ras bord, se suivent à la queue leu-leu sur des kilomètres.
Alors que les Peshmergas affrontent les djihadistes dans des assauts féroces où les pertes humaines se multiplient, on voit cependant des colonnes de dizaines de camions-citernes franchir la frontière, sans être nullement inquiétés. Le trafic a lieu dans les deux sens : les camions, lourds de leur cargaison, le pare-chocs arrière encore tout ruisselant du pétrole qui a débordé de la citerne emplie à ras bord, se suivent à la queue leu-leu sur des kilomètres.
Ils traversent ainsi le Kurdistan irakien oriental, avec la bénédiction du clan Barzani et la complicité des miliciens du PDK ; le chef du Parti démocratique du Kurdistan, président du gouvernement autonome du Kurdistan irakien, Massoud Barzani, directement lié à Ankara et soutenu par le président turc Recep Tayyip Erdogan, facilite en effet ce trafic hautement profitable à son allié ottoman (bien entendu, quelques potentats du PDK ne manquent pas de prélever une petite rétribution au passage, pour services rendus… la corruption, au Kurdistan, est proverbiale…). Ce qui explique pourquoi le clan Barzani a toujours plaidé pour l’autonomie du Kurdistan irakien, mais sans expansion de ses frontières aux régions kurdes de Syrie et, moins encore, à celles de Turquie.
Tout cela au grand dam des partisans de l’UPK (l’Union patriotique du Kurdistan), l’autre grande formation politique kurde d’Irak, quant à elle directement liée à Téhéran, qui soutient le PKK (le Parti des Travailleurs du Kurdistan) et les velléité indépendantistes des Kurdes de Turquie (qui réclament aujourd’hui, plus modestement, une autonomie régionale) ; l’UPK soutient aussi l’antenne syrienne du PKK, le YPG, sévèrement combattu par la Turquie qui, précisément, joue la carte de l’EI pour éviter la formation, tout le long de sa frontière méridionale, d’un Kurdistan autonome qui pourrait appuyer les activistes kurdes de Turquie et leur servir de base arrière.
Un imbroglio typique du Moyen-Orient, qui, en l’occurrence, permet à « Daesh » de tirer magnifiquement son épingle du jeu sur le plan militaire et économique.
On peut ainsi suivre ces files de camions qui, après quelques kilomètres parcourus au Kurdistan, passent la frontière turque et disparaissent de l’autre côté, sans plus d’entraves qu’ils n’en ont rencontrées pour franchir la frontière séparant l’EI et le Kurdistan.
Le manège est identique dans le sens inverse ; mais les camions qui entrent au Kurdistan en provenance de Turquie circulent bien évidemment à vide. Léger sur leurs amortisseurs et rapides, ils filent allègrement vers les puits de pétrole de l’État islamique…
Cette masse pétrolière est écoulée sur le marché international, par des hommes d’affaires turcs associé au régime d’Erdogan, sous l’étiquette « made in Kurdistan ». Un trafic bien connu de la coalition internationale menée par les États-Unis : certaines prises de vue aériennes ont permis de comptabiliser plus de 11.000 camions-citernes en mouvement dans la même journée ( !). Le ministère des Affaires étrangères russe avance quant à lui le chiffre de près de 200.000 barils de brut transportés depuis l’EI à destination de la Turquie. Une affaire en or pour les oligarques turcs, qui achètent ce pétrole très en-deçà du prix du marché et le revendent avec d’énormes bénéfices. Une opportunité stratégique sine qua non pour la survie militaire de l’EI, qui, selon les estimations du département du Trésor états-unien, en retire un bénéfice quotidien pouvant atteindre 3,5 millions de dollars, de quoi assurer son ravitaillement en armes et en fournitures logistiques de toutes sortes (sans plus devoir nullement dépendre des « dons » de ses anciens bailleurs de fonds, les monarchies du Golfe).
Mais le rôle de la Turquie dans l’assistance qu’elle apporte à l’EI ne s’arrête pas à ce type de soutiens plus ou moins passifs… Ankara vend également des cargaisons d’armes aux djihadistes, voire leur apporte un appui militaire direct.
Ce fut le cas, ces deux dernières semaines de février 2016, lorsque, depuis les frontières de Turquie, l’artillerie turque a ouvertement pilonné, des jours durant, les positions du YPG qui, dans le gouvernorat d’Alep, progressait au détriment de l’EI (une politique tout en « subtilité », puisque, au même moment, ailleurs le long de cette même frontière, les forces turques bombardaient des positions de l’EI, favorisant de ce côté-là l’avancée des brigades des Turkmènes de Syrie, un autre allié d’Ankara en Syrie, mais probablement jugé plus fiable que l’EI sur le long terme).
À diverses reprises, des fuites et maladresses ont mis en évidence les activités clandestines du gouvernement turc en faveur de l’EI et des djihadistes de Jabhet al-Nosra, la branche syrienne d’al-Qaeda. Le ministère de l’Intérieur et les services secrets turcs sont ainsi convaincus d’organiser des convois d’armes réguliers à destinations des formations djihadistes en Syrie, qui passent la frontière sous couvert d’aide humanitaire.
Pour avoir divulgué les preuves, filmées, de l’implication du gouverneur de la province turque de Hatay (Antakya), frontalière avec le gouvernorat d’Alep, et du ministère de l’Intérieur dans la livraison d’armes à Jabhet al-Nosra, le journaliste Erdem Gül et Can Dündar, le rédacteur en chef du quotidien turc Cumhuriyet, ont été arrêtés et mis au secret, en novembre 2015, pour « espionnage » et violation du secret d’État (ils ont été relâchés ce 26 février, après une campagne populaire et un verdict de la Cour constitutionnelle rendu en faveur de la liberté de la presse). Comble du comble, alors qu’il dénonçaient le soutien du gouvernement turc à al-Qaeda, les deux journalistes avaient aussi été inculpés par les autorités turques de « participation à un mouvement terroriste ».
Cumhuriyet a établi les preuves de ce que, en un seul convoi, Ankara avait envoyé des centaines de milliers de cartouches et des milliers d’obus d’artillerie aux milices djihadistes.
Une politique de l’instant, presque convulsionnaire de la part d’Erdogan, aléatoire, qui a ruiné les excellentes relations, diplomatiques et économiques, que la Turquie avait nouées avec la Russie. Un revirement que la destruction d’un avion de combat russe, à la frontière syrienne, par la chasse turque, le 24 novembre 2015, est venue consommer comme un coup de tonnerre, alors que d’aucuns envisageaient la possibilité de voir Ankara renoncer à l’OTAN pour renforcer sa coopération avec le Pacte de Shanghai et profiter des sanctions économiques engagées contre le Russie par l’Union européenne, dans le contexte de la crise ukrainienne, pour accroître le développement de ses exportations vers l’est.
Il n’en sera rien ; dans l’immédiat du moins, la lune de miel qui semblait bercer l’alliance turco-russe a pris fin dans la précipitation de la politique hasardeuse d’Ankara : la question kurde, obsessionnelle pour l’AKP, a pris le dessus sur les réalités géostratégiques et économiques (alors que, pourtant, les Kurdes de Turquie ne réclament plus désormais leur indépendance, mais une simple autonomie de type fédérale ; rappelons en outre que c’est le président Erdogan qui, en juillet 2015, a unilatéralement rompu les négociations de paix avec le PKK, qui progressaient depuis fin 2012, et provoqué dès lors la récente reprise des hostilités).
Et la Turquie s’en trouve désormais d’autant plus isolée que, de leur côté, ses alliés atlantiques lui ont clairement signifié, fin février 2016, qu’elle ne pourrait pas compter sur leur aide en cas de conflit ouvert avec la Russie.
Mais jusqu’à quel point la Turquie pourra-t-elle jouer cette carte de l’État islamique et, réciproquement, quelle attitude, sur le long terme, ar-Raqqa [ndlr : la capitale de l’EI] adoptera-t-elle envers Ankara, sa plus proche voisine ?
C’est une question dont la réponse dépend d’une autre question, jamais réellement investiguée : qui sont exactement les leaders de l’État islamique ? Au-delà de la propagande distillée par l’EI dans ses vidéos grandiloquentes et sur les multiples réseaux sociaux qu’il exploite avec grande dextérité, au-delà également de l’idée que s’en sont forgée –on ne sait trop comment ni toujours bien pourquoi- médias de masse et chancelleries, qui sont les décideurs ?
Quelles sont leurs intentions, religieuses, politiques ? Quelles sont leurs convictions véritables ? Comment, de baathistes convaincus, certains se sont-ils métamorphosés en fous de Dieu ? Le sont-il devenus en réalité ?
Islamistes ou manipulateurs ? Opportunistes ? Et pour quel dessein, dès lors ?