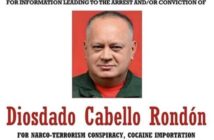Comment expliquer la visite du ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim al-Jaafari, ce 5 novembre, à Ankara, alors que le gouvernement de l’ex-premier ministre al-Maliki fustigeait sans mettre de gants la politique ambiguë de son voisin turc ? C’est que, malgré un violent retour de flammes dû à sa politique pro-Frères musulmans au Moyen-Orient -à l’heure où ces derniers sont partout en reflux- et en dépit de la désastreuse image pro-terroristes que donne Ankara depuis quelques mois, la Turquie conserve envers et contre tout une position dominante dans la région, et particulièrement en Irak…
La politique d’Erdogan en Irak : du nationaliste turc au « grand jeu » néo-ottoman
Jusqu’à la montée en puissance d’une nouvelle doctrine stratégique turque dans les années 2000, portée par l’AKP (le parti islamiste « modéré » au pouvoir, dirigé par le tout récent président de la Turquie, l’ancien premier ministre Recep Tayyip Erdogan) et incarnée par l’ancien ministre des affaires étrangères Ahmet Davutoglu, l’actuel premier ministre, la politique turque en Irak est longtemps restée modeste, arc-boutée sur des fondamentaux idéologiques tirés de l’héritage historique de l’Empire ottoman et de la doctrine isolationniste kémaliste.
Pour des raisons de sécurité intérieure, cette politique fut conditionnée par le prisme de la question kurde : face à la porosité de la frontière, les interventions turques au Kurdistan furent surtout militaires ; elles cimentaient l’entente Ankara-Bagdad, depuis le traité de Saadabad de 1937, qui fut suivi par une série d’accords qui conféraient à la Turquie le droit d’intervenir dans le nord de l’Irak. En 2008 encore, l’armée turque bombardait le mont Qandil, fief du PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan, qui revendique l’indépendance des Kurdistans irakien et turc).
Quant à l’ingérence turque dans la politique irakienne, elle s’est longtemps limitée à une protection des minorités turkmènes, concentrées autour de la vallée du Tigre, entre Mossoul et Kirkouk. L’influence d’Ankara s’est toujours faite sentir dans ces deux villes, où elle entretenait des partis locaux et cultivait des relations étroites avec le clan des al-Nujaifi, qui gérait le gouvernorat de Ninive.
En revanche, la nouvelle politique étrangère turque, souvent qualifiée de « néo-ottomane », s’est affirmée par une diplomatie volontariste dans l’ancienne sphère d’influence de l’Empire ottoman au Moyen-Orient ; elle s’est appuyée sur la popularité du président Erdogan auprès des populations sunnites, ce dernier étant perçu comme le leader islamiste qui a su développer son pays avec succès, contrastant avec l’immobilisme des régimes arabes. La doctrine de cette politique dirigée vers les pays sunnites se fondait sur l’anti-occidentalisme, qui s’est manifesté de manière évidente face à l’ancien allié israélien et à la coalition américaine en Irak.
Dès 2005, la Turquie accueillait une réunion des partis sunnites irakiens. La visite d’Erdogan à Bagdad, en 2008, la première visite d’un chef de gouvernement turc depuis plus de deux décennies, fut la démonstration de ce volontarisme régional : à l’époque où les Américains s’apprêtaient à élire Obama qui promettait le retrait des troupes d’Irak, les Turcs, quant à eux, imposaient leur modèle et leur présence dans la région.
Lorsque les « révolutions » arabes ont commencé, ce « néo-ottomanisme » s’est logiquement incarné dans le soutien aux Frères musulmans, ces partis-frères appelés à prendre le pouvoir en Égypte, en Tunisie et en Syrie. Un choix qui a rapidement conduit Ankara à se heurter au bloc chiite, dont al-Maliki constituait la pièce maîtresse du fait de son implication dans le transit d’armes vers la Syrie, en soutien au régime de Bashar al-Assad.
Le refus initial de la Turquie de condamner l’État islamique après la prise de Mossoul, réfutant son statut de « groupe terroriste » et préférant dénoncer al-Maliki et les complots occidentaux, n’est donc pas fortuit.
Cette solidarité sunnite et cette dénonciation des « Lawrence d’Arabie » occidentaux fut aussi le produit, en interne, d’un long combat idéologique porté par l’AKP et soutenu par son électorat conservateur.
Ce « Kulturkampf » était déjà perceptible au travers du célèbre feuilleton télévisé Kurtlar Vadisi (La vallée des loups), qui a passionné les téléspectateurs turcs -mais aussi le Monde arabe- dans les années 2000 : cette superproduction mettait en scène un James Bond turc éradiquant la mafia de Turquie… Ses deux adaptations pour le cinéma (Kutlar Vadisi : Palestine et Kutlar Vadisi : Iraq)illustrent de manière exceptionnelle la vision turque du Moyen-Orient qui s’est forgée à cette époque.
Avant l’épisode palestinien de 2010, en effet, qui mettait en images la vengeance turque contre Israël après l’attaque du navire Mavi Marmara par les commandos israéliens et l’assassinat de neuf citoyens turcs, le film sur l’Irak mettait en scène le héros turc se portant au secours des résistants sunnites opposés à des malfrats « américano-sionistes » voleurs d’organes, épaulés par des Kurdes serviles et stupides.
Ce navet de compétition, qui fut tout de même le film le plus vu en Turquie en 2006 et la production turque la plus coûteuse de tous les temps, mérite toutefois d’être visionné pour ce qu’il permet de saisir de l’image que la Turquie essaie de donner d’elle-même.
La politique de la Turquie sur sa frontière sud : une logique de domination économique
Durant les années 2000, l’incarnation d’une politique de « zéro problème avec les voisins » vis-à-vis de la Syrie et de l’Irak avait surtout pris la forme d’un processus de vassalisation économique, dont le symbole était la polarisation de l’économie alépine (Alep – capitale économique de la Syrie), tournée vers la Turquie.
Si le conflit en Syrie a bouleversé cette intégration régionale, l’évolution politique de l’Irak l’a accentué : l’Irak est devenu le second débouché à l’exportation pour la Turquie ; et pas moins de 85% des produits consommés au Kurdistan irakien transitent par le poste frontière turc d’Ibrahim Khalil. In Irak, plus de mille entreprises turques ont investi tous les secteurs, employant quelque 40.000 nationaux pour un investissement total supérieur à 15 milliards de dollars.
La crise institutionnelle qui a déchiré le gouvernement régional kurde et Bagdad, conduisant le premier à accentuer son emprise sur les ressources pétrolières sous son contrôle (région de Kirkouk) pour sécuriser ses sources de revenus, a évidemment bénéficié à la Turquie : pays par lequel transite l’oléoduc kurde et elle-même acheteuse d’une partie de la production pétrolière du Kurdistan, la Turquie diversifie ainsi ses approvisionnements face à ses deux fournisseurs traditionnels, l’Iran et le Caucase. Et, depuis juin 2014, la prise de contrôle de la région pétrolifère de Kirkouk par les forces kurdes, à la faveur de l’expansion de l’EI en Irak, a permis au gouvernement autonome du Kurdistan d’augmenter de 60% la production d’hydrocarbures en 6 mois seulement, jusqu’à 500.000 barils par jour, et avec un objectif de court terme d’un million de barils par jour.
Cette alliance pragmatique de la Turquie avec le PDK (Parti démocratique du Kurdistan), contrôlé par le clan du président kurde Barzani, était aussi un moyen d’affaiblir l’influence iranienne au Kurdistan irakien, en renforçant le PDK face à l’UPK (Union patriotique du Kurdistan, parti rival du PDK), qui entretient des relations étroites avec Téhéran, mais aussi face au PKK, allié de l’UPK.
Mais, tout en favorisant la politique sécessionniste kurde en Irak, la Turquie s’est bien gardée de couper les ponts avec Bagdad. Pour le moment, les revenus du pétrole kurde vendu via le port de Ceyhan sont ainsi transférés sur un compte dans une banque turque, Halk Bank, et Ankara se propose de gérer le partage de ces revenus entre l’État irakien et la région autonome kurde, en cas d’accord entre les deux parties. Cette porte ouverte à Bagdad permet à la Turquie de maintenir la pression sur le gouvernement Barzani, tout en indiquant au gouvernement de Bagdad que la Turquie n’est pas son ennemi, mais plus acceptablement un « parrain », avec lequel il faudra compter à l’avenir.
La politique régionale de l’eau est un autre instrument de pression clé d’Ankara dans la région.
Véritable château d’eau du nord-Moyen-Orient, contrôlant le débit du Tigre et de l’Euphrate par son système de barrages, la Turquie à récemment montré sa capacité à exercer une pression sur les factions qui dépendent de l’économie agricole et industrielle de la Djézireh : depuis mai 2014, le débit de l’Euphrate aurait baissé de plus de moitié, mettant en péril la sécurité hydrique de plusieurs villes majeures de la région, comme Alep et ar-Raqqa en Syrie, et Ramadi, Kerbala et Nadjaf en Irak…
La politique turque, creuset involontaire de l’union sacrée kurde
Il n’est plus question à présent de nier la politique turque vis-à-vis de l’état islamique, qui fut de favoriser sa montée en puissance le long de sa frontière pour affaiblir les régions autonomes kurdes de Syrie.
Le siège actuel de Kobanê, un des fiefs du PYD, très lié au PKK, en est une tragique illustration : dans cette enclave, l’objectif d’Ankara était d’écraser les forces du PYD, prises entre « le marteau » djihadiste et « l’enclume » que constitue la frontière turque ; le but était aussi d’obliger les cadres du PYD encerclé à Kobanê à se réfugier sur le territoire turc, où la police les attendait.
Mais l’habile campagne mondiale de communication des leaders kurdes a fait de Kobanê une sorte de nouveau Stalingrad, symbole de la résistance à l’EI. Elle a contraint les Américains à empêcher la chute de cet objectif pourtant stratégiquement très secondaire et à exercer une pression sur le gouvernement turc, afin de permettre le passage d’unités de combattants kurdes d’Irak, envoyés à l’aide de leurs « frères » de Syrie.
Ainsi, le plus grand échec de cette politique « disruptive » mise en œuvre par la Turquie dans la région fut de provoquer le rapprochement –fût-il temporaire et très précaire- des deux puissances kurdes concurrentes, à savoir le PKK et le gouvernement régional du Kurdistan d’Irak (GRK), dominé par le PDK du clan Barzani.
Rappelons que ces deux organisations ont une longue histoire d’affrontements, qui ont connu leur paroxysme dans les années 1990, une rivalité entretenue par la Turquie : le spectaculaire rapprochement d’Ankara et du GRK, à partir de 2008, avait accentué cette division, si bien que, en 2013, le président du GRK, Massoud Barzani, s’était même autorisé une visite à Diyarbakir, la plus grande ville Kurde de Turquie, pour soutenir le plan de paix d’Erdogan. Au grand dam du PKK, qui, tout en jouant le jeu de la pacification et en poursuivant le retrait de Turquie de ses partisans armés, avait bien appréhendé, à l’époque déjà, la volonté turque de réduire le fief kurde autonome en Syrie. Aussi, les tentatives du PDK de s’implanter dans les fiefs kurdes de Syrie en soutenant et fédérant une organisation satellite, le KNK (Congrès national kurde), furent immédiatement mises en échec par le PYD de Salih Muslim, au prix d’une violence épuration politique.
On se souviendra enfin de l’échec retentissant de la très attendue conférence pan-kurde d’Erbil, en 2013 toujours, qui devait réunir toutes les organisations kurdes afin de poser les fondations d’une structure commune. Mais l’incapacité du PKK et du PDK à s’entendre, couplée aux tensions politiques internes au GRK en période d’élections (entre le PDK et l’UPK), avaient conduit à l’annulation de l’évènement.
Cette situation a partiellement changé depuis l’offensive de l’État islamique sur la région de Sinjar, en août dernier : se sentant directement menacé, le gouvernement autonome du Kurdistan irakien a fait appel en urgence au PKK, à l’Iran et à la Turquie. Les deux premiers qui ont répondu présent, le PKK en acheminant des contingents venus de Syrie et d’Iran, Téhéran en promouvant l’aviation irakienne et en dépêchant des cargos entiers d’armes et d’équipement.
Ankara aurait finalement envoyé des armes, mais plus de deux semaines plus tard, et clandestinement.
Un pacte, signé le 22 octobre à Dohuk, a formalisé l’octroi d’une aide du GRK au Kurdistan syrien, mais en échange d’une promesse de partage du pouvoir politique, au Kurdistan Syrien, entre le PYD et les partis pro-Barzani. Et, pour la première fois, l’inaction de la Turquie a été publiquement critiquée par des journaux proches de l’autorité kurde.
Malgré sa réputation ternie, la Turquie reste un interlocuteur indispensable
Il faut toutefois relativiser la portée de l’alliance de circonstances qui a rapproché le PDK et le PKK : les intérêts politiques divergents de ces deux organisations devraient limiter, à terme, le développement de cette « union sacrée » ; l’existence même de cette alliance, bien que soutenue par les populations kurdes au Moyen-Orient et dans la diaspora, pourrait ne pas survivre longtemps à l’évolution de la donne militaire dans la région face à l’État islamique en recul.
Certes, la sensibilité antioccidentale de la rhétorique d’Erdogan a trouvé ses limites ces dernières années : malgré l’affirmation de la Turquie comme puissance économique, les capitaux occidentaux restent indispensables pour la stabilité d’une économie structurellement déséquilibrée. Malgré les appels du pied envers la Chine ou le Golfe, Ankara a encore besoin de l’Occident.
Mais le rôle pivot de la Turquie, arbitre incontournable de la survie politique de l’Irak, seule puissance régionale capable d’affronter l’État islamique au sol et clé de voûte de la géopolitique de l’énergie en Méditerranée orientale constituent autant de garanties pour le président Erdogan de demeurer un interlocuteur indispensable dans la région, malgré les « barbouzeries » de ces dernières années.
Ravalant leurs frustrations, Américains, Irakiens, Kurdes, Iraniens et Russes n’auront donc pas le choix : il faudra, pour longtemps encore, ménager Ankara et ses rêves de restaurer l’antique gloire ottomane…