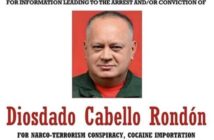La compréhension de la tragédie qui frappe aujourd’hui le Yémen ne peut faire l’économie d’une mise en perspective historique.
Nous nous proposons de fournir ici quelques points de repère qui devraient permettre d’éclairer certaines des prémices de la crise actuelle, qui tournent souvent autour d’une question à la formulation aussi simple qu’à la solution difficile : la mise en place d’un « nationbuilding » au Yémen.
* * *
L’histoire du Yémen est en effet marquée par une série de morcellements et d’antagonismes, sur les plans géographique, historique, politique, social et confessionnel (Mermier 1999).
Si l’on veut comprendre la situation présente, il faut l’envisager dans toutes ses dimensions, en tenant compte aussi bien des dynamiques internes que des interventions extérieures. Nous nous limiterons ici à quelques remarques, sans prétention à l’exhaustivité.
Géographie
D’un point de vue géographique (cfr. Obermeyer 1982, La formation de l’imamat et de l’État au Yémen », La Péninsule arabique aujourd’hui), on peut diviser le Yémen en plusieurs régions, dont l’une, le haut Yémen (ou Yémen du Nord), correspond à l’aire géographique où se trouvent les zaydites.
Elle englobe le haut plateau partant de Najran, dans l’actuelle Arabie saoudite, au nord, et descendant jusqu’à Jebel Sumara, au nord de la ville de Ibb.
Elle est dominée par de hauts sommets, le plus élevé (3668 m), le Jabal al-nabī Shu‘ayb (« la montagne du prophète Shu‘ayb »), étant le point culminant de la péninsule arabique. Le relief est marqué par de profondes gorges (des wādī-s) et des plaines semi-arides, notamment autour de San‘ā et Dhamār.
Malgré des précipitations limitées (375 mm/an) et les risques de sécheresse, l’agriculture a pu se développer, grâce au système bien connu des terrasses. Cette région, malgré ces handicaps, a toujours joué un rôle substantiel dans l’histoire économique du Yémen – productrice de café pour l’exportation, de céréales et d’ovins pour le marché local. Aujourd’hui, c’est cependant la production de qāt (plante dont les feuilles sont mastiquées pour leur effet euphorisant) qui est devenue le pilier principal de l’économie yéménite (30% du PIB dans les années 1980), avec tous les problèmes que cela implique en termes de production (30% des terres arables lui sont consacrées, près de la moitié des ressources hydriques du pays, et 70% des pesticides) et de consommation.
Cette région du Yémen inclut les centres majeurs et historiques du zaydisme, à Ṣa‘da (où débute l’insurrection houthiste en 2004), San‘ā (la capitale) et Dhamār. C’est là que vivent les tribus qui ont fourni aux imams zaydites les forces militaires qui leur ont permis d’exercer le pouvoir et de mener des campagnes contre les envahisseurs extérieurs ou les autres régions du Yémen.
D’un point de vue anthropologique et social, cette partie du Yémen reste très marquée par sa structure tribale, avec pour corollaire, comme le remarque Manfred Kropp (1994 – The Realm of Evil: the Struggle of Ottomans and Zaydis in the 16th-17th Centuries as Reflected in Historiography, Yemen – Past and Present), « une relation presque érotique aux armes » – l’idée que l’un des succès majeurs de l’État moderne est sa capacité à s’arroger le monopole de la violence légitime et à désarmer les civils a peu de chances d’y être prise au sérieux… Notons que si à peu près la moitié de la population y est zaydite, l’autre moitié y est sunnite chaféite [ndlr : le chaféisme est l’une des quatre écoles du sunnisme].
Au sud de Sumara, le relief change, et nous entrons dans le Yémen du Sud.
Cette région forme la transition entre les hauts plateaux désertiques du nord et la plaine côtière au sud. Elle inclut les villes de Ibb, Dhū Jiblā et Ta‘izz. Les précipitations sont plus abondantes, ce qui permet une agriculture plus riche et plus variée. C’est là que se sont installées des dynasties sunnites comme les Rasoulides (1229-1454) et les Tahirides (1454-1526). Les habitants sont pour la plupart des sunnites de rite chaféite.
On peut enfin mentionner brièvement quatre autres régions.
À l’ouest du pays se trouve la plaine désertique de la Tihāma, qui borde la mer Rouge. La grande majorité de la population est chaféite, et les principales ressources de la région sont la pêche, la culture du coton et celle du tabac.
Entre cette plaine et le plateau central se trouve la zone constituée par les montagnes occidentales : on y rencontre de nombreux villages et une agriculture en terrasse (céréales, café, qāt). Culturellement, cette région est comparable à celle du plateau central.
Il en va de même de la région située à l’est du plateau central, celle qui ouvre sur le désert du Rub‘ al-Khālī. Cette région extrêmement aride a très peu de ressources, et ses habitants sont parmi les plus pauvres et les plus défavorisés du Yémen.
Enfin, à l’est du pays, se trouve la région désertique de l’Ḥadramawt.
Religion
La quasi-totalité des Yéménites est de confession musulmane.
L’Arabie du sud connaît certes une importante communauté juive depuis l’Antiquité, mais celle-ci a fortement décliné aux XIXème et XXème siècles, et la quasi-totalité des juifs du Yémen a émigré en Israël en 1949 (il doit rester aujourd’hui moins de 300 juifs dans l’ensemble du Yémen). Les baha’is seraient au nombre de 150. Il y a quatre églises chrétiennes à Aden, essentiellement à l’usage des étrangers.
Du point de vue des appartenances confessionnelles, la principale ligne de fracture est donc intra-musulmane. Si l’on excepte une communauté ismaélienne très active (15.000 personnes), et quelques sunnites hanafites, la division principale est censée passer entre zaydites chiites et sunnites chaféites. Elle recouvre en partie, mais pas complètement, la frontière politique et géographique entre le Yémen du nord et le Yémen du sud, puisque les zaydites sont absents du sud, alors qu’au nord les chaféites constituent la moitié de la population.
On considère souvent que le zaydisme est une branche du chiisme, ce qui n’est pas faux (les zaydites jugent en effet que ‘Alī était le successeur légitime de Muḥammad). Néanmoins, le zaydisme diffère substantiellement des autres branches du chiisme (duodécimain et ismaélien). Quelques mots sur son histoire ne sont donc pas superflus.
Les zaydites se réclament de Zayd ibn ‘Alī (d’où leur nom), petit-fils d’al-Ḥusayn (mort en 680), fils du quatrième Imam des chiites duodécimains, ‘Alī Zayn al-‘Ābidīn (mort en 713-714), et demi-frère du cinquième Imam, Muḥammad al-Bāqir (mort en 743). Zayd fut exécuté à Koufa, en 740, après un soulèvement manqué contre le calife omeyyade Hishām.
La différence centrale entre le zaydisme et les autres branches du chiisme concerne la théorie de l’imamat. Les zaydites s’accordent avec les autres chiites pour reconnaître le droit de ‘Alī à l’imamat, en raison de son adhésion précoce à l’islam et de sa prééminence parmi les musulmans, ainsi que celui de ses fils al-Ḥasan et al-Ḥusayn, désignés Imams par la volonté divine.
En revanche, après eux, le droit à l’imamat ne se transmet pas par une désignation divine, et il n’est pas limité à la branche ḥusaynide de la famille des Alides (comme c’est le cas chez les ismaéliens et les duodécimains). En principe, tous les membres de la « Sainte Famille » (celle des descendants de ‘Alī) ont vocation à l’imamat. Le véritable imam est celui qui possède les qualités requises (piété, courage, générosité, sens de la justice, ascétisme, connaissance des sciences de la religion, etc.) et qui s’affirme les armes à la main. C’est la notion de « surgissement » (khurūj), autrement dit, de rébellion armée.
Cette théorie de l’imamat a d’intéressantes conséquences. Elle implique la possibilité, au moins théorique, d’une pluralité d’imams, et disqualifie la branche ḥusaynide des Alides, dont l’attitude quiétiste est assimilée, du point de vue zaydite, à de l’inaction.
Par ailleurs, les zaydites n’attribuent pas de qualité suprahumaine aux imams, qui ne sont pas impeccables. Ils ne croient pas non plus en l’occultation (ghayba) de l’Imam, et ne sont pas dans l’attente du Mahdi [ndlr : l’envoyé de Dieu qui rétablira le Califat, l’État islamique].
Même si l’Imam possède l’autorité suprême, il ne bénéficie pas du statut central (et surhumain) de l’Imam, que l’on trouve dans le chiisme duodécimain et l’ismaélisme classique, faisant de ces dernières religions des « imamologies » (ou des « imamolâtries », selon leurs contempteurs). Notons que la théorie de « surgissement » n’a pas été systématiquement appliquée au cours de l’histoire, l’imamat, notamment aux XIX et XXème siècles, se transmettant simplement souvent de père en fils.
Les différences théoriques entre zaydisme et sunnisme se sont largement atténuées au fil des siècles, l’influence du mu‘tazilisme, décisive sur le zaydisme des origines, s’estompant peu à peu, pour faire place à une « sunnisation » du zaydisme (cfr. Cook 2000, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought; et Bonnefoy 2010, La nation yéménite : entre fondements historiques anciens et remises en cause continues, La question nationale), par exemple avec Ibn al-Wazīr (mort en 1436), qui critique les collections de ḥadīths zaydites et préfère les collections sunnites, Muḥammad al-Shawkānī (1759-1839), qui milite pour un retour aux sources de l’islam (Coran et ḥadīths) d’une manière qui ne serait pas désavouée par les salafistes, jusqu’à l’abandon formel, par différents juristes zaydites, au début des années 1990, de la doctrine de l’imamat.
Surtout, comme nous le verrons, une politique de convergence religieuse entre zaydisme et sunnisme chaféite a été mise en place. Néanmoins, les identités confessionnelles peuvent facilement être réactivées – et elles le sont, puisqu’on assiste depuis quelques années à un réveil zaydite (cfr. Haykel 1995, A Zaydi Revival?, Yemen Update 36 ; et King 2012, Zaydī Revival in a hostile republic : Competing identities, loyalties and visions of state in Republican Yemen, Arabica 59).
Histoire et politique
La ligne de fracture entre le nord et le sud n’est pas que géographique, sociale et confessionnelle ; elle est aussi politique et historique.
Le nord n’a pas connu la colonisation. Il a subi une occupation ottomane limitée, entre 1538 et 1635, puis entre 1872 et 1918 (avec une autonomie de fait dès 1911, avalisée par le Traité de Da‘‘ān), mais à l’exception de ces périodes, l’imamat zaydite a toujours pu contrôler au moins une partie du Yémen, entre 897, date de la fondation du premier imamat par Yaḥya ben al-Ḥusayn (mort en 911), et 1962, date de la révolution républicaine (depuis lors, les zaydites n’ont plus d’imam).
Le régime zaydite qui succède à la seconde occupation ottomane pouvait revendiquer une certaine légitimité nationaliste, dans le contexte de l’après-première guerre mondiale et du démantèlement de l’empire ottoman. Mais l’imamat théocratique zaydite va adopter une politique isolationniste et antimoderniste (Bonnefoy 2010) –la pauvreté et l’analphabétisme y sont plus importants que dans le reste du monde arabe, les méthodes d’enseignement archaïques, etc.–, et conserver une structure sociale figée, de type tributaire.
Le système politique et social est en effet clivant et inégalitaire : l’imamat s’appuie sur la puissance des tribus (leur ‘aṣabiyya, leur « esprit du corps », pour reprendre une notion rendue célèbre par Ibn Khaldūn), mais seul un sayyid (un descendant de Muḥammad) peut être roi.
Un juge (qaḍī) ou un lettré, dont les compétences sont particulièrement précieuses en matière de droit, d’enseignement et d’administration, ne peut accéder au pouvoir, puisqu’il ne peut être imam.
Enfin, toute la population non zaydite est aussi exclue du pouvoir.
À cela s’ajoute la perte du prestige du pouvoir zaydite : s’il avait pu, dans les années 1920, étendre son influence, notamment dans la Tihāma, il subit, dès les années 1930, de sérieux revers militaires, au nord contre les partisans des Sa‘ūd, au sud contre les Britanniques. On comprend donc que les élites modernistes, aussi bien zaydites que chaféites, aient été particulièrement insatisfaites, même si les réformateurs ne parviendront pas vraiment à fédérer une résistance populaire.
La situation politique du Yémen du Nord fut loin d’être calme et pacifique. En 1948, Yaḥyā Muḥammad Ḥamīdal-Dīn, qui était l’Imam zaydite depuis 1904 et le monarque du royaume mutawakkilite du Yémen depuis 1926, fut assassiné lors d’un coup d’État, qui se conclut toutefois par un échec, le pouvoir revenant finalement à son fils Aḥmad ben Yaḥyā Ḥamīdal-Dīn. Lui-même dut faire face à un coup d’État en 1955, puis fut paralysé suite à une tentative d’assassinat en mars 1962, avant de mourir le 18 septembre 1962. Son fils Muḥammad al-Badr (1926-1996) ne lui succéda pas longtemps : le 26 septembre 1962, les révolutionnaires, menés par ‘Abdullāh al-Salāl (1917-1994) et soutenus militairement par l’Égypte de Nasser, renversent la monarchie, mettant fin à un millénaire d’État zaydite, et fondent la République arabe du Yémen.
S’ensuit une guerre de huit ans entre forces royalistes, soutenues par l’Arabie saoudite et le Royaume-Uni, et les forces républicaines, soutenues par l’Égypte et l’URSS. Cette guerre prend fin le 1er décembre 1970, quand l’Arabie saoudite et les pays occidentaux reconnaissent le gouvernement républicain.
L’histoire qui suivra – celle de la République arabe du Yémen – ne sera pas non plus sans soubresauts : ses deux premiers présidents devront s’exiler (‘Abdullāh al-Salāl, 1962-67, et ‘Abd al-Raḥmān al-Iryānī, 1967-74), et les deux suivants seront assassinés (Ibrāhīm al-Ḥamdī, 1974-77, et Aḥmad al-Ghashmī, 1977-78).
Le sud connaît quant à lui une trajectoire différente (Tuchscherer 1982, La formation d’un État : la République démocratique et populaire du Yémen (1839-1981), La Péninsule arabique aujourd’hui), liée à Aden et à son hinterland, contrôlé par les Britanniques à partir de 1839. La modernisation du port, la création de nouveaux quartiers et la mise en place d’un nouveau système administratif conduisent à un changement rapide des modes de vie, mais qui est limité essentiellement à l’enclave d’Aden (le reste du Yémen du sud, constitué d’émirats ou sultanats sous tutelle britannique, conserve des structures sociales prémodernes).
Située à un emplacement stratégique, entre la Mer rouge et l’Océan indien (autrement dit, sur la route des Indes, que les Britanniques entendent contrôler), Aden est une ville cosmopolite, ouverte sur l’extérieur, bien différente en cela des cités et des villages des hauts plateaux.
Au moment de la révolution de 1962, le Yémen du sud est divisé en trois entités : la colonie britannique d’Aden, comprenant Aden et ses environs, la Fédération d’Arabie du Sud et le Protectorat d’Arabie du Sud.
À partir de 1963, deux groupes mènent une guérilla contre l’occupant britannique : le Front de Libération de l’Occupation du Yémen du Sud et le Front de Libération nationale du Yémen. En 1967, après le départ des Britanniques, la République populaire du Yémen du Sud est fondée, rassemblant Aden et des provinces du Sud (qui constituent en fait plutôt le sud et l’est du pays), avec le FLN à sa tête. En 1969, la branche marxiste du FLN prend le pouvoir et, en 1970, elle modifie le nom du pays, qui devient la République démocratique populaire du Yémen, soutenue par l’URSS. Ce sera le seul régime marxiste du monde arabe, et il mènera une politique radicale, mais clivante, de modernisation, mais aussi de déculturation, combattant les élites traditionnelles, tribales ou religieuses (sultans, cheikhs, ou marchands).
Les échecs économiques de l’expérience socialiste, les luttes internes du pouvoir (comme durant la guerre civile de 1986, où l’on a pu constater que réseaux et solidarités de type tribal continuaient à fonctionner), l’écho très limité de l’idéologie marxiste dans la population, et la fin du bloc communiste, affaiblissent le Yémen du sud et conduisent à l’unification du Yémen en 1990.
Le Yémen, comme État unifié, n’existe donc que depuis 1990 (et certainement pas depuis le XVIIème siècle, comme cela est parfois affirmé –cfr. l’excellente mise au point de Klarić 2008, Le Yémen au XVIIe siècle : territoire et identités, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 121-122).
Encore faut-il rappeler qu’un système transitoire a initialement été mis en place (le président du nord, ‘Alī ‘Abdallāh Ṣāliḥ, président du Yémen du Nord de 1978 à 1990, devient président du Yémen unifié, alors que ‘Alī Sālim al-Bayḍ, secrétaire général du Parti socialiste du Yémen du Sud, devient vice-président), avec l’existence de deux armées distinctes. Mais une guerre civile éclate en 1994 et voit la victoire des troupes du nord, qui entrent dans Aden le 7 juillet 1994.
Convergence et instrumentalisation des identités confessionnelles
La nécessité de dépasser fragmentations et clivages est apparue très tôt et est devenue un objectif pour plusieurs acteurs politiques (parfois avec des intentions différentes) au cours des dernières décennies. Or la recherche d’une unité yéménite qui transcende les identités confessionnelles ne va pas sans ambiguïtés, ni sans conséquences contre-productives.
Pour faire simple, on peut rappeler que le Mouvement des Libres, qui fut l’initiateur d’un processus de modernisation au Yémen, avait à sa tête un zaydite, Muḥammad Maḥmūd al-Zubayrī (1910-1965), et un chaféite, Aḥmad Muḥammad Nu‘mān (1909-1996). L’une des idées fondamentales du Mouvement était séduisante : face à deux systèmes politiques clivants (au nord, l’imamat théocratique zaydite, et le système colonial dans un premier temps, puis le système marxiste dans un second, au sud), il convenait de proposer une idéologie et un gouvernement marqués par le nationalisme arabe, mais représentant l’ensemble de la population, en allant au-delà du clivage entre zaydites et chaféites. Les choses n’ont toutefois pas été aussi simples, pour de nombreuses raisons. On peut en signaler plusieurs.
Premièrement, la question religieuse n’est qu’une question parmi d’autres (cfr. al-Saqqaf 1993, Problèmes de l’unité yéménite, Revue du monde musulman et de la Méditerranée 67). Poids des tribus, violence, corruption, pauvreté, système partisan verrouillé, inégalité entre le nord et le sud (le nord tentant souvent d’imposer ses vues au sud), place de la femme (question dans laquelle le facteur religieux intervient, mais sans qu’il y ait de différence entre droits zaydite et chaféite ; ainsi, la Loi n°20 de 1992 sur le statut personnel généralise au Sud, qui prohibait la polygamie, propose une interprétation très rétrograde du droit de la famille, proche du droit saoudien) – ce sont là plusieurs des facteurs qui rendent particulièrement difficile l’intégration harmonieuse de toutes les composantes du paysage social et politique yéménite.
Plus généralement, la transformation des mentalités et des cadres sociaux qui reproduisent les clivages (sociaux, régionaux, confessionnels) en vigueur et empêchent la modernisation et la mise en place d’un État démocratique et d’une identité nationale est un processus nécessaire et de longue haleine, comme l’avait bien vu Nu‘mān lui-même – processus qui implique notamment une profonde réforme du système éducatif.
Il faut toutefois noter qu’il y a malgré tout l’émergence d’une forme d’identité nationale, ou d’aspiration à l’identité nationale, yéménite (cfr. Wedeen 2008, Peripheral Visions. Publics, Power and Performance in Yemen) – identité qui se construit en partie par la négative, notamment vis-à-vis de l’Arabie saoudite, considérée comme riche et inféodée aux États-Unis. Cette identité reste toutefois fragile, et toujours susceptible d’être durement ébranlée par des identités de substitution (cfr. Bonnefoy : 2010). La mise en place d’un État fédéral serait une possible solution, mais un tel projet reste très virtuel dans les circonstances actuelles…
Deuxièmement, le Yémen a été aussi le théâtre – et la victime – de diverses interventions extérieures.
L’Égypte de Nasser, en soutenant militairement la révolution de 1962, a certes permis au mouvement républicain de prendre le pouvoir, mais elle a dans le même temps mis hors-jeu nombre de cadres yéménites du Mouvement des Libres. Cela a vraisemblablement privé le mouvement républicain du capital humain endogène pour mener à bien le mouvement de modernisation et de construction de l’identité nationale.
L’Arabie saoudite a quant à elle soutenu la monarchie mutawakkilite, avec à la clé une guerre de huit ans.
En d’autres termes, la dynamique qui permet la révolution de 1962, et encore plus celle qui la suit, contient des aspects exogènes qui ont grandement compliqué, et aggravé, la situation. Nu‘mān lui-même regrettait la rhétorique des républicains contre les élites zaydites, qui revenait pour lui à une « inversion de la stigmatisation ».
Troisièmement, le processus de convergence entre zaydisme et chaféisme a engendré des effets pervers. En un certain sens, ce processus a été un succès – mais il faut rappeler qu’il était déjà largement entamé avant la révolution de 1962 (cfr. Mermier 1999 – Yémen : les héritages d’une histoire morcelée, Le Yémen contemporain). De nombreux zaydites ont abandonné les aspects de leur doctrine les moins compatibles avec le sunnisme, comme l’essentiel de la théorie de l’imamat. Les différences qui subsistent dans la pratique religieuse quotidienne (et qui ont surtout trait à la position lors de la prière, et à l’appel à la prière) n’ont pas de grandes conséquences, et la polarisation zaydisme/chaféisme est clairement en déclin (Bonnefoy 2008, Les identités religieuses contemporaines au Yémen : convergence, résistances et instrumentalisations, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée 121-122).
Ainsi, depuis 1970, les mariages mixtes entre zaydites et chaféites sont en hausse (vom Bruck 2010, Regimes of Piety Revisited: Zaydī Political Moralities in Republican Yemen, Die Welt des Islams 50).
Néanmoins, ce processus a eu un coût. Il a consisté, en grande partie, à transcender les oppositions entre écoles juridiques (en l’occurrence, entre le madhhab zaydite et le madhhab chaféite) pour mettre l’accent sur la loyauté envers l’État et l’idéologie étatique.
On a donc privilégié, dans l’enseignement (par exemple les manuels scolaires), des références qui n’étaient ni zaydites ni spécifiquement chaféites, comme les recueils de Bukhārī et Muslim, ou les ouvrages d’Ibn Kathīr. Les besoins d’un personnel enseignant suffisamment nombreux dans le Yémen postrévolutionnaire ont par ailleurs conduit à recruter des enseignants étrangers, souvent égyptiens, syriens ou soudanais, et marqués par l’idéologie des Frères musulmans. Par ailleurs, l’Arabie saoudite a financé un système d’enseignement parallèle – des « Instituts scientifiques » (ma‘āhid ‘ilmiyya), accueillant près de 600.000 élèves au moment (2001-02) où ils furent réintégrés dans le système scolaire public (Bonnefoy 2008).
Tout cela a évidemment conduit à mettre l’accent sur un islam sunnite décontextualisé, et substantiellement marqué par la vision salafiste-wahhabite. En d’autres termes, comme le note Bonnefoy, reprenant la formule de Mermier, on voit à l’œuvre le paradigme de « la Tradition contre les traditions », à savoir un retour à la sunna, la « tradition prophétique », au détriment des diverses traditions locales et culturelles yéménites (selon un schéma très répandu dans l’histoire du monde musulman contemporain).
Une telle stratégie est tout à fait dans la lignée de celle élaborée par al-Shawkānī en son temps (cf. vom Bruck ; et Haykel 1993, Al-Shawkānī and the JurisprudentialUnity of Yemen, Revue du monde musulman et de la Méditerranée 67), mais elle aboutit évidemment à renforcer un courant salafiste-wahhabite qui n’est nullement enclin à tolérer la diversité religieuse et les coutumes locales qu’il considère comme non islamiques.
Le rôle d’un entrepreneur religieux comme Muqbil al-Wādi‘ī (mort en 2001) est à cet égard exemplaire : après avoir étudié à l’Université islamique de Médine, il crée un centre d’enseignement islamique dans le village de Dammāj, au sud de Ṣa‘da (un bastion historique du zaydisme), et se lance dans des attaques virulentes contre le zaydisme (cfr. Dorlian 2008, Les reformulations identitaires du zaydisme dans leur contexte socio-politique contemporain », Chroniques yéménites 15 ; et vom Bruck 2010). Le développement du salafisme est clairement un facteur décisif dans la résurgence du zaydisme, alors même que la polarité avec le chaféisme avait, pour les zaydites, perdu une bonne part de son importance.
Les attaques de Muqbilal-Wādi‘ī suscitent ainsi les réactions et la réponse d’un important savant zaydite du Yémen, Ḥusayn Badr al-Dīn al-Ḥūthī (né en 1956 et tué en 2004 par les forces armées yéménites qui tentaient de le capturer). La réaction ne se situe pas que sur le plan intellectuel, notamment à cause des nombreux incidents entre salafistes et zaydites dans les mosquées de la région de Ṣa‘da, la fermeture de librairies, la nomination par le pouvoir d’imams salafistes dans des mosquées zaydites, ou une réécriture anti-zaydite de l’histoire dans la presse (Dorlian 2008) – dans un contexte économique par ailleurs difficile. Les années 1990 voient donc la création du Ḥizb al-Ḥaqq (« Parti de la vérité », ou « Parti du droit ») puis, émanant de ce parti, un forum de réflexion nommé Al-Shabābal-mu’min, « La Jeunesse croyante », qui entend justement participer au renouveau de la pensée et de l’identité zaydites, mais se séparera du Ḥizb al-Ḥaqq en 1997.
Or la Jeunesse croyante connaîtra une scission interne en 1999, et la partie la plus radicale suivra Ḥusayn Badr al-Dīn al-Ḥūthī qui, notamment après le 11 septembre 2001, puis l’invasion américaine en Irak en 2003, adoptera un discours de plus en plus opposé aux États-Unis.
Ce faisant, il entrera en conflit direct avec le pouvoir de ‘Alī ‘Abdallāh Ṣāliḥ, qui s’était activement rangé aux côtés des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme : al-Ḥūthī et ses partisans, non sans raison, craignaient que le président yéménite utilise les moyens alloués par les États-Unis pour consolider son pouvoir et freiner la contestation…
* * *
Au départ, le conflit au Yémen n’est pas spécifiquement religieux – la réaction aux attaques salafistes suscite certes une forme de « cristallisation » de l’identité zaydite, mais la responsabilité essentielle est à chercher dans le pouvoir lui-même, qui stigmatise l’identité zaydite et s’appuie sur les salafistes pour tenter d’asseoir son pouvoir et de contrer l’influence des élites zaydites (alors même qu’Alī ‘Abdallāh Ṣāliḥ est issu de la même tribu zaydite).
Le conflit est surtout interne : les partisans d’al-Ḥūthī se sentent marginalisés et demandent davantage d’autonomie.
Nulle volonté d’un affrontement confessionnel contre les sunnites chaféites, et nulle mainmise directe de l’Iran à ce stade de l’insurrection – même si le mouvement houthiste reprendra ensuite les codes du Hezbollah, et même si, par ailleurs, il n’aura aucune difficulté, quand les circonstances s’y prêteront, à passer du statut de « plutôt opprimé » à celui de « plutôt oppresseur » (cfr. Dorlian 2015, Les partisans d’al-Hûthi au Yémen : de plutôt opprimés à plutôt oppresseurs, dans Polarisations politiques et confessionnelles. La place de l’islam dans les « transitions » arabe).
A partir de 2009, l’intervention de l’Arabie saoudite, qui craint l’émergence d’un mouvement pro-chiite à ses frontières, donnera à ce conflit une dimension régionale, et encore plus tragique. On le constate aujourd’hui, huit années plus tard.