All the confusion and bloodletting in the Middle East, including the apparition of the Islamic state, has increased in the wake of America’s Iraq fiasco. This has seriously weakened the hopes of governmental arrangements and understandings for regional peace and security. Interview with Peter Dale Scott, former Canadian diplomat, spokesman of the pacifist movement during the Vietnam War and professor emeritus at the University of Berkeley where he created the Peace and Conflict program, specialist of US’s foreign policy.
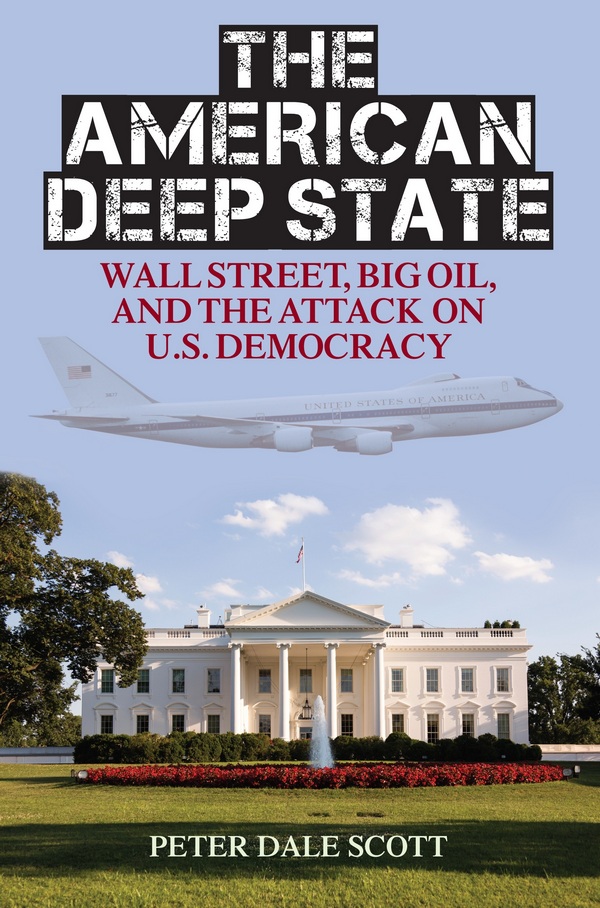 The Maghreb and Orient Courier – Your latest book is called The American Deep State. What does this term means?
The Maghreb and Orient Courier – Your latest book is called The American Deep State. What does this term means?
Peter Dale SCOTT – There have for a long time been two prevailing and different political cultures in America, underlying political differences in the American public, and even dividing different sectors of the American government. They correspond to two different and opposing modes of power and governance that were defined by Hannah Arendt as “persuasion through arguments” versus “coercion by force”. Arendt’s defense of persuasive power as the norm for an open constitutional society can be contrasted with the defense by Harvard Professor Samuel P. Huntington of top-down, coercive, or dark power as a prerequisite for social cohesion. The coercive power extolled by Huntington was antithetical to that of persuasion and openness: in his words, “Power remains strong when it remains in the dark; exposed to the sunlight it begins to evaporate.”
Arendt admired the American revolution for having created a constitution to ensure the rule of politics by openness and persuasion. Huntington in contrast advised the Botha government of white South Africa on how to set up a powerful state security apparatus outside public control. We can say that Arendt was a theorist of constitutional power, and Huntington of non-constitutional power. Power “in the dark” is the essence of what I, borrowing in 2007 a term from Turkey, meant by the deep state: a power not derived from the constitution but outside and above it, “more powerful than the public state.” In 2013 the return of the military to power in Egypt, together the revelations about NSA surveillance by Edward Snowden, gave currency to the notion of a deep state, which a New York Times Op-Ed defined as “A hard-to-perceive level of government or super-control that exists regardless of elections and that may thwart popular movements or radical change.”
But the deep state milieu (or system) is not only American, and it is not limited to U.S. covert agencies. It includes some of those institutions, like the NSA and the CIA, and alsoglobalized private groups like Booz Allen Hamilton (Edward Snowden’s former company) –half of the U.S. intelligence budget being outsourced. Finally, the deep state is composed of the powerful banks and multinational corporations (including oil and gas majors), whose views are well represented in the CIA and NSA. In short, my “deep state” is roughly the “deep political system” I defined in 1993 as “one which habitually resorts to decision-making and enforcement procedures outside as well as inside those publicly sanctioned by law and society”.
In my book, I look at how the American deep state has developed global ramifications, so that we now have the phenomenon of a “supranational deep state”. Since the end of World War Two, this shadowy and informal system of governance, originally Anglo-American, has expanded its base to include Asia. Here are two telling examples: in the 1980s, Reagan’s CIA director, William Casey, bypassed the CIA to finance the covert Afghan War through a corrupt international drug-related bank, the Bank of Credit and Commerce International (BCCI), with roots in Pakistan, Luxembourg, Saudi Arabia, and ultimately Abu Dhabi. More recently, elements of the American deep state, notably the mammoth oilfield services corporation Halliburton, have escaped from American oversight by relocating their headquarters to the less regulated capitals of the Persian Gulf.
MOC – Since 9/11 and the launching of the “War on Terror”, you wrote extensively about both of these topics, denouncing the US hawkish policies in the Middle East and in Central Asia. In this latest book, you define the “falsified war on terror”. Could you please explain us that notion?
P. D. SCOTT – In the United States, the establishment claims that the wars fought by America in Asia since 9/11 have been part of a global “war on terror.” But this “war,” or “falsified war”, has been fought in alliance with Saudi Arabia, Qatar, and Pakistan -whose elites include the principal political and financial backers of the al-Qaedist networks the U.S. has supposedly been fighting. Meanwhile the most authentic opponents in the region of these Sunni al-Qaedists -the governments of Iraq, Libya, Syria, and Iran- have found themselves overthrown (in the case of Iraq and Libya) subverted with U.S. support (in the case of Syria), or sanctioned and threatened as part of an “axis of evil” (in the case of Iran). We should not forget that, just one day after 9/11, Secretary of Defense Donald Rumsfeld was talking about “broadening the objectives of our response and ‘getting Iraq’”.
To understand the United States’ involvement in this “falsified war on terror”, I believe we must look at the complex of networks behind the recent U.S. campaign against Osama bin Laden and his followers in al-Qaeda. In fact both British and U.S. intelligence have had a deep and complex involvement for decades with the emerging movement of political Islam -a movement exemplified above all by the Muslim Brotherhood (MB) or Ikhwan, and its many spinoffs, of which al-Qaeda is but one. The MB itself should be regarded more as a movement than as a formal organization. Like the civil rights movement in America, it has been in continuous flux, and comprised of many tendencies, leading to some alliances that are nonviolent, others that are violent. Its complex relationships with the royal families of Saudi Arabia and Qatar have also been in flux.
In the 1950s, when the Soviet Union and Nasserite nationalism were seen as enemies by the West, MI-6 and the CIA developed mostly positive links with the MB and its allies. But as I show in my book, even since the fall of the USSR, U.S. officials, particularly in the CIA, have repeatedly chosen on occasion to preserve their long-term relationship with the MB and al-Qaedists.
I conclude that this “falsified war” has been fought for other motives than the official one of fighting terrorism -indeed few informed observers would contest the obvious and often-voiced observation, from U.S. intelligence analysts among others, that U.S. wars overseas (as opposed to intelligence and police actions) have radically increased the dangers of terrorism, not reduced them. Among the hidden motives, two stand out. One is the intention to establish a permanent U.S. military presence in the oil- and gas-rich regions of the Persian Gulf and Central Asia. Another is to justify a permanent domestic apparatus, in part to contain the threat of opposition to militarist policies, opposition either by direct action or by the publication of suppressed.
MOC – In this book, you also call this global military campaign a “terror war”. What is your definition of this term, and what is your analysis of the consequences of this “terror war” launched by the Bush administration in 2001?
P. D. SCOTT – On September 11, 2001, within hours of the murderous 9/11 attacks, Bush, Rumsfeld, and Cheney had committed America to what they later called the “War on Terror.” It should more properly, I believe, be called the “Terror War”, one in which terror has been directed repeatedly against civilians by all participants, both states and non-state actors. A terror war is one in which the major role is played by weapons of indiscriminate destruction, whether they are IEDs planted by the roadside or bombs delivered aerially by a high-tech drone.Terror war evolved out of the aerial attacks on civilians in World War II, beginning with Guernica and ending with the mass bombings of German and Japanese cities. But that aerial war was just one phase of a larger conventional war between armed forces…
This “terror war” should also be seen as part of a larger, indeed global, process in which terror has been used against civilians in interrelated campaigns by all major powers, including China in Xinjiang and Russia in Chechnya, as well as the United States.But perhaps no single act of terror committed in the last decade, whether by Qaddafi in Libya or Assad in Syria, has surpassed or even come close to the U.S. devastation of the Iraqi city of Fallujah.
Terror war in its global context should perhaps be seen as the latest stage of the age-long secular spread of “trans-urban” civilization into areas of mostly rural resistance – areas where conventional forms of warfare, for either geographic or cultural reasons, prove inconclusive.
I invented the word “transurban” to indicate that there is an important clash of cultures of which Samuel Huntington was unaware: between the globalizing culture of cities across the world, on the one hand, and the diverse cultures of peasants, nomads, and even the gun-toting ranchers of the American red states, on the other.
Recently, a study published by the respected, Nobel Peace Prize-winning NGO called Physicians for Social Responsibility (PSR) showed that at least 1.3 million of people have been killed in Iraq, Afghanistan and Pakistan since the misnamed “War on Terror” was launched in 2001. So my notion of a “terror war” is exemplified by this human disaster. The situation there is aggravated by the fact the Bush administration completely disorganized the Iraqi army during the occupation in 2003. Even if it is now well equipped by US-made weapons, the Iraqi army seems unable to effectively oppose Daesh, which until now has been able to seize a huge number of those US weapons and is getting stronger and stronger.
Finally, all this confusion and bloodletting in the Middle East has increased in the wake of America’s Iraq fiasco, and this has seriously weakened the hopes of governmental arrangements and understandings for regional peace and security. But this same decline represents a new frontier of entrepreneurial opportunity for Academi (formerly known as Blackwater), Booz Allen, and other liberated fragments of the American deep state.
MOC – In your book, you describe an oil, arms and petrodollar triangle, linking US and Saudi governments, which has a global impact at a deep level. Could you tell us more about those shadowy connections, and their consequences on issues like international terrorism?
P. D. SCOTT – The export of Saudi oil, paid for by all customers in U.S. dollars, and in America’s case largely offset by the export of U.S. arms to Saudi Arabia, is a major underpinning of America’s petrodollar economy. As I have documented in the book, its current strength is supported by OPEC’s requirement (secured by a secret agreement in the 1970’s between the US and Saudi Arabia and continuing to this day) that all OPEC oil sales be denominated in dollars: in 1974 Treasury Secretary, William Simon, negotiated a secret deal so the Saudi central bank could buy U.S. Treasury securities outside of the normal auction. A few years later, Treasury Secretary Michael Blumenthal cut a secret deal with the Saudis so that OPEC would continue to price oil in dollars. These deals were secret because the United States had promised other industrialized democracies that it would not pursue such unilateral policies.
$600 billion of the Saudi dollar earnings have been reinvested abroad, most of it in U.S. corporations like Citigroup, where the largest shareholder is a member of the Saudi Royal family.
This fusion of U.S. and Saudi governing interests is as much political as economic. The first oil price hikes of 1972-73, arranged by Nixon with the King of Saudi Arabia and the Shah of Iran, helped pay to arm Iran and Saudi Arabia as U.S. proxies in the region, following the withdrawal of British troops from the region in 1971. The oil price hikes of 1979-80, on the other hand, were assuredly not the intention of President Carter, a political victim of the increases. As I document in the book, they have however been credibly attributed to the work of oil majors like BP, possibly acting in collusion with Republicans; and had the result of helping to elect Ronald Reagan (as well as Margaret Thatcher in England).
I am suggesting that there is a high-level fusion of interests between the U.S. and Saudi governments, oil companies and banks (not to mention facilitating alliances like the Carlyle Group) which the CIA tends to represent continuously, and not just ad hoc for the sake of any one particular goal. In the book, I document a phenomenon ignored or downplayed by the mainstream media, i.e. on-going protection of major al-Qaeda figures…
The FBI, in the 90’s, continuously protected its informant, Ali Mohamed. A member of U.S. Special Forces in the 80’s, this Egyptian was also a key planner and trainer for al-Qaeda. He was authorized to enter and reside in the United States in 1984 “on a visa-waiver program that was sponsored by the agency [i.e. CIA] itself, one designed to shield valuable assets or those who have performed valuable services for the country”, as explained by the political scientist Lawrence Wright.
The CIA prevented at least two of the alleged 9/11 hijackers, Khaled al-Mihdhar and Nawaf al-Hazmi, from being detected and surveilled by the FBI in the months (and even the week) leading to 9/11. The perpetrators of this concerted withholding of evidence in the CIA, including Richard Blee, Tom Wilshire and Alfreda Frances Bikowsky, were subsequently promoted.
The ruling family in Qatar who, in the mid-90’s,sheltered and protected al-Qaeda’s Khalid Sheikh Mohammed, the alleged “principal architect of the 9/11 attacks”.
Last but not least, members of the Saudi royal family have been deeply involved in the emergence and the rise of al-Qaeda as a global terrorist organization. I study several examples in the book.
Of course, these different forms of state protection were concealed by the 9/11 Commission, which was tasked by the Bush administration to investigate these attacks in 2004 – thanks to the pressure of some 9/11 victims’ families. By contrast, its9/11 Commission Report falsely depicted al-Qaeda as a non-state actor. In my opinion, the protection of these terrorists should be seen as a consequence of the “black hole” created by the ultimate United States dependency on Saudi Arabia, Qatar, and OPEC, for the defense of the petrodollar – which represents a high-level fusion of interests.
I am confident that the mystery of this U.S./Saudi/Qatari governments’ protection ofkey al-Qaeda terrorists can be traced in part to this “invisible roof” of inscrutable governmental, financial, and corporate relationships between the United States and Saudi Arabia. There is a “black hole” at the center of this roof in which the interests of governments, petrodollar banks, intelligence agencies, and multinational oil companies, are all inscrutably mixed.
Interview with the participation of Maxime Chaix
MONDE ARABE – Rencontre avec Peter Dale Scott : « L’administration Bush a sacrifié le Moyen-Orient… »
La confusion et les effusions de sang qui ont lieu au Moyen-Orient aujourd’hui, tout comme l’émergence de l’État islamique, ont été encouragées par le fiasco des États-Unis en Irak, qui a considérablement amenuisé les espoirs d’ententes politiques et diplomatiques en faveur de la paix et de la sécurité dans cette région. Rencontre avec Peter Dale Scott, ancien diplomate canadien, porte-parole du mouvement pacifiste durant la guerre du Vietnam et cofondateur du programme d’études Paix et Conflit de l’Université de Berkeley où il a enseigné pendant près de trente ans, spécialiste de la politique étrangère états-unienne.
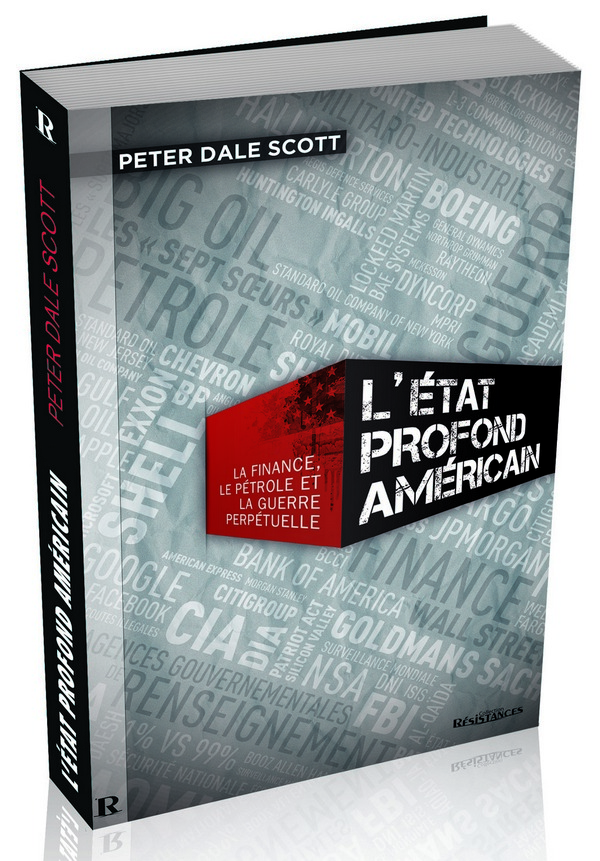 Le Courrier du Maghreb et de l’Orient – Votre dernier livre s’intitule L’État profond américain. Que signifie cette expression ?
Le Courrier du Maghreb et de l’Orient – Votre dernier livre s’intitule L’État profond américain. Que signifie cette expression ?
Peter Dale SCOTT – Depuis longtemps, deux cultures politiques différentes ont prévalu aux États-Unis. Celles-ci sous-tendent les divergences politiques entre les citoyens de ce pays, de même qu’entre divers secteurs de l’État. Dans une certaine mesure, on peut retrouver ces deux mentalités dans chaque société. Elles correspondent à deux exercices opposés du pouvoir et de la gouvernance, définis par Hannah Arendt comme la « persuasion par arguments » face à la « contrainte par la force ». On peut considérer que l’apologie, par Arendt, du pouvoir persuasif comme fondement d’une société constitutionnelle et ouverte est aux antipodes de la défense – par le professeur de Harvard Samuel P. Huntington – d’un pouvoir de l’ombre autoritaire et coercitif comme prérequis de la cohésion sociale. Ce pouvoir coercitif prôné par Huntington constitue donc l’antithèse du pouvoir ouvert et persuasif. Selon lui, « le pouvoir ne peut rester fort que lorsqu’il est maintenu dans l’ombre ; lorsqu’il est exposé à la lumière du jour, il commence à s’évaporer ».
Hannah Arendt admirait la révolution américaine, puisqu’elle avait abouti à la création d’une Constitution visant à assurer l’encadrement du pouvoir politique par l’ouverture et la persuasion. Au contraire, dans l’Afrique du Sud ségrégationniste, Huntington conseilla le gouvernement Botha dans la mise en place d’un puissant appareil d’État sécuritaire non soumis au contrôle public. Nous pourrions dire qu’Arendt était une théoricienne du pouvoir constitutionnel, et Huntington du « pouvoir de l’ombre ». Ce dernier est l’essence même de ce que j’ai voulu signifier en me référant à « l’État profond », une expression que j’ai empruntée à la Turquie en 2007. Il s’agit d’un pouvoir qui ne provient pas de la constitution, mais de sources extérieures et supérieures à celle-ci, et qui est plus puissant que l’État public. En 2013, le retour de l’armée à la tête de Égypte, de même que les révélations sur la surveillance de la NSA par Edward Snowden, ont donné de la valeur à la notion d’État profond. Celui-ci a été défini dans une tribune libre du New York Times comme « un niveau de gouvernement ou de super contrôle difficilement perceptible, qui se maintient quel que soit le résultat des élections et qui est susceptible de contrecarrer les mouvements sociaux ou les changements radicaux ».
Néanmoins, le milieu (ou le système) de l’État profond n’est pas seulement états-unien, et il ne se limite pas aux services secrets des États-Unis. En font partie des agences comme la CIA et la NSA, ainsi que des entreprises privées telles que Booz Allen Hamilton (l’ancien employeur d’Edward Snowden), auxquelles plus de la moitié du budget du renseignement US est sous-traitée. Cet État profond inclut finalement les puissantes banques et autres multinationales (y compris les supermajors pétrolières et gazières), dont les intérêts et les opinions sont largement représentés au sein de la CIA ou de la NSA. En résumé, mon usage de l’expression « État profond » correspond à ce que j’ai appelé en 1993 un « système politique profond ». Habituellement, comme je l’ai écrit, celui-ci a recours à des procédures décisionnelles et exécutives soit conformes, soit extérieures à celles qui sont publiquement autorisées par la loi et la société.
Dans mon livre, j’explique que celui-ci a des ramifications globales, d’où ma notion d’un « État profond supranational ». En effet, depuis l’après-guerre, ce système de gouvernance opaque et informel s’est progressivement internationalisé. En voici deux exemples parlants : dans les années 1980, William Casey (le directeur de la CIA sous la présidence Reagan) contourna sa propre agence pour financer la guerre secrète contre les Soviétiques en Afghanistan. Pour ce faire, il eut recours aux services de la BCCI (Bank of Credit and Commerce International), une multinationale bancaire corrompue et impliquée dans le trafic de drogue global, qui était enracinée au Pakistan, au Luxembourg, en Arabie saoudite, ainsi qu’à Abou Dhabi. Plus récemment, des éléments de l’État profond américain -notamment la puissante entreprise de services pétroliers Halliburton- se sont mis à l’abri de la supervision des autorités US en délocalisant leurs sièges sociaux dans les capitales moins régulées du golfe Persique…
CMO – Depuis le 11 septembre 2001 et le lancement de la « guerre contre le terrorisme », vous avez beaucoup écrit sur ces deux sujets, dénonçant les politiques bellicistes des États-Unis au Moyen-Orient et en Asie centrale. Dans ce dernier livre, vous avez défini ce que vous appelez la guerre « contre » le terrorisme. Pourriez-vous développer ce concept ?
P. D. SCOTT – Aux États-Unis, l’establishment affirme que les guerres lancées par les États-Unis sur le continent asiatique depuis les attentats de septembre 2001 entrent dans le cadre d’une « guerre globale contre la terreur ». Cependant, cette campagne militaire « contre » le terrorisme a été menée avec la coopération de l’Arabie saoudite, du Qatar et du Pakistan. Or, parmi les élites de ces trois pays, se trouvent les principaux soutiens financiers et politiques des réseaux jihadistes que les États-Unis sont censés avoir combattus jusqu’à présent. Dans le même temps, les plus farouches opposants à ces terroristes sunnites, à savoir les gouvernements d’Irak, de Libye, de Syrie et d’Iran, ont été renversés (Irak et Libye), déstabilisés avec l’appui des États-Unis et de la France (Syrie) ou sanctionnés et menacés en tant qu’éléments de l’« Axe du Mal » (Iran). N’oublions pas que, dès le lendemain du 11 septembre, le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld parlait « d’élargir les objectifs de notre riposte et de ‘frapper l’Irak’ ».
Afin de comprendre l’engagement des États-Unis dans cette région, nous devons nous intéresser aux réseaux opaques qui agissent derrière leur campagne post-11 septembre contre Oussama ben Laden et al-Qaïda. En réalité, depuis des décennies, les services de renseignement britanniques et états-uniens ont été impliqués de façon profonde et complexe avec le mouvement émergent de l’Islam politique -symbolisé avant tout par les Frères musulmans (Ikhwan)- et ses nombreuses organisations affiliées, dont al-Qaïda est issue. Les Frères musulmans eux-mêmes devraient être considérés comme une mouvance plus que comme une organisation formelle. À l’instar du mouvement des droits civiques aux États-Unis, ils se sont continuellement transformés et ont regroupé de nombreuses tendances, suscitant aussi bien des alliances pacifiques que violentes. Leurs relations complexes avec les familles royales saoudiennes et qataries se sont également révélées fluctuantes.
Dans les années 1950, lorsque l’Union soviétique et le nationalisme nassériste étaient considérés comme des ennemis en Occident, le MI6 et la CIA ont développé des liens principalement positifs avec les Frères musulmans et leurs alliés. Dans le livre, je démontre que de hauts responsables états-uniens -y compris depuis la chute de l’URSS- ont systématiquement choisi de préserver leur relation de long terme avec ce mouvement et certains réseaux jihadistes (en particulier à la CIA). J’en déduis que cette guerre « contre » le terrorisme n’a pas été menée pour le motif officiel de combattre ce fléau, mais pour d’autres raisons. En effet, peu d’experts remettent en cause le constat évident et fréquemment formulé -notamment par des analystes du renseignement US- selon lequel les guerres des États-Unis à l’étranger ont radicalement amplifié la menace au lieu de la réduire (contrairement aux opérations de police ou des services secrets).
Parmi les raisons inavouées de cette campagne « contre » le terrorisme, nous pouvons en identifier deux principales. La première est la volonté d’établir une présence durable des forces militaires états-uniennes dans les régions riches en hydrocarbures du golfe Persique et de l’Asie centrale. La seconde raison est de justifier un dispositif de sécurité intérieure permanent et gigantesque, notamment destiné à neutraliser les risques d’opposition aux politiques militaristes. Cette résistance populaire se manifeste soit par l’activisme sur le terrain, soit par la publication de vérités passées sous silence (comme dans ce livre).
CMO – Dans ce livre, vous qualifiez également cette campagne militaire globale de « guerre de terreur ». Quelle est votre définition de cette expression, et quelle est votre analyse des conséquences de cette « guerre de terreur » lancée par l’administration Bush en 2001 ?
P. D. SCOTT – Le 11 septembre 2001, dans les heures qui suivirent les attentats meurtriers perpétrés ce jour-là, George W. Bush, Donald Rumsfeld et Dick Cheney avaient engagé les États-Unis dans ce qu’ils nommèrent ensuite la « guerre contre la terreur ». Selon moi, nous devrions plutôt l’appeler la « guerre de terreur » : des actes effroyables ont été systématiquement perpétrés contre les civils par l’ensemble des belligérants, qu’ils soient des acteurs étatiques ou non.
Une guerre de terreur est un conflit dans lequel les armes de destruction indiscriminée sont employées massivement, qu’il s’agisse d’engins explosifs improvisés (EEI) enterrés au bord des routes ou de missiles lancés depuis les airs par un drone de haute technologie. La « guerre de terreur » n’est pas nouvelle ; c’est, par exemple, les attaques aériennes contre les civils durant la seconde guerre mondiale, commençant par Guernica et s’achevant avec les bombardements massifs de villes allemandes et japonaises. Toutefois, cette guerre aérienne n’était à l’époque qu’une séquence d’une plus vaste guerre conventionnelle entre des forces armées.
Nous devrions également envisager la guerre de Bush comme faisant partie d’un plus vaste processus, d’ampleur globale. À travers celui-ci, la terreur a été utilisée contre les civils par toutes les grandes puissances lors de campagnes étroitement liées entre elles -la Chine dans le Xinjiang et la Russie en Tchétchénie, autant que les États-Unis dans de nombreuses régions du monde.Cependant, il est possible qu’aucun acte de terreur perpétré depuis le début du XXI ème siècle -que ce soit par les troupes de M. Mouammar Kadhafi en Libye ou de M. Bachar el-Assad en Syrie- n’ait dépassé, ou même approché, la dévastation de la ville irakienne de Falloujah par les troupes états-uniennes, en 2004.
Dans son contexte global, la guerre de terreur pourrait être perçue comme la dernière étape de l’expansion de la civilisation « transurbaine » dans des zones où prédomine une résistance rurale, un processus enclenché il y a plusieurs siècles. « Transurbain » est un terme que j’ai inventé pour attirer l’attention sur un important choc des cultures, dont le théoricien du « choc des civilisations », Samuel Huntington, n’était pas conscient. Il s’agit de l’opposition entre, d’une part, la culture globalisante des métropoles à travers le monde et, d’autre part, les différentes cultures traditionnelles des paysans, des nomades, ou même des propriétaires de ranchs dans les régions conservatrices des États-Unis. Dans ces régions, il s’est avéré que les formes conventionnelles de guerre ne peuvent trouver de véritable conclusion, et ce pour des raisons géographiques ou culturelles.
Récemment, une étude publiée par une ONG lauréate du Prix Nobel de la Paix (Physicians for Social Responsibility [PSR]) a démontré qu’au moins 1,3 million de personnes avaient été tuées en Irak, en Afghanistan et au Pakistan depuis que la mal nommée « guerre contre la terreur » avait été lancée en 2001.
Donc ma notion de « guerre de terreur » est illustrée par ce désastre humain. La situation au Moyen-Orient est aggravée par le fait que l’administration Bush a complètement désorganisé l’armée irakienne durant l’occupation en 2003. Bien qu’elle soit aujourd’hui lourdement équipée par des armements « made in USA », l’armée irakienne semble incapable de s’opposer avec succès à l’avancée de Daech, qui a réussi jusqu’à présent à s’emparer d’une proportion conséquente de ces armes états-uniennes et qui se renforce de jour en jour.
Finalement, toute cette confusion et ces effusions de sang ont été encouragées par le fiasco des États-Unis en Irak, qui a considérablement amenuisé les espoirs d’ententes politiques et diplomatiques en faveur de la paix et de la sécurité dans cette région. Néanmoins, cette situation chaotique représente une nouvelle ère d’opportunités entrepreneuriales pour Academi (anciennement Blackwater), Booz Allen, et d’autres éléments aujourd’hui débridés de « l’État profond américain ».
CMO – Dans L’État profond américain, vous décrivez un triangle pétrole, armements et pétrodollars, liant le gouvernement des États-Unis à la famille royale saoudienne, qui a un impact global à un niveau profond. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces connexions, et leurs conséquences sur des questions telles que le terrorisme international ?
P. D. SCOTT – Les importations de pétrole saoudien sont réglées en dollars par les pays consommateurs. Aux États-Unis, celles-ci sont largement compensées par les ventes d’armes US à l’Arabie saoudite, et par les investissements de ce pays dans l’économie US. Il s’agit d’un pilier central de ce système des pétrodollars. Comme je l’ai documenté dans ce livre, sa pérennité est garantie par un prérequis de l’OPEP, imposant que les ventes de pétrole de ses pays membres s’effectuent en dollars. Cette règle fut établie en vertu d’un accord secret entre les États-Unis et l’Arabie saoudite, passé en 1974 et encore en vigueur :le secrétaire au Trésor de l’époque, William Simon, négocia un accord assurant que la banque centrale saoudienne pourrait acheter des bons du Trésor US en dehors du marché habituel. Quelques années plus tard, son successeur, Michael Blumenthal, noua une entente confidentielle avec l’Arabie saoudite, garantissant que l’OPEP continuerait de vendre le pétrole en dollars. Ces accords étaient secrets car les États-Unis avaient promis aux autres démocraties industrialisées qu’ils ne mèneraient pas de telles politiques unilatérales.
Le royaume saoudien a réinvesti 600 milliards de dollars de recettes à l’étranger, en majorité dans des entreprises états-uniennes comme Citigroup, dont le principal actionnaire est un membre de la famille royale saoudienne…
Cette fusion des intérêts supérieurs états-uniens et saoudiens comporte une dimension tant politique qu’économique. Orchestré par le Président Nixon avec le roi d’Arabie saoudite et le Shah d’Iran, le premier choc pétrolier de 1972-73 contribua à financer l’armement des royaumes perse et saoudien en tant que relais de la politique étrangère des États-Unis au Moyen-Orient -à la suite du retrait des troupes britanniques de cette région en 1971.
En revanche, il ne fait aucun doute que le choc pétrolier de 1979-80 ne fut pas souhaité par le président Carter, qui a été une victime politique des hausses de prix correspondantes. Comme je le montre dans le livre, les origines de cette crise ont été attribuées aux manigances de majors pétrolières telles que BP, potentiellement soutenues par des Républicains désireux de battre Jimmy Carter lors de l’élection présidentielle de 1980.Finalement, ces manœuvres ont facilité la conquête du pouvoir par Ronald Reagan (et par Margaret Thatcher en Angleterre).
Il existe ainsi une collusion d’intérêts supérieurs entre les gouvernements, les majors pétrolières et les banques états-uniennes et saoudiennes -sans parler des fonds d’investissement privés, comme le Groupe Carlyle, qui agissent en réseaux d’influence.
La CIA tend à incarner cette relation de façon permanente, et non pour satisfaire ponctuellement des objectifs particuliers. Dans le livre, je documente un phénomène ignoré ou minimisé par les médias « grand public ». Il s’agit d’une protection de long terme accordée à des figures centrales d’al-Qaïda.
Premièrement, le FBI, dans les années 1990, a continuellement protégé son informateur, Ali Mohamed. Membre des Forces spéciales US dans les années 1980, cet Égyptien devint un planificateur et instructeur clé d’al-Qaïda. Il fut autorisé à entrer et à résider aux États-Unis en 1984 « dans le cadre d’un programme d’exemption de visas parrainé par la CIA elle-même, programme visant à protéger des personnes-ressources importantes ou des individus ayant rendu de grands services à la nation », comme l’a indiqué le politologue Lawrence Wright.
Deuxièmement, la CIA a empêché la détection et la surveillance, par le FBI, d’au moins deux pirates de l’air présumés du 11 septembre –les dénommés Khaled al-Mihdhar et Nawaf al-Hazmi–, dans les mois (et même la semaine) précédant le 11 septembre. Les auteurs de cette dissimulation concertée au sein de la CIA, dont Richard Blee, Tom Wilshire et Alfreda Frances Bikowsky, ont ensuite été promus…
Troisièmement, l’Émirat du Qatar, au milieu des années 1990, a hébergé et protégé Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau présumé du 11 septembre.
Quatrièmement, enfin, des membres de la famille royale saoudienne ont été profondément impliqués dans l’émergence et la montée en puissance d’al-Qaïda en tant qu’organisation terroriste globale. J’en étudie de nombreux exemples dans le livre.
Bien entendu, ces différentes formes de protection étatique ont été dissimulées par la Commission nationale sur le 11 septembre, qui avait été chargée en 2004 par l’administration Bush d’enquêter sur ces attaques -cédant à la pression des familles de victimes qui exigeaient une investigation officielle. Au contraire, le Rapport de la Commission sur le 11 septembre dépeint fallacieusement al-Qaïda comme un acteur non étatique. Selon moi, la protection de ces terroristes résulte du « trou noir » engendré par la dépendance ultime des États-Unis vis-à-vis de l’Arabie saoudite, du Qatar et de l’OPEP pour qu’ils défendent le système des pétrodollars -étant donc une conséquence de cette fusion d’intérêts supérieurs.
Je peux suggérer avec confiance que le mystère de la protection de ces terroristes par les gouvernements états-unien, qatari et saoudien peut en partie remonter à ce « plafond invisible » de relations gouvernementales, financières et affairistes entre les États-Unis et les pétromonarchies citées précédemment.
Il existe un « trou noir » au cœur de ce « plafond invisible », dans lequel les intérêts occultes des gouvernements, des banques gérant les pétrodollars, des agences de renseignement et des multinationales pétrolières sont entremêlés, dans une opacité impénétrable.
Interview avec la participation de Maxime Chaix





3 Comments
Pingback: summer vacation - Occurrences
Pingback: Éditions Demi Lune : « Le travail de Peter Dale Scott au coeur de l’actualité ! » | Maxime Chaix.info
Pingback: Peter Dale Scott : « L’administration Bush a sacrifié le Moyen-Orient… » (Le Courrier du Maghreb et de l’Orient/Maxime Chaix) | Maxime Chaix.info