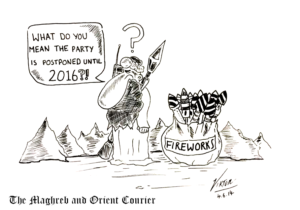« Quand on nous force à faire la guerre, il n’y a pas d’autre alternative que d’utiliser tous les moyens disponibles pour l’amener à une fin rapide. L’objet même de la guerre est la victoire, pas une indécision prolongée. Dans une guerre, il n’y a pas d’alternative à la victoire. » (Discours du général Douglas MacArthur devant le Congrès des États-Unis, le 19 avril 1951)
La « guerre américaine » en Afghanistan, qui dure depuis seize ans, est la plus longue que les États-Unis aient jamais menée.
Le journaliste Will Rahn, sur CBS News, a pu écrire que, « pour toute la jeune génération d’Américains, faire la guerre en Afghanistan est l’une des missions naturelles du gouvernement américain, comme percevoir les impôts et distribuer des allocations sociales. La très grande majorité des lycéens (…) n’ont aucun souvenir d’une époque où leur pays n’était pas en guerre dans ce pays du bout du monde. Et bientôt, certains s’y retrouveront probablement pour y poursuivre cette campagne militaire alors même qu’ils n’étaient pas nés lors des attentats du 11 septembre 2001 ».
La guerre aurait coûté à ce jour un trilliard (mille milliards) de dollars, ce qui en fait le second conflit le plus cher de l’histoire américaine après la seconde guerre mondiale. Elle a coûté la vie à 2.350 militaires américains et en a laissé 20.000 blessés et handicapés à vie.
Après Georges Bush et Barak Obama, Donald Trump est donc le troisième président américain à devoir gérer cette situation.
Dans l’un de ses tweets de 2013, il avait écrit : « Nous devrions quitter l’Afghanistan immédiatement. Plus de vies gâchées. Si nous devons y revenir, nous le ferons rapidement et en frappant dur. Reconstruisons d’abord les États-Unis. » Et en 2015, il déclarait que cette guerre était « une erreur », et que sa préférence allait à un retrait complet des troupes américaines, le soin de poursuivre la guerre étant laissé au gouvernement afghan et à des « contractors » privés.
Pourtant, dans un discours délivré le 21 août 2017 à Fort Myers (en Virginie), le président Trump a annoncé que non seulement les États-Unis ne retireraient pas d’Afghanistan leurs troupes qui s’y trouvent encore (environ 11.000 soldats), mais qu’ils les renforceraient de quelques milliers d’hommes supplémentaires.
Ce renforcement de la présence militaire américaine a-t-il un sens, ou revient-il à « renforcer la défaite » ?
En fait, cette guerre qui n’est plus gagnable militairement pourrait encore l’être politiquement dans le cadre de la nouvelle stratégie américaine décidée par le président Trump.
* * *
Première partie : une guerre perdue dès l’origine, qui ne peut plus être « gagnée » militairement
En un sens, cette guerre en Afghanistan a été perdue dès 2001 car elle n’a conduit qu’à un émiettement de la menace et non à sa suppression.
Les objectifs de l’intervention américaine en 2001 : punir et détruire
L’intervention américaine d’octobre 2001 dans le cadre de l’opération Enduring Freedom visait deux objectifs : d’abord, punir le régime des Talibans pour avoir accueilli, laissé opérer sur le territoire afghan et refusé de livrer au gouvernement américain les membres et surtout les responsables d’Al-Qaïda, au premier rang desquels Oussama Ben Laden, qui avaient, depuis leur base afghane, organisé les attentats du 11 septembre 2001 ; ensuite, détruire Al-Qaïda, ses cadres, ses camps d’entraînement.
Or, ces objectifs n’ont pas été atteints, même si les Talibans ont été chassés du pouvoir dès décembre 2001.
S’ils ont dû quitter Kaboul et leur « capitale » de Kandahar, le mollah Omar et les autres chefs ont pu se réfugier dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan et dès 2003, ils étaient en mesure de lancer une insurrection contre le gouvernement dirigé par le nouveau président Afghan, Hamid Karzaï, et appuyé par les forces de l’OTAN.
Dans le même temps, les responsables d’Al-Qaïda n’ont pas grandement été affectés par l’intervention américaine. Après avoir dans un premier temps trouvé refuge dans les grottes des montagnes de Tora Bora (dans l’est de l’Afghanistan), ils ont pu rejoindre les zones tribales pakistanaises et y reconstituer l’organisation. Depuis la mort de Ben Laden, Ayman al-Zawahiri en est le chef. C’est lui qui, en septembre 2014, a annoncé la création d’Al-Qaïda dans le sous-continent indien (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent – AQIS).
Non seulement Al-Qaïda n’a pas été détruite, mais, depuis 2001, d’autres groupes terroristes se sont développés en Afghanistan.
Le plus notable est l’État islamique, qui s’est implanté fin 2014 dans le nord-est de l’Afghanistan, dans une zone qu’il a appelée la « province de Khorasan », du nom d’une région historique qui regroupait une partie de l’Iran, l’Asie centrale, l’Afghanistan et le Pakistan. L’État islamique-Province de Khorasan ne contrôle toutefois qu’un territoire très réduit dans la province de Nangarhar, dans l’est de l’Afghanistan. Son émir actuel est Abdul Hasib, un ancien Taliban afghan, qui a remplacé Hafiz Saeed Khan, tué en 2016 par une frappe de drone américain. Le groupe compterait 1.000 à 2.000 combattants en Afghanistan et au Pakistan.
C’est contre une base (un complexe de grottes) de l’État islamique dans la province de Nangarhar que les États-Unis ont largué en avril 2017 une bombe GBU-43/B, la plus puissante de l’arsenal américain en dehors des armes nucléaires.
Depuis le début de l’année 2015, les Talibans et l’État islamique sont entrés dans une phase d’affrontement armé. Daesh reproche aux Talibans de tirer leur légitimité, non pas d’un message islamique universel, mais d’une étroite base ethnique et nationaliste ; et là où l’État islamique vise l’établissement d’un califat qui regrouperait l’entière communauté musulmane (l’Oumma), les Talibans ne cherchent qu’à reprendre le pouvoir en Afghanistan. Pour l’État islamique, les Talibans ne sont donc que des « nationalistes » (terme insultant s’il en est, aux yeux des islamistes), et ils n’appliquent même pas la charia de façon authentique, mais un mélange de loi islamique et de coutumes pashtounes. C’est aussi ce « nationalisme » qui expliquerait, selon la revue Dabiq de l’État islamique, que les Talibans acceptent de s’allier aux chiites, qui sont pour Daesh des « rafidahs » (des infidèles) « encore plus dangereux que les Américains ».
Lashkar-e-Taïba est un groupe créé en 1981 dans la province du Kunar, en Afghanistan, dans le contexte de la guerre contre les Soviétiques. Très proche des Talibans, il vise à « libérer » le Cachemire de ce qu’il considère comme une « occupation » par l’Inde et à le rattacher au Pakistan (ce qui lui vaut la plus grande bienveillance du gouvernement pakistanais). Il est considéré par l’Inde comme responsable de plusieurs attentats, dont ceux de Bombay en novembre 2008.
Enfin, l’un des groupes terroristes actifs sur le territoire afghan est le réseau Haqqani, du nom de son fondateur, Jalaluddin Haqqani. Ce groupe, classé comme terroriste par les États-Unis (contrairement aux Talibans), est désormais dirigé par son fils, Sirajuddin, qui supervise la plupart des opérations militaires des Talibans.
La guerre ne peut plus être gagnée sur le terrain, en raison de facteurs tant militaires que politiques
Au plan militaire, les Talibans sont désormais trop forts pour être éradiqués. C’est ce qu’a démontré l’échec du « Surge » (qu’on pourrait traduire en français par « le coup de collier »), le triplement du contingent militaire américain décidé par le président Obama en décembre 2009.
Selon des évaluations américaines, le gouvernement afghan ne contrôlerait que 60% du territoire, le reste étant soit contesté, soit sous le contrôle des Talibans. Un peu comme sous l’occupation soviétique, le gouvernement ne contrôle réellement que la capitale, la frontière nord et les capitales provinciales. Les zones rurales que les Talibans contrôlent sont celles où se déploie la culture du pavot, premier moyen de financement de l’insurrection.
En septembre 2015, les talibans ont occupé Kunduz, la cinquième ville d’Afghanistan (avec environ 300.000 habitants) et un nœud stratégique du nord du pays, puisqu’il permet de relier la capitale, Kaboul, au Tadjikistan voisin. C’était la première fois depuis 2001 qu’ils s’emparaient ainsi d’une ville de quelque importance, a fortiori d’une capitale provinciale. Le plus inquiétant est qu’ils y soient arrivés avec finalement très peu de combattants, puisque quelques centaines d’hommes ont suffi à faire fuir les 7.000 membres des forces de sécurité. La ville a été reprise trois jours plus tard grâce à l’aide aérienne et aux forces spéciales américaines insérées (« embedded ») dans les unités afghanes. Après ce coup d’éclat, les Talibans ont menacé la ville de Ghazni, au sud-ouest de Kaboul, coupant pendant trois jours l’axe principal reliant Kaboul à Kandahar, puis Lashkar Gah, la capitale du Helmand, dans le sud.
Plus récemment, en avril 2017, les Talibans ont attaqué une importante base militaire de l’armée afghane à Mazar-i-Sharif. Plus de 140 soldats ont été tués lors de cette attaque, qui a conduit le ministre de la Défense et le chef d’État-major des armées à démissionner.
Les raisons de cette impossibilité à éradiquer les Talibans sont multiples.
La principale est la sympathie dont ils bénéficient dans les zones rurales et, dans une moindre mesure, dans une partie des populations urbaines – même si les Afghans, dans leur grande majorité, sont très loin de souhaiter leur retour au pouvoir et voient de ce fait comme un moindre mal la présence militaire américaine.
La seconde raison de l’influence persistante des Talibans est l’incapacité du gouvernement de Kaboul à construire un consensus autour de son action et à bâtir un sentiment national. Le « Nation building » ambitionné par les Occidentaux a échoué ; ce qui était sans doute inéluctable.
Le gouvernement est en crise depuis les élections présidentielles de 2014, qui n’ont pas permis de dégager un véritable vainqueur et ont débouché sur un partage du pouvoir (le « gouvernement d’union nationale ») entre le président Ashraf Ghani et le « Chief Executive Officer » (l’équivalent d’un premier ministre de la cinquième république française) Abdullah Abdullah. Mais ces deux autorités, si elles continuent encore de « cohabiter », ne s’entendent plus et se livrent depuis l’automne 2016 à une lutte larvée. Le gouvernement rencontre également une opposition au parlement, qui a contré certaines nominations de ministres, dont celui de la Défense.
Peu légitime, le gouvernement est également peu efficace. La Banque mondiale classe l’Afghanistan parmi les pays les plus mal gouvernés, quels que soient les critères qu’on prenne pour apprécier sa gouvernance (transparence, stabilité politique, efficacité du gouvernement, État de droit, corruption).
Or, aucune contre-insurrection ne peut réussir si le gouvernement qui la mène ne bénéficie pas d’une légitimité suffisante dans la population.
L’échec du renforcement et de la professionnalisation de l’armée et de la police afghanes est la troisième raison de cette persistance et du renforcement du mouvement taliban.
L’armée afghane demeure handicapée par plusieurs phénomènes : l’inefficacité, l’illettrisme, le détournement des ressources, le manque de discipline, la corruption, les désertions (les AWOL, ou « Absent Without Official Leaving », c’est-à-dire les soldats « fantômes » que leurs officiers déclarent néanmoins pour percevoir leur solde), l’usage de drogue (qui toucherait plus de 50% des soldats), les refus de combattre, voire la collaboration pure et simple avec les Talibans…
Enfin, l’existence du sanctuaire pakistanais est une dernière raison, déterminante, de l’impossibilité à écraser le mouvement taliban. Une autre leçon de l’Histoire, en effet, c’est qu’un mouvement insurrectionnel ne peut être vaincu s’il dispose d’un sanctuaire où il peut se protéger des coups de son adversaire, reconstituer ses forces et planifier ses attaques.
Or, les talibans disposent de ce sanctuaire au Pakistan, dans les « zones tribales » du nord-ouest du pays, et ils bénéficient également de la bienveillance, pour ne pas dire de l’aide précieuse des services secrets pakistanais, l’Inter-Service Intelligence, l’ISI.
Depuis le début de l’insurrection talibane, l’administration américaine presse le gouvernement pakistanais d’amener les Talibans à négocier avec le gouvernement afghan. Washington exige également d’Islamabad qu’il lutte résolument et efficacement contre les groupes terroristes qui agissent depuis son territoire.
Mais si, en 2015, le Congrès a réduit d’un tiers l’assistance militaire américaine au Pakistan en raison de l’insuffisante énergie qu’il met à combattre le réseau Haqqani, cette pression rencontre plusieurs limites : le gouvernement pakistanais (et spécialement l’ISI) continue de considérer les Talibans (et même le groupe terroriste Haqqani) comme des cartes à conserver dans la confrontation avec l’ennemi indien. Ensuite, le Pakistan peut toujours craindre qu’une répression trop intense des Talibans afghans ne conduise à une aggravation du terrorisme dirigé contre lui-même par les Talibans pakistanais, qui ambitionnent de renverser le gouvernement et de le remplacer par un régime islamiste radical.
Enfin, les États-Unis continuent d’avoir besoin de la coopération du gouvernement pakistanais, à la fois en termes d’échanges de renseignements sur les groupes terroristes et pour l’accès terrestre et aérien nécessaire au ravitaillement des troupes de l’OTAN stationnées en Afghanistan.
Deuxième partie – La perspective d’une victoire politique
Le renforcement de la présence militaire américaine par le président Trump a du sens et pourrait un jour déboucher sur une forme de « victoire » politique pour la coalition internationale qui combat en Afghanistan.
L’Afghanistan demeure un enjeu important pour les États-Unis, dont un retrait militaire total aurait des conséquences très graves qu’ils devraient nécessairement assumer
L’Afghanistan reste l’un des pays de la « ligne de front » dans la lutte antiterroriste, qui dépend elle-même de l’issue de la guerre contre les Talibans.
Même si les médias américains se sont dernièrement plutôt concentrés sur la situation en Syrie, en Irak et accessoirement en Libye, l’Afghanistan demeure un pays important dans la lutte contre le terrorisme. Il se trouve aujourd’hui sur le territoire afghan tous les groupes islamistes terroristes les plus dangereux, dont les principaux sont Al-Qaïda et Daesh.
Or, tout progrès des Talibans sur le terrain favorise l’action des groupes terroristes, qui peuvent mener à partir des territoires contrôlés par les premiers (c’est-à-dire, par définition, des zones dans lesquelles les forces de l’ordre du gouvernement n’interviennent plus) des attaques en Afghanistan ou ailleurs dans le monde. Le maintien d’un gouvernement ami à Kaboul est la condition, pour les États-Unis, de la poursuite de la guerre antiterroriste dans la région Afghanistan-Pakistan.
La lutte antiterroriste menée par les États-Unis dans cette région « Af-Pak » (Afghanistan-Pakistan) n’est efficace que parce que le gouvernement afghan actuel, étroitement dépendant de Washington, est favorable à la présence des troupes américaines sur son territoire (ce n’était plus tout à fait le cas du président Karzaï).
Cette volonté de coopération s’est traduite par l’accord bilatéral de sécurité signé en septembre 2014 entre le gouvernement de Kaboul (c’est-à-dire le président afghan Ashraf Ghani et son « premier ministre » Abdullah Abdullah) et celui de Washington, qui autorise le maintien en Afghanistan d’une force de quelques milliers de soldats. Si la principale mission de ces troupes reste la formation et l’entraînement des 350.000 membres des forces de sécurité afghanes (ANSF), leurs deux autres missions, secondaires mais d’importance capitale pour les États-Unis, sont la lutte anti-terroriste dévolue aux forces spéciales américaines, ainsi que le maintien d’une capacité offensive aérienne, notamment en matière de drones.
Si ce gouvernement ami tombait, cette lutte antiterroriste serait infiniment plus compliquée à mener pour les États-Unis – ou, dit autrement, la chute du régime de Kaboul la compliquerait considérablement, comme l’a montré l’exemple yéménite.
Un retrait américain « ouvrirait une boîte de Pandore dont on ne sait quels chevaux de Troie sortiraient », pour reprendre une expression prêtée à l’ancien ministre britannique des Affaires étrangères Ernest Bevin.
Depuis le XIXème siècle, l’Afghanistan est le pays où se déploie le « Grand jeu » entre États voisins ou grandes puissances. Ce furent les empires britannique et russe à l’époque du Raj et de Kipling ; au XXème siècle, les États-Unis et l’URSS s’y affrontèrent indirectement ; c’est aujourd’hui principalement l’Inde et le Pakistan, accessoirement l’Iran, la Russie et la Chine. L’Inde et le Pakistan (tous deux États nucléaires, il faut le rappeler) y mènent une guerre larvée par procuration, la première en soutenant le gouvernement de Kaboul, le second les Talibans. Un retrait militaire américain qui fragiliserait le gouvernement de Kaboul exacerberait la lutte entre ces deux États et inciterait les autres puissances régionales à y accroître leur influence.
Une déstabilisation du gouvernement afghan et a fortiori sa chute renforceraient l’implantation des groupes terroristes comme Daesh. Celui-ci inquiète particulièrement l’Iran et la Russie, qui seraient donc tentés d’intervenir plus résolument en Afghanistan. Mais une influence accrue de Moscou rouvrirait les vieilles blessures de la guerre soviétique, et celle de l’Iran accroîtrait le rôle des chiites, ce qui pourrait être déstabilisant dans un pays très majoritairement sunnite.
Pour définir la stratégie des États-Unis en Afghanistan, deux contre-exemples ont pu inspirer les décideurs américains.
Le premier est celui de l’Afghanistan lui-même, lorsque les États-Unis l’ont abandonné à son sort après le départ des Soviétiques, en 1989. Une guerre civile s’est déclenchée, qui a débouché quelques années plus tard sur la prise de pouvoir par les Talibans et l’implantation d’Al-Qaïda sur le territoire afghan.
Le second contre-exemple est celui de l’Irak, où la situation s’est dramatiquement détériorée après le départ des troupes américaines en 2011. Quelques semaines seulement après l’annonce par le président Obama du retrait des forces américaines d’Afghanistan, l’État islamique arrivait presque aux portes de Bagdad. C’est cette détérioration de la situation en Irak qui a conduit le président Obama à décider in fine le maintien de quelque 8.500 hommes en Afghanistan, en laissant à son successeur le soin de définir la politique à suivre quant à la poursuite ou non de cet engagement militaire.
Un départ des forces américaines suivi d’un effondrement du régime de Kaboul sous les coups de la rébellion talibane serait forcément perçu comme une défaite des États-Unis, qui serait inévitablement imputée à Donald Trump.
Pour beaucoup d’analystes, d’historiens, de politologues, la seule « défaite » que craignaient les présidents américains dans la Guerre froide, c’était une défaite électorale. L’important était peut-être moins, en soi, une victoire ou une défaite face au camp communiste, qu’une défaite électorale due au sentiment qu’auraient eu l’opinion publique américaine et les adversaires politiques que « tout n’était pas fait pour contenir le communisme ». C’est sur ce « syndrome de la perte de la Chine » et l’accusation lancée contre le président Truman d’être « soft on communism » (léger envers le communisme) que s’est développé le maccarthysme.
De la même façon, Donald Trump est aujourd’hui trop fragile politiquement pour prendre le risque de donner l’image d’un président « soft on terrorism ».
Tant que le régime en place ne s’effondre pas, la « défaite » reste virtuelle.
Tant qu’on ne perd pas, on gagne, ou à tout le moins on peut encore prétendre qu’on va gagner… et on peut toujours y arriver.
Pour les militaires américains, la continuation du « jeu » écarte le risque d’apparaître, aux yeux de l’opinion publique américaine ou mondiale, comme « ayant définitivement perdu » cette guerre.
Les empires reposent sur le prestige qu’on leur reconnaît et le respect qu’on leur accorde. Les États-Unis souffriraient certainement, dans leur image, de ce qui apparaîtrait aux yeux du monde comme leur seconde grande « défaite » après le Vietnam.
Inversement, un retrait total des Américains serait perçu par les extrémistes islamiques comme leur plus grande victoire depuis celui des Soviétiques, en 1989, une victoire qui les conforterait dans leur volonté d’en découdre avec l’Occident – un peu comme le retrait israélien du Liban, en 2000, a été interprété par le Hezbollah comme une défaite de l’État hébreux.
Un effondrement du régime en place risquerait de coûter très cher aux États-Unis et aux autres pays occidentaux par ses conséquences, dont ils ne pourraient se désintéresser : crise humanitaire, avec une multiplication du nombre de réfugiés fuyant le pays (après la Syrie, l’Afghanistan est la seconde source de réfugiés vers l’Europe, et leur flot grossirait de façon dramatique si l’État afghan s’effondrait, les Talibans prenaient le pouvoir et la guerre civile était relancée) ; développement des groupes terroristes sur le territoire afghan (un peu à l’image de ce qui s’était passé avec Ben Laden sous le régime du mollah Omar) ; perte de crédibilité militaire et politique des pays occidentaux et au premier chef des Etats-Unis ; etc.
La poursuite de l’engagement américain vise donc d’abord à éviter l’engagement bien plus massif que ne manqueraient pas de rendre nécessaire un effondrement du régime actuel et un retour de la guerre civile en Afghanistan. On voit mal, en effet, comment (en vertu du principe : « Vous l’avez cassé, vous le réparez ou vous le payez ») les États-Unis pourraient éviter de revenir si le pays replongeait dans la guerre civile et le chaos.
D’une certaine façon, les plus de vingt milliards de dollars que les États-Unis dépensent chaque année (une quinzaine en dépenses militaires propres, et quelque cinq en aide au gouvernement afghan afin de lui permettre de payer ses soldats et policiers) pour tenir à bout de bras le pouvoir en place à Kaboul sont donc le prix à supporter pour éviter des dépenses infiniment supérieures qui s’imposeraient si celui-ci tombait sous les coups des Talibans.
Ayant à choisir entre « perdre rapidement » en quittant l’Afghanistan, « perdre lentement » en maintenant le même niveau de troupes, ou « ne pas perdre dans le court et moyen terme » en augmentant légèrement le contingent présent en Afghanistan, assez pour maintenir sur le terrain le « stalemate » (l’impasse) pendant encore quelques mois ou années, l’administration Trump a donc choisi cette dernière solution, la stratégie dite du « statu quo plus ». C’était là toute la logique de la demande présentée par le général John Nicholson, le commandant des forces américaines et de celles de l’OTAN en Afghanistan.
La guerre demeure « gagnable », sinon militairement, du moins politiquement
L’objectif militaire du renforcement du contingent américain en Afghanistan n’est plus de « gagner la guerre », mais de ne pas la perdre, à court et (dans toute la mesure possible) à moyen terme.
Depuis l’échec du « Surge » décidé par le président Obama en 2009, les Américains savent que la case « écrasement total de la rébellion talibane » est impossible à occuper.
Peu après son arrivée à la Maison blanche, le président Obama avait pris l’engagement de mettre fin à la présence militaire américaine en Afghanistan. En décembre 2009, il décidait d’un renforcement massif du contingent américain en triplant ses effectifs, qui finirent par atteindre quelque 100.000 hommes, tout en annonçant leur retrait total en 2011. Cette politique du « dernier coup de collier » poursuivait deux objectifs : écraser une bonne fois pour toutes la rébellion talibane et donner au gouvernement de Kaboul la possibilité de survivre assez longtemps au départ des militaires américains (« l’intervalle décent » qu’Henry Kissinger avait souhaité entre le retrait militaire américain du sud-Vietnam consécutif aux Accords de Paris de janvier 1973 et un éventuel effondrement du gouvernement de Saïgon).
Cette politique a triplement échoué : non seulement les Talibans n’ont pas été écrasés, ni même été incités à abandonner leur lutte, mais l’armée afghane est toujours incapable de faire face seule aux coups que lui porte la rébellion talibane ; et au surplus d’autres groupes terroristes comme Daesh se sont installés dans le pays.
L’objectif de l’administration Trump n’est plus de « gagner » sur le terrain militaire – ce qui nécessiterait de renvoyer plusieurs dizaines de milliers d’hommes, avec sans doute le même résultat que le « Surge » décidé par le président Obama, et ce retour en force ne serait de toute façon pas accepté par l’opinion publique américaine. Il est de ne pas perdre, en tout cas pas dans le court et moyen terme.
Ce calcul froid (qui est en contradiction totale avec la formule du général MacArthur mise en exergue du présent article) marque incontestablement une victoire des « réalistes » qui entourent le président Trump, notamment et surtout du conseiller à la Sécurité nationale, H. R. McMaster, et du secrétaire à la Défense, James Mattis, tous deux anciens généraux.
Inversement, cette nouvelle politique (qui est en fait très largement la continuation de celle du président Obama) est une défaite des « politiques » qui, à l’instar de Steve Bannon (démissionnaire de son poste de conseiller stratégique le 18 août 2017), préconisaient un retrait total des troupes américaines de ce pays, au nom du « America first » et de l’idée que les États-Unis devaient cesser de s’engager dans des conflits extérieurs, a fortiori sans issue.
Pour limitée qu’elle soit, cette présence militaire américaine renforcée est de nature à empêcher les Talibans de l’emporter militairement à court et moyen terme.
Au lieu d’un « surge » de plusieurs dizaines de milliers d’hommes mais limité dans le temps, la nouvelle administration américaine a choisi un renforcement d’ampleur finalement modeste (environ 4.000 militaires), mais sans limite de durée. Comme le commandant des forces américaines en Afghanistan, le général Nicholson, l’a dit récemment aux troupes afghanes : « Nous sommes avec vous, et nous resterons avec vous. »
Si, depuis 2014, les militaires américains stationnés en Afghanistan ne participent plus directement aux opérations de contre-insurrection face aux Talibans, ils contribuent à l’entraînement de l’armée afghane, et 2.000 membres des forces spéciales continuent des opérations de contre-terrorisme visant l’État islamique et d’autres groupes militants.
C’est pour la mission de formation des militaires afghans – et non pour les actions de contre-terrorisme – que la hiérarchie militaire américaine a réclamé un renfort de troupes. Ces cadres supplémentaires pourraient conseiller les officiers afghans non plus au niveau des corps d’armée, dans des états-majors, mais à des niveaux plus proches du terrain, ceux des brigades, notamment (ce que les militaires américains appellent « épaissir » la mission de conseil).
Ces quelque 12.000 soldats américains qui stationneront prochainement en Afghanistan sont loin des 90.000, qui, au plus fort de la présence militaire internationale, entre 2011 et 2014, formaient le gros de la Force internationale d’Assistance à la Sécurité – FIAS/IFAS.
Mais cette présence militaire interdit aux Talibans de l’emporter sur le terrain, car, à la différence de Daesh en 2014 en Irak, ils ne sont pas capables de conduire une « blitzkrieg » sur une large portion du territoire afghan et ils peuvent être chassés des villes qu’ils prennent. C’est un peu la leçon à tirer de la « chute » de Kunduz et de sa reprise au bout de quelques jours par les forces afghanes appuyées par les Américains : sans appui des États-Unis, le gouvernement de Kaboul est trop faible pour empêcher un progrès des Talibans sur le terrain ; avec cet appui, il peut contrer les avancées des Talibans, les empêcher de consolider leurs victoires ponctuelles.
Cette présence des forces américaines, même minimale, constitue donc, en quelque sorte, une « assurance-vie » pour le gouvernement de Kaboul.
Inversement, elle est destinée à convaincre les Talibans que, même s’ils ne peuvent être défaits, ils ne pourront jamais (en tout cas pas à court et moyen terme) l’emporter, puisque le président Trump, contrairement à ses prédécesseurs, n’a pas fixé de date limite à la présence des troupes américaines.
C’est là toute l’erreur que, selon la nouvelle administration, le président Obama a commise – en plein accord, à l’époque, avec les généraux McChrystal et Petraeus – en ordonnant le « Surge », en 2009. Comme ce renfort était assorti d’une date de retrait définitif des forces américaines d’Afghanistan (2011), les Talibans ont pu « jouer la montre », attendre le départ annoncé du contingent de l’OTAN (puisque le retrait américain aurait à coup sûr entraîné celui des autres pays), escomptant que le gouvernement de Kaboul s’effondrerait ensuite à plus ou moins brève échéance. Le résultat a donc été que, loin d’être poussés à négocier, les Talibans ont été d’autant moins incités à mettre fin à leur insurrection armée.
L’objectif de cette décision du président Trump de maintenir une force militaire américaine pour une durée illimitée est donc d’abord et avant tout de convaincre les Talibans que le temps ne joue pas en leur faveur, ne serait-ce que parce que la protection que le gouvernement américain offre à celui de Kaboul donne une chance à celui-ci de résoudre progressivement ses problèmes de gouvernance et à ses forces armées de se réformer. L’objectif est là encore politique : il est de donner la possibilité au gouvernement afghan de négocier à partir d’une position de force, non de faiblesse.
Assuré de survivre encore quelque temps, le gouvernement de Kaboul peut profiter de ce délai que lui offre l’administration américaine pour se renforcer militairement (sinon dans l’ensemble de ses forces, du moins dans ses éléments les plus professionnels, les commandos et l’armée de l’air) et politiquement (en organisant par exemple les élections législatives qui auraient dû se tenir depuis 2014). Il y est du reste fortement incité par son partenaire américain. Dans son discours, le président Trump a indiqué que la pression américaine s’exercerait non seulement sur le gouvernement pakistanais, mais aussi sur le gouvernement afghan pour qu’il réforme son appareil militaire et sa bureaucratie : « Notre soutien n’est pas un chèque en blanc. Notre patience n’est pas illimitée. Nous gardons les yeux sur vous. »
Quant aux Talibans, ils peuvent réaliser que si, comme l’a théorisé en 1962 l’officier français David Galula (« le Clausewitz de la guerre insurrectionnelle », selon le général Petraeus) dans son ouvrage Contre-insurrection : Théorie et pratique, toute lutte anti-insurrectionnelle consiste fondamentalement à gagner les cœurs et les esprits, la prolongation indéfinie de la guerre pourrait détacher d’eux les chefs de tribus et les anciens des villages.
Il faut rappeler qu’avant l’intervention américaine, l’Afghanistan avait connu une guerre civile de douze ans (1989-2001), et précédemment une guerre conduite par l’URSS, depuis que celle-ci avait pris le contrôle du pays, en décembre 1979.
Cela fait donc peu ou prou trente-huit ans que le pays n’a pas connu ce qu’on appelle communément la paix. Qu’il y ait, dans la population afghane, une lassitude face à cette guerre interminable n’a donc rien de surprenant.
En un sens, donc, une nouvelle partie vient de commencer, la précédente étant restée « inconclusive », comme on dit en anglais. C’est cette nouvelle partie que le président américain entend gagner, et qu’il peut encore gagner. La victoire appartiendra à celui des deux adversaires qui maintiendra résolument le cap, comme dans le « jeu de la poule mouillée » auquel jouent les adolescents dans le film La fureur de vivre.
La « non-défaite » militaire laisse la porte ouverte à une victoire politique
La stratégie américaine est donc cohérente. Elle consiste à aider le gouvernement de Kaboul à continuer la guerre aux Talibans comme si aucune négociation n’existait avec eux, et à favoriser une négociation comme si aucune guerre ne se poursuivait (soit la stratégie suivie par Itzakh Rabin avec l’OLP de Yasser Arafat).
Les deux choses ne sont pas contradictoires, surtout quand les frappes de drones visent des chefs talibans opposés aux négociations – ce qui était le cas avec celle qui a tué Akhtar Mohammad Mansour en mai 2016, dans la province pakistanaise du Balouchistan.
Contrairement aux groupes terroristes, qui peuvent se satisfaire de simplement infliger des coups à l’adversaire (qu’il soit le gouvernement afghan ou les militaires occidentaux), les Talibans ont un objectif politique : renverser le gouvernement afghan et prendre le pouvoir. Aussi longtemps qu’ils ne peuvent atteindre cet objectif, ils perdent.
Il faut donc inverser la formule d’Henry Kissinger (« une guérilla qui n’est pas écrasée militairement finit par gagner politiquement » – formule d’ailleurs fausse historiquement, puisque ce n’est pas la guérilla viêt-cong qui l’a emporté, au Vietnam, mais l’armée régulière du Nord-Vietnam) et considérer que les Talibans, tant qu’ils ne l’emportent pas militairement, perdent politiquement.
Parallèlement, les Talibans devraient comprendre qu’une victoire militaire serait pour eux un cadeau empoisonné, car elle leur donnerait les clés d’un pays ravagé, livré au chaos et peut-être ingouvernable en raison de l’effondrement économique qui résulterait de l’interruption probable des financements internationaux. À cela s’ajouterait une contestation sourde ou violente de la part d’une large fraction de la société afghane qui n’accepterait pas un retour à l’obscurantisme des années 90.
Car l’Afghanistan, quoi qu’on en dise, a évolué, depuis 2001.
De fait, des pans entiers de la société afghane, celle des villes, surtout, se sont habitués à un certain confort, à une ouverture sur le monde via les chaînes de télévision par satellite, internet, les réseaux sociaux, au respect des Droits de l’Homme et des garanties accordées aux minorités ethniques.
La société afghane n’est pas désespérément condamnée à l’obscurantisme. Il se dit d’ailleurs que l’un des moyens que le conseiller à la sécurité nationale du président Trump a utilisés pour le persuader que l’Afghanistan pouvait changer a été de lui montrer une photographie en noir et blanc de Kaboul en 1972, une ville alors occidentalisée dans laquelle des femmes se promenaient en jupes courtes.
La démocratie afghane existe également, de façon certes imparfaite, mais il y a un peu d’eau dans le verre, qui n’est pas vide.
Enfin, une hypothétique « victoire totale » des Talibans sur le terrain comme celle qu’ils avaient remportée en 1996 relancerait certainement la guerre civile dans certaines parties du territoire habitées par des minorités ethniques ou religieuses et entraînerait sans doute sur le territoire afghan un durcissement de la guerre larvée que s’y livrent par clients interposés le Pakistan et l’Inde, sans parler d’une ingérence de l’Iran.
Dans ces conditions, les Talibans, s’ils arrivaient à comprendre que la « victoire totale » qu’ils affichent comme leur objectif est une chimère, devraient d’eux-mêmes rechercher une solution politique, qui serait, pour revenir au pouvoir, d’accepter un compromis avec le pouvoir en place à Kaboul et avec le gouvernement américain.
Ce compromis impliquerait de leur part l’acceptation de l’État afghan, de sa constitution (et non plus un retour à « l’émirat » a-constitutionnel qui avait existé sous le régime du mollah Omar entre 1996 et 2001). Et aussi le respect d’un « socle » minimal de Droits de l’Homme (et surtout de la femme !), car les opinions publiques occidentales n’accepteraient pas que le pays retourne au Moyen Âge et considéreraient, pour le coup, que la guerre n’aurait servi à rien, que les militaires occidentaux morts en Afghanistan auraient été sacrifiés en vain. Si le sort des femmes afghanes n’a guère progressé dans les campagnes et les villes plus petites, et cela même dans les zones non contrôlées par les Talibans, il s’est quand même sensiblement amélioré à Kaboul et dans les plus grandes villes. Il y a aujourd’hui des femmes qui siègent au parlement, d’autres qui sont ministres ou gouverneures, et beaucoup travaillent dans les ministères. Il serait inacceptable pour ces femmes, pour les femmes afghanes en général, et pour les opinions publiques occidentales, que ces acquis soient remis en cause. En outre, des garanties accordées aux minorités non pashtounes (hazaras, chiites, tadjiks). La poursuite de la lutte contre les groupes terroristes les plus extrémistes. Et peut-être surtout, l’acceptation d’une présence militaire occidentale minimale, permettant aux États-Unis de continuer à mener des opérations antiterroristes sur le sol afghan et éventuellement dans les zones tribales pakistanaises.
Une telle négociation, pour conduire à une paix durable, devrait être ratifiée par une loyajirga (une « grande assemblée », source de tout pouvoir constitutionnel en Afghanistan) où siégeront des minorités et des femmes, qu’il faudra convaincre que l’accord en vue avec les Talibans ne signifierait pas la fin des droits et garanties dont ils bénéficient depuis 2001.
Une issue réaliste ?
Même s’ils comprennent que la négociation est la seule issue au jeu, les adversaires sont-ils en mesure de s’y engager ?
S’agissant des Talibans, tout devrait les en dissuader.
D’une part, leur logiciel n’est pas formaté pour cela : peut-on demander aux Talibans de ne plus être des islamistes extrémistes qui veulent diriger le pays selon des formules remontant au Prophète ? Mais après tout, les FARC (Forces armées révolutionnaires colombiennes) n’avaient pas non plus vocation à abandonner la lutte armée et à se transformer en parti politique légal, ce qu’ils ont quand même fait le 31 août 2017.
D’autre part, il est aujourd’hui difficile d’imaginer un accord avec les Talibans au terme duquel ceux-ci accepteraient le maintien indéfini d’une présence militaire américaine sur le territoire afghan, afin de permettre aux États-Unis d’y poursuivre des opérations de contre-terrorisme. Mais là encore, on peut objecter que les Talibans sont déjà en lutte contre l’État islamique.
Enfin, le risque, pour les chefs talibans, est sans doute celui d’une fracturation de leur mouvement, fracturation qui pourrait se produire s’ils acceptaient un compromis les amenant à partager le pouvoir dans un cadre constitutionnel très éloigné de « l’émirat » qui existait avant 2001. Le paradoxe serait alors que les Talibans ralliés au régime (le « canal historique », en quelque sorte…) ne soient amenés à combattre non seulement Daesh et d’autres groupes terroristes (et de le faire éventuellement aux côtés des Américains), mais aussi une insurrection de « Talibans plus talibans que les Talibans ». Les purs rencontrent toujours de plus purs qu’eux, prompts à condamner leur laxisme…
De leur côté, les Américains peuvent-ils négocier avec un adversaire perçu par les opinions publiques occidentales comme obscurantiste (on se souvient de la destruction des bouddhas de Bamiyan), mû par une idéologie religieuse, et a priori fermé à tout compromis sur le sort des femmes et des minorités ?
Deux considérations sont toutefois essentielles, qui expliquent que les États-Unis se soient déjà engagés dans ces négociations, de façon plus ou moins indirecte.
La première est le fait que les Talibans ne sont pas en eux-mêmes un danger pour les États-Unis. Avant septembre 2001, l’administration américaine supportait (au sens français du terme, c’est-à-dire « ne voyait pas d’inconvénient majeur à traiter avec ») le régime des Talibans, malgré les graves atteintes aux droits de l’homme dont il était coupable. Ce n’est pas la volonté de renverser un régime en soi inacceptable qui a justifié l’intervention militaire américaine de 2001, mais le fait qu’il ait apporté un soutien à Ben Laden et Al-Qaïda et refusé de les expulser après les attentats du World Trade Center.
La seconde considération qui pourra favoriser la conclusion d’un accord sous les auspices des États-Unis est la simple application du principe « l’ennemi de mon ennemi est mon ami ».
Leur ennemi absolu étant Daesh (et dans une moindre mesure Al-Qaïda), les Américains ne peuvent voir que d’un œil favorable le développement de la rivalité entre les Talibans et l’État islamique.
* * *
« On ne fait la paix qu’avec ses ennemis. »
Les termes de « défaite » et de « victoire » n’ont de sens qu’au regard des objectifs politiques qu’on s’est fixés et dont on peut dire, à un moment donné (à la « fin de la partie »), qu’ils ont ou non été atteints. L’aune qui permettra de mesurer la « victoire » des États-Unis dans cette longue guerre d’Afghanistan, ce sera donc les conditions de retour au pouvoir des Talibans.
Il y a encore quelques années, le ralliement de Gulbuddin Hekmatyar (surnommé « le boucher de Kaboul », en raison des milliers de morts que ses bombardements sur Kaboul avaient causés, lors de la guerre civile de 1992) au régime de Kaboul paraissait improbable, voire impossible. Or, il s’est produit en mai 2017, alors même que ce chef militaire, jusque-là inscrit par les États-Unis et l’ONU sur la liste des terroristes internationaux, tenait un discours aussi « islamiste » que les Talibans.
Dans quelques mois, une « paix » conclue par le gouvernement de Kaboul avec les Talibans sous les auspices de la communauté internationale étonnera peut-être le monde, à l’instar des accords Sadate-Begin ou Arafat-Rabin.
Cette paix, qui constitue l’objectif poursuivi par l’administration Trump, marquerait la vraie victoire des États-Unis, et celle des pays occidentaux plus largement.
Elle n’est pas impossible, même si elle paraît aujourd’hui difficile à imaginer.