« On ne prête qu’aux riches. » « Il n’y a pas de fumée sans feu. » Le bon sens populaire nous invite à prendre au sérieux la rumeur selon laquelle, contrairement à une France passive et complaisante envers Ben Ali, les États-Unis auraient joué un rôle crucial dans le départ pour l’étranger du dictateur tunisien, le 14 janvier 2011.
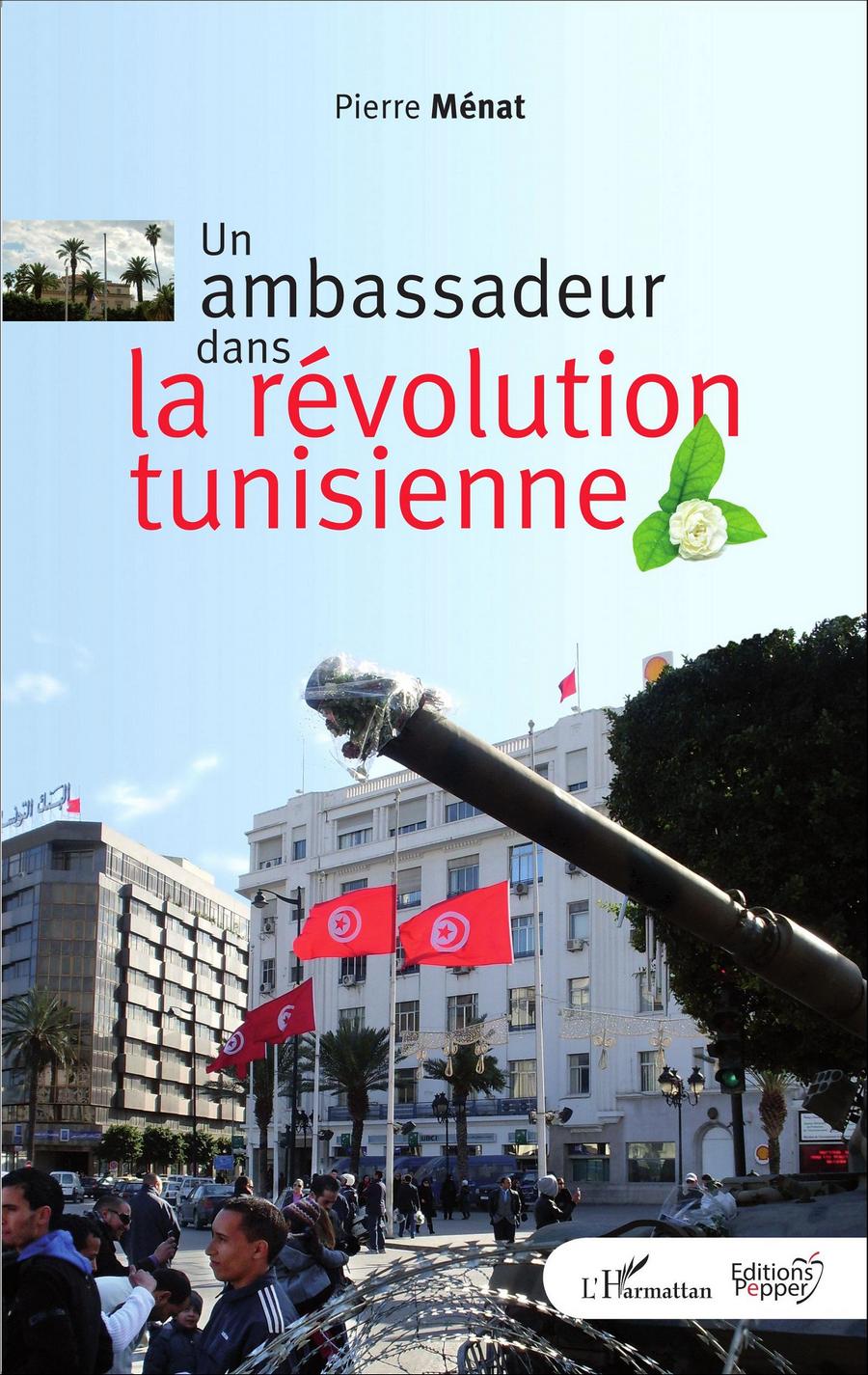 Six années plus tard, nous disposons du recul nécessaire pour porter une appréciation objective sur cette affirmation.
Six années plus tard, nous disposons du recul nécessaire pour porter une appréciation objective sur cette affirmation.
En tant qu’ambassadeur de France, j’étais présent à Tunis, au cœur de la tourmente, lors de ces journées de janvier.
Je crois utile de rappeler les faits, puis d’examiner les raisons pour lesquelles une telle thèse a pu être développée, avant de produire une conclusion.
Les faits
Alors que les historiens sont capables de relater, presque jour après jour, le déroulement de la révolution française de 1789, les événements de janvier 2011 en Tunisie demeurent largement méconnus. Six ans plus tard, nous ignorons encore ce qui s’est effectivement passé le 14 janvier 2011.
Le suicide par immolation à Sidi Bouzid, le 17 décembre 2010, de Mohammed Bouazizi, jeune vendeur de fruits et légumes dont la licence est confisquée par la mairie, entraîne une vague de protestation et des manifestations de plus en plus nombreuses, et d’abord contre le chômage.
Attisée par une répression aveugle et brutale, qui occasionne rapidement deux décès, la crise se répand. En vacances dans le Golfe, Ben Ali revient à Tunis pour prononcer, le 28 décembre, un discours très dur, sans appel au dialogue. Cette allocution entraîne la généralisation d’un conflit social qui devient politique…
Au cours du week-end des 8 et 9 janvier 2011, vingt manifestants sont tués à Thala et Kasserine. Dès lors, le pays est paralysé par des émeutes, encadrées par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT). La détermination des manifestants est renforcée par un nouveau discours complètement décalé de Ben Ali, le 10 janvier ; désormais, le mouvement, qui s’étend à l’agglomération de Tunis le 12 janvier, a pour mot d’ordre le départ du président et de sa belle-famille, les Trabelsi, dont la corruption est dénoncée.
Ben Ali tente de rétropédaler le 12, en limogeant le ministre de l’Intérieur, puis le 13 au soir, en promettant des élections parlementaires, l’instauration des libertés publiques, des enquêtes sur la corruption et son départ du pouvoir… en 2014.
Après cette allocution, c’est le trou noir.
Quel fut le déroulé des faits qui se produisirent entre le discours de Ben Ali, le 13 janvier à 20h00 et son départ du pays, le 14 vers 17h45 ?
Nous disposons, pour en juger, de beaucoup d’études et de témoignages. Le travail à mon sens le plus rigoureux qui a été effectué est celui de Pierre Puchot, qui a réalisé des enquêtes approfondies, les a relatées dans plusieurs articles publiés dans Mediapart, puis synthétisées dans un livre portant sur l’ensemble de la première année de la transition : La révolution confisquée. Nous pouvons aussi étudier la contribution certes inévitablement partiale d’un témoin-clé, Madame Ben Ali, dans un livre paru en 2012, Ma vérité. Outre d’innombrables articles consacrés à cette question, comme celui que publia dès février 2011 la talentueuse Léa Daniel. Il est donc possible d’examiner les thèses en présence, avant de poser les questions encore non résolues.
On pourrait résumer ces thèses en évoquant « les trois complots » et les « deux coups d’État ». Car ces mots ont été utilisés pour avancer des idées ou des faits bien différents.
D’abord les trois complots.
Le premier est celui que décrit Leïla Ben Ali-Trabelsi. Dans le chapitre intitulé une déstabilisation planifiée, elle décrit une entreprise de longue haleine, qui aurait réglé le moindre détail des événements de décembre-janvier en provoquant le soulèvement des masses, leur fournissant véhicules et armes et qui avait prévu depuis longtemps que la date du 14 janvier serait celle du départ de Ben Ali. Au fond, la première dame présente ce complot comme Aristote concevait sa théorie du monde : aucune disposition n’échappait à cette vaste entreprise.
Mais là où le bât blesse, c’est que l’auteure du livre ne donne aucune précision sur les instigateurs de ce complot, leur identité, leurs motivations. Elle laisse entendre que des « puissances étrangères occidentales » seraient impliquées, avec une allusion à peine voilée à la France. Leïla Ben Ali cite toutefois deux noms de « comparses » qui auraient mis la main à la pâte.
Le premier est le fameux Kamel Eltaief, ennemi juré de l’auteure, qu’elle cite chaque fois qu’il lui faut désigner un responsable de ses ennuis. D’ailleurs, ce personnage est abondamment évoqué dans la seconde partie du livre, plus intéressante à mes yeux, dans laquelle Leïla Ben Ali évoque les multiples tentatives de la famille Kefi (famille de la première épouse de Ben Ali) pour détacher le président de Leïla.
Le second « comparse » retient davantage l’attention. Il s’agit du général Ali Seriati, responsable de la sécurité présidentielle. En l’occurrence, l’affaire est plus sérieuse. D’abord, tous les témoignages révèlent que Seriati est le seul qui n’ait pas quitté Ben Ali tout au long de la journée du 14, jusqu’au décollage de son avion pour Djeddah. Ensuite, ces mêmes témoignages, y compris celui de Ben Ali lui-même et ceux que Seriati a présentés devant la justice, indiquent que le général a tout fait pour convaincre Ben Ali de faire partir la famille Trabelsi, puis de quitter lui-même la Tunisie. Agissait-il sur ordre et de qui ?
Lorsqu’on organise un « complot » et qu’il réussit, c’est plutôt vers le Capitole que vers la Roche tarpéienne que l’on est dirigé. Cependant, un propos énigmatique du ministre de la Défense de l’époque à propos de Seriati a été rapporté : « Il veut le beurre et l’argent du beurre. » Certes, personne ne sait ce que cela veut dire. Mais, en décrivant ainsi les mobiles du général, le ministre ne semblait pas surpris par son comportement…
Retenons donc de ce « premier complot » l’imagination débordante, voire délirante, de Leïla Ben Ali, mais aussi, quand même, le rôle trouble joué par le général Seriati. Notons aussi que la thèse fantaisiste de l’ex-première dame a souvent été reprise sous une forme atténuée, justement pour évoquer le rôle des États-Unis dans ces évènements.
Le « deuxième complot » aurait été fomenté par Leïla Ben Ali elle-même et réalisé avec l’appui du même Seriati.
Dans cette autre version, soutenue notamment par Léa Daniel, les événements du 14 janvier constitueraient le bouquet final du long combat entre les Trabelsi et tous ceux qui les détestaient depuis des années, groupe dont l’âme aurait été le fameux Kamel Eltaiëf. Les épisodes de cette lutte acharnée sont relatés dans l’ouvrage de Leïla Ben Ali. Or, le 13 au soir, les « anti-Trabelsi » semblent avoir remporté la bataille. Certes, Ben Ali n’a prononcé aucun nom et n’est pas allé jusqu’à « répudier » son épouse, comme le lui auraient conseillé certains proches. Mais, par deux fois, il a affirmé avoir été « trompé ». Par qui d’autre que son entourage immédiat, puisque depuis longtemps il n’était plus approché que par celui-ci ?
Le début de la journée du 14 semble confirmer cette thèse. Vingt-sept membres de la famille Trabelsi débarquent « en tongs » au Palais de Sidi Bou Said, résidence privée du Président, tôt dans la matinée. Ils ont été contactés par la sécurité présidentielle qui, compte tenu des menaces qui pèsent sur eux, organise leur départ de Tunisie. La première dame appelle son époux, qui lui conseille de partir en Arabie Saoudite pour quelques jours avec sa proche famille, tandis que le président restera à Tunis.
Dans cette version des faits, Leïla Ben Ali se considère alors comme piégée. Ce départ à l’étranger ressemble beaucoup à une expulsion. Elle risque de ne plus revoir son mari, et surtout de ne plus jamais bénéficier des doux agréments que procure le pouvoir. S’il devait en être ainsi, il vaudrait mieux, à tout prendre, que le Chef de l’État parte aussi.
Il faut agir vite. La régente contacte alors Seriati et l’invite à convaincre Ben Ali que lui aussi doit être du voyage.
Que penser de ce « deuxième complot » ? Il n’est pas invraisemblable que Leïla Ben Ali ait nourri de telles pensées, compte tenu des haines recuites que révèle son livre. Mais quel aurait été l’intérêt de Seriati de se prêter à cette manœuvre ? Le couple présidentiel parti pour l’étranger, le général – qui a refusé lui-même de monter à bord de l’avion – se serait retrouvé sans défense face aux autorités transitoires, qui, de fait, l’arrêteront dès le 14 au soir à l’aéroport. Il ne sortira de prison qu’en mai 2014.
Le personnage d’Ali Seriati est également censé se trouver au cœur du « troisième complot », mais dans un rôle bien différent.
Il s’agit d’une thèse largement reprise par la presse dans les jours qui suivent le 14 janvier, selon laquelle un « pacte » aurait été conclu entre Seriati et Ben Ali au moment du départ de ce dernier : « Je pars ! Mais nous allons brûler Tunis… »
Une fois dissoutes, les forces spéciales auraient eu pour mission de semer la terreur et d’organiser dans la capitale un tel carnage que seul le retour de Ben Ali aurait pu sauver la nation.
Pierre Puchot a démontré que cette théorie ne reposait sur aucun fondement avéré. D’après lui, cette thèse aurait été utilisée par les autorités transitoires pour créer un climat de panique, agréger autour de cet ultime crime la haine du peuple à l’endroit de l’ancien dictateur et justifier certains débordements des forces de l’ordre au cours de l’après-14 janvier. Selon moi, qui ai vécu ces folles journées, il est fort possible que, de manière générale, Pierre Puchot ait raison. Je n’exclus pas néanmoins certaines réactions isolées, menées par des partisans du régime, mais sans instruction particulière. J’ai ainsi personnellement été témoin, le 16 janvier, d’exactions d’un sniper avenue Habib Bourguiba, qui ne semblaient pas relever de la mise en scène.
Venons-en à présent aux « deux coups d’État ».
Le premier serait le fait d’un militaire plutôt isolé, le colonel Samir Tarhouni.
Après le putsch des généraux à Alger en 1961, celui des colonels à Athènes en 1967, il s’agirait donc du « coup d’État du colonel ».
Tarhouni était alors le chef de la brigade anti-terroriste. Lorsqu’il intercepte des messages indiquant que vingt-sept membres de la famille Trabelsi s’apprêtent à quitter le pays, il entreprend de s’y opposer (en bloquant, grâce à son épouse qui est contrôleuse aérienne, le décollage des avions), malgré les ordres donnés par le ministre de la Défense. Avec l’aide de ses hommes, il parvient à intercepter la quasi-totalité de ce groupe. Il remet ces personnes à l’armée en vue de leur arrestation (Leïla Ben Ali-Trabelsi pourra en revanche quitter la Tunisie en compagnie de son mari, de son fils âgé de cinq ans, de sa fille Halima et du fiancé de cette dernière).
Dans la soirée, le premier ministre, Mohammed Ghannouchi, contacte Tarhouni et lui demande « s’il veut devenir président ou qui entend-il placer à la tête de son coup d’État ». Le colonel répond qu’il reconnaît l’autorité de Ghannouchi.
Le comportement du colonel Tarhouni a été courageux, téméraire et risqué. Empêcher les Trabelsi de s’enfuir, c’était conforme aux attentes des Tunisiens. Mais il ne s’agissait en aucune manière d’un coup d’État, tout au plus d’un coup de force.
Le second « coup d’État » est dénoncé par le président Ben Ali lui-même.
Ce dernier a donc quitté la Tunisie le 14 janvier à 17h49 pour accompagner sa famille proche en Arabie Saoudite. Dans son esprit, l’avion qui les transportait devait le ramener, lui, à Tunis, aussitôt son vol aller accompli. Or, non seulement l’empêchement provisoire du chef de l’État a été constaté par plusieurs membres de son gouvernement ; mais en plus, les autorités transitoires qui se sont proclamées en conséquence de cet empêchement s’opposent au retour de Ben Ali. Et, dès le 15 janvier au matin, l’empêchement définitif est constaté au titre de l’article 57 de la Constitution. Fouad Mebazaa, le président de la chambre des députés, assume désormais, à titre transitoire, la charge de chef de l’État.
Pour Ben Ali, c’est un coup d’État. Il n’est empêché d’exercer ses fonctions que parce qu’on l’en empêche…
J’ignore si des juristes se sont penchés sur cette question. Mais j’aurais tendance à penser que Ben Ali a tort à la fois sur le plan juridique (son empêchement est incontestable) et politique (on imagine les troubles et les atteintes à la sûreté de l’État qui eussent résulté d’un retour de Ben Ali à Tunis dans ces circonstances). Le constat de l’empêchement définitif est d’ailleurs la seule option qu’ait considérée l’exécutif ; c’est ce que m’a dit le ministre des Affaires étrangères, Kamel Morjane, le 14 janvier au soir.
Ces diverses théories ne nous expliquent pas l’enchaînement des événements intervenus entre le 13 janvier à 20 h et le 14, à 17h49. Mais elles révèlent une réalité fort crue : le Roi était nu.
Beaucoup de questions se posent encore…
D’abord, pourquoi le discours du 13 au soir n’est-il suivi d’aucun effet ? Le 13 au soir, sur instigation d’un groupe de personnes dont l’identité est mal connue (Leïla Ben Ali prétend qu’il s’agissait de ses conseillers habituels, Abdallah et Ben Dhia ; ce qui est un peu surprenant puisqu’ils auraient alors proposé au président de rendre ainsi public leur propre limogeage), Ben Ali promet toutes les libertés, des élections démocratiques, un gouvernement d’union nationale, une lutte acharnée contre la corruption. « On m’a trompé », dit-il à deux reprises. Mais, semble-t-il, il ne va pas aussi loin que prévu et ne prend pas assez de distance avec les Trabelsi.
Que se passe-t-il ensuite ? Rien.
Pour reprendre cette fameuse main, il aurait fallu agir dans la nuit. Désigner un gouvernement d’union nationale, le faire siéger séance tenante. Occuper le terrain médiatique.
Mais Ben Ali n’en était plus capable. On avait fini par le convaincre de prononcer les quelques mots attendus. Mais qui les relaie ensuite dans la réalité ? Pas le gouvernement, qui se borne à s’empêtrer dans les chausse-trapes du maintien de l’ordre.
La deuxième question est de savoir pourquoi la famille Trabelsi est invitée, le 14 au matin, à quitter le pays.
Ici, la réponse est plus simple. Certes, les intéressés sont victimes d’actes hostiles et violents, commis par des gens en colère contre leurs exactions. Mais surtout, le Président a annoncé la veille au soir un combat sans merci contre la corruption. Si son message est entendu et qu’il conserve le pouvoir, il devra faire juger toutes ces personnes, qui seront emprisonnées. Voilà pourquoi il leur fait conseiller de quitter le pays « pour quelques jours ». Et il fait la même recommandation à sa propre épouse.
Troisième question, quant à elle non résolue : pourquoi et sur instruction de qui le général Seriati finit-il par conseiller à Ben Ali de partir lui aussi ?
Les arguments utilisés (possible invasion du palais, bombardement, assassinat par un garde du corps) évoquent une rébellion généralisée des forces de l’ordre, complètement invraisemblable. Toujours est-il que le président finit par partir, mais convaincu – et sur ce point, tous les témoignages sont concordants – qu’il rentrera le soir même ou le lendemain matin.
Or, tous ceux qui s’impatientent du décollage de l’avion présidentiel, tel le ministre de la Défense, qui, selon un témoignage recueilli par Pierre Puchot, s’écrie « Comment ?! Ils ne sont pas encore partis ?! », savent parfaitement que Ben Ali ne pourra jamais revenir. Or, c’est une certitude : personne, ce jour-là, dans l’appareil d’État, n’a empêché Ben Ali de partir. Nous ignorons en revanche les instructions données au général Seriati et par qui. Mais comment imaginer que ce militaire ait agi sans aucune couverture ?
Si des questions se posent encore sur le déroulement de cette journée, sur le rôle de tel ou tel, la conclusion est parfaitement claire : Ben Ali a été « dégagé » par le système lui-même. Un système qui recouvre le gouvernement, l’armée, la police et finit par se convaincre, ce jour-là, que Ben Ali était trop faible, trop lié aux Trabelsi.
Une intervention des États-Unis ?
Plusieurs arguments peuvent laisser croire que les États-Unis sont intervenus dans les événements du 14 janvier 2011…
Le premier argument pourrait être qualifié de « cosmologique » : en vertu de leur « global leadership », les États-Unis d’Amérique ne peuvent qu’être associés à tout fait quelque peu marquant qui se produit dans le monde. Washington ne fait d’ailleurs rien pour démentir la puissance de cette main invisible. Plaident en ce sens un réseau diplomatique aux effectifs pléthoriques, le large recours de la CIA à des informateurs locaux, ou encore les moyens financiers conséquents que le gouvernement américain consacre à son action extérieure. Deuxième par la taille, l’appareil diplomatique français est très loin derrière le numéro 1. L’enveloppe budgétaire française annuelle de 5 millions d’euros en Tunisie (en 2017) fait figure de parent pauvre, comparée aux 200 millions de dollars que Washington consacre à ce pays : 130 millions pour la réforme militaire (dont l’armement…) et la sécurité, 74 millions d’aide économique.
On pourrait rétorquer que ces chiffres sont en deçà des crédits de l’UE (entre 200 et 300 millions d’euros au titre de la politique de voisinage, dont 18% venant de la contribution française). Ce serait oublier que le budget européen est dépourvu de conditionnalité et, pour tout dire, de véritable accompagnement politique volontariste. Ce rapport de forces contributives existait déjà, dans une moindre mesure qu’aujourd’hui, en 2011. Même dans un pays ne faisant pas partie de la zone d’influence prioritaire de Washington, dont la langue de travail est le français, les gouvernants ont tendance à écouter davantage ceux qui sont à la fois conseilleurs et payeurs. Le premier d’entre eux est sans nul doute le représentant de l’UE mais son message, qui résulte de compromis entre États à Bruxelles, est souvent peu clair. Dans ce contexte, la coopération militaire Tunis-Washington était forcément bien plus substantielle que celle de la France. On pouvait en induire que, par la voie du dialogue entre hauts responsables des armées, des messages auraient pu être passés, y compris le 14 janvier. De là à transformer ces messages en « instructions », ces instructions en « complot », il y avait un pas, ou plutôt un gouffre, que certains ont allègrement franchi.
Deuxième argument : les États-Unis pratiquent une diplomatie publique consistant à clamer haut et fort d’éventuelles critiques, notamment sur les failles démocratiques, là où d’autres, qui connaissent l’attachement de nombreux États au principe de non-ingérence, préfèrent placer leurs remontrances dans le cadre d’un dialogue discret. Certes, cette ligne de conduite américaine exaspère les pouvoirs en place, mais, habilement distillée au Congrès et dans la presse, produit, en politique intérieure, un goût de miel.
Ainsi, au grand dam des hiérarques de Carthage, la secrétaire d’État Condoleeza Rice, reçue par le Président Ben Ali le 7 septembre 2008, lui recommande-t-elle de ne pas briguer un nouveau mandat, laissant filtrer ses propos dans la presse. Ainsi après la réélection du raïs en 2009, lorsque la France et d’ailleurs l’Union européenne sortent des communiqués polis, le State Department se dit « préoccupé par l’absence de transparence du processus électoral ». Ainsi les administrations Bush et Obama affichent le projet d’un Proche-Orient -incluant le Maghreb- démocratique. C’est à Tunis que s’installe le bureau régional de l’initiative pour un partenariat au Proche-Orient. Cette antenne, en théorie distincte de l’ambassade des États-Unis, multipliera les contacts avec la société civile, apportant notamment des soutiens financiers à quelques bloggeurs.
Mais c’est surtout ce troisième argument qui a été avancé : l’affaire Wikileaks, survenue un mois et demi avant la chute de Ben Ali, avait mis au grand jour des éléments témoignant de l’extrême lucidité des Américains.
Des dizaines de milliers de pages reproduisant des documents secrets ou confidentiels émanant de plusieurs ambassades des États-Unis ou du Département d’État furent déversés sur les sites Internet du monde entier à partir du 28 novembre 2010. Pour l’essentiel, il s’agissait de télégrammes émanant des postes diplomatiques américains. La plus célèbre des opérations de l’ONG Wikileaks était engagée.
Parmi ces innombrables textes, pour la plupart compromettants pour Washington, figuraient 1.055 télégrammes émanant de l’ambassade des États-Unis à Tunis et rédigés entre mai 2008 et février 2010 ; 90 % d’entre eux avaient été rédigés pendant le mandat de l’ambassadeur Godec, qui avait pris fin en juillet 2009, et 10 % étaient signés par son successeur, Gordon Gray.
Même si le pouvoir continuait de bloquer certains sites ou blogs, le contenu de Wikileaks se répandit comme une traînée de poudre en Tunisie. Face à la colère des jeunes, Ben Ali avait renoncé à interdire l’accès à Facebook. Et de toute manière, les Tunisiens résidant à l’étranger transmettaient les informations à leurs familles ou correspondants dans le pays.
Comme toutes les communications qu’une ambassade adresse à ses autorités, celles-là ressortaient de deux catégories : des comptes rendus factuels d’entretiens avec diverses personnalités ; et des notes d’analyse.
Beaucoup de commentateurs ont pu gloser sur la « lucidité » de la diplomatie américaine, opposée à « l’aveuglement » des Français. Or, si l’on avait pu comparer les documents respectifs des deux missions diplomatiques, on aurait constaté une identité de vues.
D’abord, par le constat commun des violations massives des Droits de l’Homme et des atteintes à l’État de droit. L’ambassadeur Godec aboutissait aux mêmes conclusions que moi : s’il était parfois nécessaire, ne fût-ce que pour satisfaire telle ou telle ONG, de dénoncer publiquement les atteintes aux libertés publiques, les démarches discrètes demeuraient les plus efficaces, même au risque de fournir une échappatoire au régime.
Ensuite, le diagnostic sur le régime était le même. Celui-ci n’était pas réformable car trop sclérosé. Ben Ali était présenté, comme dans nos papiers, comme un homme qui s’était peu à peu coupé des réalités. La corruption généralisée perpétrée par les familles du Président – et surtout les Trabelsi- était dénoncée. Mais plus encore, il était démontré que Ben Ali, informé de ces pratiques, avait réagi de plus en plus faiblement et, pour finir, les avait globalement couvertes.
Les portraits des principaux piliers du régime étaient convergents. Abdallah était notamment décrit comme un homme d’appareil, débutant ses entretiens par de longs monologues de propagande. L’ambassadeur Godec avait été convoqué pour se voir signifier le « dégoût » du ministre quant à une critique faite le 1er mai par Washington ; cela m’avait rappelé les propos du même Abdallah sur la publication en France du livre La régente de Carthage. De la même manière, l’ambassadeur Gray notait le changement d’approche et de ton qui caractérisait l’arrivée de Kamel Morjane aux affaires étrangères.
Il y avait cependant une différence, que les commentateurs n’avaient pas notée. Dans ses comptes-rendus d’entretien, Godec relatait des conversations avec Sakher El-Materi (le gendre de Ben Ali), qui s’apparentaient beaucoup à des négociations commerciales. Certes l’ambassadeur se pinçait-il le nez lorsque son vis-à-vis se faisait fort, à propos de l’implantation des enseignes Coca-Cola, d’obtenir sans coup férir les autorisations nécessaires. Mais cette réserve ne l’empêchait pas de conclure.
Par ailleurs, Wikileaks révèle que mon collègue britannique s’est appuyé sur le gendre du président pour obtenir des rendez-vous au duc d’York, venu promouvoir quelques entreprises de son pays. Je n’ai pour ma part rencontré que deux fois El-Materi, hors toute discussion d’affaires. Si j’avais des démarches à accomplir, je m’adressais aux ministres.
Les États-Unis sont-ils donc derrière la chute de Ben Ali ?
Pour répondre à cette question, il faut reprendre les deux conclusions que de nombreux observateurs ont tirées des trois arguments précédemment développés, en s’efforçant d’en mesurer la pertinence.
Première affirmation : « Il est évident que les États-Unis étaient mieux informés que les Européens et notamment la France sur la situation en Tunisie. »
D’où vient cette évidence ? Tout simplement des révélations de Wikileaks. Et au passage, les tenants de cette thèse oublient deux faits simples.
Le premier : l’opération Wikileaks résulte, comme son titre l’indique, d’une gigantesque fuite pour laquelle ses organisateurs sont, comme on le sait, poursuivis par la justice américaine et celle de plusieurs autres pays.
Il est un principe de droit romain qui demeure valide dans la plupart des systèmes juridiques contemporains : « Nemo auditur suam propriam turpitudinem allegans ». Nul ne peut être entendu s’il allègue sa propre turpitude.
Et pourtant, c’est bien ce qui s’est passé dans le volet tunisien de Wikileaks. Si le contenu de ces télégrammes a été porté à la connaissance du public, cela n’a pas résulté d’une volonté de transparence de Washington, mais d’une violation délibérée du secret des communications gouvernementales.
Peu importe, pourra-t-on répondre. C’est le contenu qui compte et révèle, dans le cas particulier de la Tunisie, la lucidité de la diplomatie américaine. C’est oublier que les télégrammes des autres ambassades sont pour leur part restés secrets. Pour l’ambassade de France, je répète que la publication de nos papiers aurait montré non seulement une similitude d’analyses, mais aussi les nombreuses tracasseries qu’ont valu à mes prédécesseurs et moi-même nos démarches en faveur, notamment, de la liberté de la presse.
Deuxième fait : les documents publiés sur Internet sont complètement déconnectés dans le temps de la situation tunisienne de janvier 2011 : 90 % d’entre eux sont antérieurs à juillet 2009, date du départ de l’ambassadeur Godec de Tunis ; et les 10 % restant, qui émanent de Gordon Gray, ambassadeur en poste en 2011, ont été envoyés avant l’été 2010. Nulle trace d’une anticipation de la crise à venir n’y figure.
Le 19 novembre 2009, parmi un groupe de 12 chefs de postes, Gordon Gray et moi-même avons présenté nos lettres de créances au président Ben Ali. Du discours prononcé par ce dernier, la presse a retenu un passage très dur exigeant la « loyauté » des ambassadeurs en poste à Tunis à l’égard du pouvoir en place. Ce principe inventé pour la circonstance était un avertissement tant à mon collègue américain qu’à moi-même, très mal vu par les autorités parce que je dénonçais ouvertement le refus opposé à l’entrée en Tunisie de la journaliste française Florence Beaugé, ainsi que l’incarcération, pour des faits de droit commun montés de toute pièce, du journaliste tunisien Ben Brik.
Deuxième affirmation : « L’issue de la crise tunisienne a fait l’objet d’un feu vert, voire d’instructions donnés par les Américains. »
Ainsi, les propos du général Ammar, chef d’état-major de l’armée de terre tunisienne, marquant son refus de tirer sur les manifestants, auraient été inspirés par les États-Unis. Ce serait sur leur recommandation que Ben Ali aurait décidé de prononcer son fameux discours du 13 janvier, puis de conseiller à la famille Trabelsi de quitter le pays le 14 janvier. Sur leurs instances, le général Seriati aurait persuadé, à la dernière minute, Ben Ali de prendre l’avion pour Djeddah. Et dans la nuit, ce serait toujours sous influence américaine que le ministre de la Défense Ridha Grira se serait opposé au retour de Ben Ali à Tunis.
Ces allégations ont été répétées avec constance, mais sans consistance et sans que personne ne mesure ni la légèreté de telles affirmations, ni la totale indifférence supposée des États-Unis quant au sort des personnalités censées avoir coopéré avec eux, ni enfin le décalage de ces assertions d’avec la réalité.
Légèreté. Car quel aurait été l’objectif des États-Unis ? Faire partir Ben Ali et confier la Tunisie au gouvernement de Mohammed Ghannouchi ? En pareil cas, ce « complot » n’aurait produit ses effets que durant six semaines, puisque le premier ministre dut quitter ses fonctions le 27 février sous la pression de la rue. Enclencher un processus débouchant sur l’arrivée au pouvoir d’un parti islamiste ? On a peine à y croire…
Indifférence. Car les « complices » des instigateurs auraient dû, en bonne logique, tirer profit de leur concours. Or, le général Seriati fut arrêté le soir même du 14 janvier, pour n’être libéré que trois années plus tard. Quant à Ridha Grira, sous le coup de différents chefs d’inculpation, il fut également incarcéré en septembre 2011 et allait rester en détention sans jugement jusqu’au 4 mars 2014, ne devant sa libération qu’à la gravité de son état de santé. Il finit d’ailleurs par être jugé en 2015 et condamné, dans deux affaires différentes, respectivement à 5 et 10 ans de prison.
Décalage par rapport à la réalité. Car le récit des faits révèle, de l’avis général, un pouvoir tunisien autiste, au sein duquel l’entourage du raïs obtient de sa part des concessions au compte-gouttes, dont la principale est le lâchage des Trabelsi.
Comme on l’a démontré plus haut, Ben Ali finit, à la dernière minute, par monter dans l’avion pour Ryadh, mais persuadé qu’il reviendrait le soir même.
Dans ce scénario à rebondissements, les différents épisodes, s’inscrivant dans un schéma décousu, résultent davantage d’initiatives individuelles désordonnées, d’improvisations, que d’un plan orchestré et bien huilé.
*
* *
Les États-Unis sont une superpuissance, qui dispose de capacités militaires, monétaires, financières et d’influence supérieures à tout autre État. Mais en janvier 2011, ce sont les Tunisiens qui ont décidé de leur destin.
Quelques proches de Ben Ali ont mesuré l’immense colère exprimée par le peuple et compris que seul le départ du dictateur pouvait l’apaiser. Ainsi et ainsi seulement s’expliquent le déroulement et l’issue de la folle journée du 14 janvier 2011.



